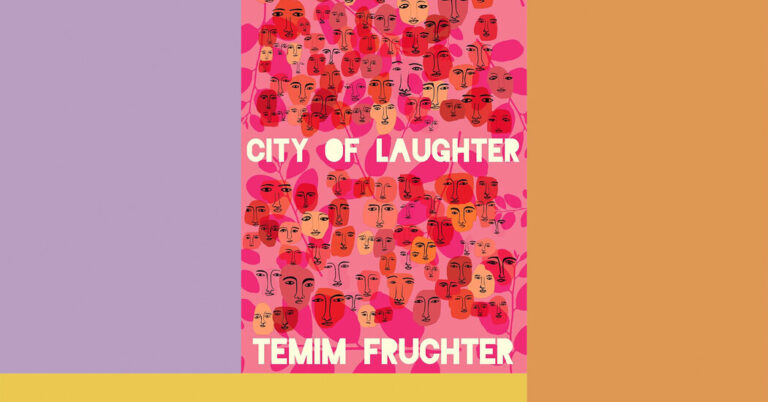Critique de livre : « Milton Friedman », de Jennifer Burns
En écrivant sa nouvelle biographie de l’économiste lauréat du prix Nobel Milton Friedman, connu tout au long de sa vie pour son soutien enthousiaste à la déréglementation et au libre marché, Jennifer Burns avait certainement du pain sur la planche. En réfléchissant à la controverse suscitée par son sujet, elle dit que l’un de ses objectifs était de « redonner à son image publique la plénitude de la pensée de Friedman ». Elle dépeint Friedman, décédé en 2006 à l’âge de 94 ans, comme la victime d’une « agression bipartite », assiégée par des radicaux de gauche et des populistes de droite qui dénoncent le « néolibéralisme » qu’il défendait avec tant d’ardeur. « À mesure qu’il symbolisait de plus en plus un mouvement politique », écrit-elle, « la nuance et la complexité de ses idées se sont perdues ».
Mais même Burns doit admettre que cette attention portée à « la nuance et à la complexité » était quelque chose que Friedman a beaucoup fait pour décourager. Il a passé des décennies à devenir une célébrité publique, faisant des déclarations confiantes sur le miracle des marchés, que ce soit dans ses chroniques pour Newsweek ou dans sa série télévisée de 1980, « Libre de choisir ». Une scène célèbre montre le petit Friedman chauve tenant un crayon, s’émerveillant que des milliers de personnes qui ne se connaissaient pas aient contribué à sa création. Les principes qui sous-tendent une coopération aussi complexe sont « vraiment très simples », a-t-il déclaré. La productivité et l’harmonie pourraient être évoquées par « la magie du système de prix ».
Pour aller au-delà de Friedman le vulgarisateur, Burns – un historien de Stanford qui a également écrit une biographie d’Ayn Rand – consacre une bonne partie de ce livre à analyser le travail de Friedman avant 1970, alors qu’il s’en prenait encore à l’orthodoxie keynésienne de l’époque. À l’Université de Chicago, où Friedman a passé la majeure partie de sa vie d’enseignant, il a devancé les universitaires de gauche regroupés au sein de la Commission Cowles pour la recherche économique, amenant astucieusement la Fondation Rockefeller à retirer son financement de la commission et à financer l’atelier de Friedman à la place.
Charismatique en classe, Friedman ne se contentait pas d’enseigner aux étudiants ; il a créé des convertis. Le résultat final fut une faculté que Burns qualifie de « inhabituellement consanguine ». Friedman a peut-être dû attendre son heure à la périphérie de son domaine, mais au sein de l’Université de Chicago, il s’est entouré d’un groupe d’économistes partageant les mêmes idées. Il a été l’un des rares économistes à prédire la stagflation des années 1970, lorsque les outils keynésiens semblaient impuissants face à une inflation et un chômage élevés.
« Plus la régression est complexe, plus je suis sceptique », aimait à dire Friedman. Malgré toute la promesse de Burns de révéler la subtilité sous-jacente de ses idées, ce qui devient clair dans ce livre est la fréquence à laquelle il était attiré par une simplicité insistante. Il y avait une dimension politique à cela. Des modèles économétriques complexes suggéraient qu’une économie complexe pouvait être planifiée. Mais la théorie des prix – selon laquelle les prix constituent le mécanisme le plus efficace pour coordonner l’activité économique – suggère que la planification est destructrice ou sans objet.
De telles gloses optimistes sur un marché sans entraves comme étant le meilleur de tous les mondes possibles concordaient avec la disposition implacablement ensoleillée de Friedman. Enfant du New Jersey, fils unique de parents immigrés de l’Empire austro-hongrois, Friedman se comportait comme « un prince exubérant et sûr de lui », écrit Burns. Il a épousé Rose, sa chérie d’études supérieures, qui a renoncé à sa carrière prometteuse d’économiste pour élever leurs deux enfants. D’après tous les témoignages, ils semblaient avoir un mariage heureux et aimant, et ils ont même co-écrit un mémoire, « Two Lucky People ». Il contient ce que Burns appelle une « version aseptisée » d’un terrible événement survenu une nuit de 1955 alors que Milton était en voyage de travail en Inde. Un intrus est entré par effraction dans la maison familiale à Chicago et a violé Rose.
Milton « ne voyait aucune raison de modifier ses projets, qui prévoyaient un séjour de deux mois à l’étranger », écrit Burns, jusqu’à ce qu’un de ses mentors de confiance le convainque de rentrer chez lui. Le détail est étonnant et peut-être révélateur – même si Burns le vide en grande partie de sa force émotionnelle, passant rapidement, dans la section suivante, au témoignage de Friedman au Congrès sur la masse monétaire.
Une grande partie du livre est consacrée à disséquer les controverses sur les concepts monétaires de Friedman, mais des aperçus de sa personnalité émergent néanmoins. C’était un joyeux optimiste et, lorsqu’il collaborait avec des femmes dans son domaine, il pouvait être un joyeux consommateur de crédit. Bien qu’il ait passé des appels téléphoniques de soutien au nom d’Anna Schwartz, sa co-auteure de « A Monetary History of the United States » (1963), Burns montre également que Friedman s’approprie les idées partagées et laisse aux collaboratrices le soin de faire le gros travail. .
Burns est chercheur à la Hoover Institution, le groupe de réflexion dédié aux marchés libres où Friedman a également été chercheur pendant trois décennies après avoir quitté Chicago. Sa biographie est loin d’être une hagiographie. Mais lorsqu’elle découvre les épisodes les plus célèbres de la vie de Friedman, elle tient tellement à recréer son point de vue que son écriture devient venteuse et protectrice. Elle détaille l’opposition de Friedman au mouvement des droits civiques, qui « jette une ombre sur son héritage ». Pourtant, ici comme ailleurs, elle s’efforce d’être généreuse, répétant constamment les propres dénégations répétées de Friedman à l’égard des préjugés. Dans un passage alambiqué, elle suggère que son refus de dénoncer l’utilisation ségrégationniste des chèques scolaires était, aussi troublant soit-il, une question de respect de ses principes de non-intervention.
Son chapitre sur la relation de Friedman avec le régime du dictateur chilien, le général Augusto Pinochet, est tout aussi gênant. Friedman a tenté de nier l’existence d’une relation importante : il a simplement passé quelques jours au Chili et a offert quelques conseils économiques. Ce conseil équivalait à un programme d’austérité impitoyable, qui, selon Friedman, était finalement bénéfique. Sans surprise, il voulait gagner sur les deux tableaux : tout le mérite sans aucun blâme. Burns présente Friedman comme un bébé dans les bois, « à l’esprit littéral jusqu’à l’erreur », tellement pris par les merveilles de la théorie des prix qu’il ne comprenait pas pourquoi sa rencontre avec le général responsable d’un coup d’État militaire, de la torture et de la disparition de les dissidents pourraient avoir un aspect hideux.
Burns veut également le sauver des critiques qui affirment que le « traitement de choc » qu’il a préconisé prouve un lien essentiel entre le capitalisme et la coercition. « Empiriquement, le nombre de victimes de la dictature de Pinochet était sans commune mesure avec les millions de morts dans les régimes communistes de type stalinien », écrit Burns, recourant à un surprenant « whataboutisme ». « C’était une sorte de tour de passe-passe orwellien, accusant le capitalisme de prendre en compte les péchés mêmes qui étaient si profondément ancrés dans le projet communiste. »
La dernière fois que j’ai vérifié, il était possible que quelqu’un abhorre les régimes de Staline et Pinochet. Mais Burns, même s’il déplore les « angles morts et les imperfections » de Friedman, semble déterminé à le décrire comme un personnage généralement bien intentionné, mais parfois inconscient. À la fin de son livre, elle se permet de regretter ce qui aurait pu être : « Imaginez les forces du républicanisme modéré soutenues par l’intellect de Friedman ! » Elle n’explique jamais exactement en quoi cette idylle différerait de l’ordre néolibéral déréglementé qui prévalait dans ce pays jusqu’à récemment.