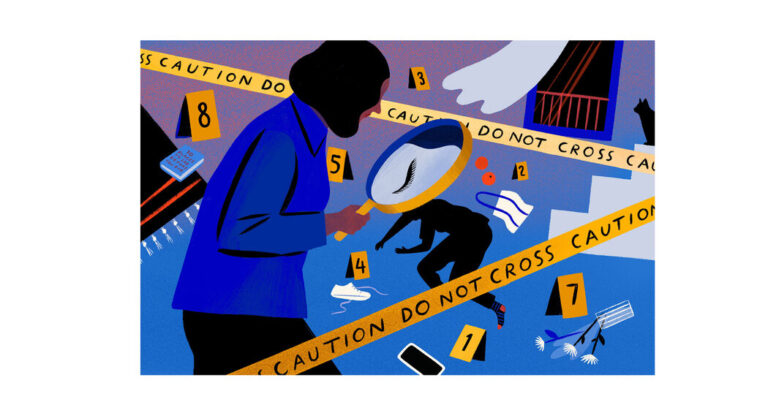Critique de livre : « Le banquet annuel de la guilde des fossoyeurs », de Mathias Énard
Pour apprécier pleinement ce que Mathias Énard prépare dans son nouveau roman, « Le banquet annuel de la guilde des fossoyeurs », il est utile de connaître le génie littéraire français du XVIe siècle François Rabelais et son chef-d’œuvre de débauche en cinq volumes, « Gargantua et Pantagruel. Conte de géants qui parcourent la campagne française après avoir bu des aventures et bouleversé les normes sociales, l’œuvre de Rabelais a été une source de rire dans une grande partie de l’histoire littéraire occidentale, inspirant les écrivains pendant des siècles, même si de nos jours, il est probablement plus mentionné que lu.
Aux États-Unis contemporains, au moins, l’héritage de Rabelais persiste principalement dans les travaux du théoricien littéraire russe Mikhaïl Bakhtine, dont l’étude de 1965 « Rabelais et son monde » a introduit des concepts encore populaires dans la critique littéraire et artistique. « Carnivalesque », « grotesque », « dialogique » : chaque fois que nous parlons d’un art qui transgresse les frontières, bouleverse joyeusement les hiérarchies, prône la multiplicité plutôt que l’autoritarisme et célèbre l’abondance de l’esprit humain, nous sommes entrés au pays de Rabelais.
David Mazon, l’anthropologue de 30 ans au centre du « Banquet annuel de la guilde des fossoyeurs », est également entré au pays de Rabelais, de bien plus de manières qu’il ne l’imagine. Ayant déménagé à la campagne grâce à une bourse universitaire pour étudier la culture régionale française, il note dans son journal qu’il « a franchi la frontière de la Vendée et s’est retrouvé sur une île, où… se trouvait… l’abbaye qui a inspiré Rabelais ».
Il se trouve qu’il a apporté avec lui un exemplaire de « Gargantua et Pantagruel », qu’il avait l’intention de lire, mais lorsqu’il le ramasse ivre ce soir-là, il s’avère « assez inintelligible ». C’est un jeune homme comiquement égocentrique, plus absorbé par ses propres idées que par l’apprentissage de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d’autre.
Le journal de Mazon continue alors qu’il s’installe et commence à étudier la population locale. Les personnages qu’il rencontre sont beaucoup plus modernes et sophistiqués que prévu, mais une fois surmonté sa déception, il découvre qu’il aime réellement vivre à la campagne.
À ce stade, le roman se lève de table et traverse la pièce, abandonnant Mazon et son journal non seulement pour d’autres histoires, mais pour différents modes de narration, parcourant des siècles d’histoire du village et de la région environnante.
Vient d’abord une « chanson » de quatre pages, comme l’appelle Énard, qui se déroule au XIXe siècle et qui raconte l’engouement d’un cordonnier pour une jeune femme et sa mort subite. Puis la portée s’élargit radicalement à mesure que nous entrons dans un long récit lyrique de la transmigration des âmes de tous les citadins et de toutes les différentes vies qu’ils ont vécues.
Il y a Lucie, agricultrice et militante pour le climat, ancienne victime protestante de Louis XIV et soldat français pendant la Première Guerre mondiale. Il y a le père Largeau, un abbé sexuellement inhibé dont l’âme, à sa mort, entre dans un sanglier et finalement arrive à copuler (avec une truie). Il y en a au moins une douzaine d’autres, des âmes migrant d’avant en arrière dans le temps, leurs histoires arrivant trop vite pour qu’une vie individuelle puisse occuper notre attention très longtemps, de sorte que la véritable histoire devient l’histoire, la fluidité du temps, les pouvoirs démocratisants du la mort et – à travers un mélange de philosophies bouddhistes, chrétiennes et islamiques – le fouillis cyclique de la vie.
C’est Énard à son meilleur, évoquant le parcours historique érudit de son premier roman de 2008, « Zone », qui a remporté de nombreux prix français bien qu’il soit écrit en une seule phrase de 500 pages, et de son roman « Boussole » de 2015, qui a remporté le prix. Prix Goncourt et a été sélectionné pour le Man Booker International Prize.
Ensuite, nous obtenons une autre « chanson » et un autre épisode des histoires de transmigration. Le livre s’est désormais imposé comme ce que Bakhtine appelait un « roman carnavalisé », caractérisé par le franchissement fluide des frontières et la juxtaposition impétueuse des genres (la traduction de Frank Wynne est digne d’un prix pour la facilité avec laquelle elle passe de l’un à l’autre) quand soudain Rabelais refait surface pour la pièce maîtresse, un hommage de 77 pages à « Gargantua et Pantagruel ».
C’est la tournure la plus surprenante du roman, la plus ambitieuse et, du moins pour moi, la plus faible. Lecteurs peu familiers avec le classique de Rabelais se demander pourquoi ils ont été soudainement sortis d’une réalité déjà fluide et plongés dans un spectacle de grande farce de toasts drôles, de récitations pompeuses de philosophie classique, de nourriture incroyablement excessive et de blagues vulgaires, tandis que les amoureux de Rabelais peuvent être déçus que tout cela soit pas assez drôle, pompeux, excessif et vulgaire.
De l’autre côté de cette pièce maîtresse, le roman se reflète, revenant en ordre inverse à travers ses différents récits, revisitant leur variété stylistique et complétant leurs histoires. Au moment où nous arrivons dans le journal de Mazon, beaucoup de choses se sont passées. La vie de Mazon a été bouleversée et en tant que personne, il a grandi et changé. Il y a un sentiment de mélancolie partagée, le sentiment d’être arrivés ensemble au terme d’un voyage, même si le voyage de Mazon s’est déroulé principalement loin de nous, dans l’espace entre les entrées du journal, alors que nous partions dans un monde beaucoup plus fantastique, historique, existentiel et voyage résolument non conventionnel.