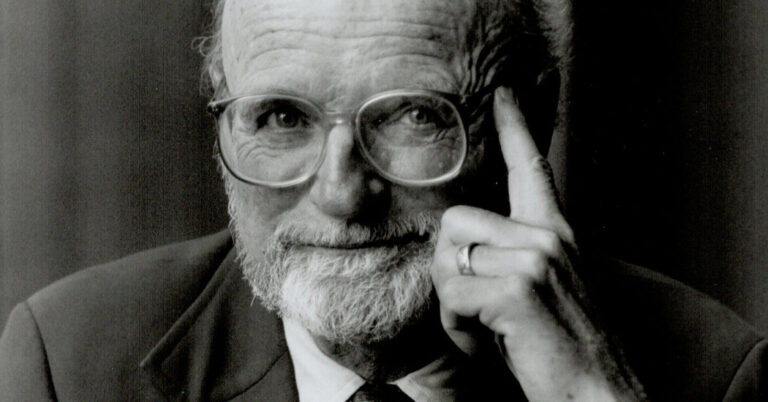Critique de livre : « August Blue », de Deborah Levy
Dans l’œuvre de Deborah Levy, certains éléments reviennent dans des arrangements toujours nouveaux : la nage, les fruits de mer, les abeilles et le silence ; rupture et récupération; le patriarcat. Ces thèmes sont si cohérents dans le corpus diversifié d’écritures de Levy, qui comprend de la poésie, des pièces de théâtre, des mémoires et des romans (dont deux ont été finalistes du Booker Prize), que son véritable médium pourrait être appelé recomposition.
Dans le dernier roman de Levy, « August Blue », c’est la recomposition musicale qui devient la métaphore manifeste, et parfois trop consciente, de la révolte et de la réinvention féminines. Avec des références aux premiers coups et aux verrouillages intermittents, l’histoire semble se dérouler en 2021 et capture quelque chose du réveil étourdi du moi social pendant cette période de démasquage progressif, alors que le monde s’acheminait vers une résilience vaccinée. Mais avec des touches peu convaincantes de réalisme magique apposées sur une caricature de la scène musicale classique, la dernière version de Levy sur l’agonie et l’agence des femmes dans un monde patriarcal se lit moins comme un roman et plus comme un manifeste cloué à un complot branlant.
La protagoniste de « August Blue » est une virtuose britannique d’une trentaine d’années qui vient de faire une dépression nerveuse au milieu d’une représentation du Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov à Vienne. Pendant un peu plus de deux minutes, elle est sortie du scénario, jouant de la musique qui lui est venue sans y être invitée, avant de quitter la scène. Soudain inemployable, la célèbre pianiste entre dans une période d’introspection alors qu’elle voyage entre Athènes, Londres, Paris et la Sardaigne ; donne des cours particuliers; a des flashbacks sur un traumatisme d’enfance enfoui ; et entretient des conversations imaginaires avec un mystérieux sosie qu’elle a repéré pour la première fois en Grèce.
Dans un marché aux puces d’Athènes, cette autre femme s’est emparée de deux chevaux de danse mécaniques que le pianiste voulait aussi. Les chevaux jouets, qui caracolent en cercle lorsque leur queue est relevée, étaient les derniers de leur espèce, et le pianiste devient obsédé par l’idée de revoir les chevaux et leur nouveau propriétaire. Alors qu’elle chasse ce qui pourrait être des aperçus hallucinants du sosie à travers l’Europe, elle se met à porter le chapeau trilby que la mystérieuse femme a laissé tomber au marché.
En effet, la pianiste tentera plusieurs casquettes au cours de l’histoire, en tant que fille, jumelle et mère porteuse de ses élèves. Enfant, elle a été élevée par une famille d’accueil avant d’être adoptée par un pianiste et pédagogue légendaire aujourd’hui malade. Le monde lui a montré quoi elle est – une prodige – mais avant de pouvoir jouer à nouveau, elle doit découvrir OMS elle est.
Même son nom, Elsa M. Anderson, est l’invention de son professeur : sur ses papiers d’adoption, elle était Ann. Les lecteurs avec enfants se souviendront des sœurs Elsa et Anna – l’une glacialement brillante, l’autre douloureusement empathique – dans «Frozen» de Disney, basé sur un conte de fées d’Andersen. Ici aussi, une héroïne doit exploiter ses pouvoirs, faire face à son ombre et apprendre à lâcher prise.
Si un conte de fées a besoin d’un méchant, Levy en trouve un sous la forme de l’industrie de la musique classique, qui, selon le stéréotype commun, produit des praticiens rabougris créatifs condamnés à exécuter des textes écrits par d’autres. (D’une manière ou d’une autre, ce préjugé n’est jamais imposé aux acteurs.)
Pas étonnant qu’Elsa soit attirée par ces chevaux mécaniques. Elle aussi devrait exécuter des tours en appuyant sur un interrupteur. Même ses mains sont une marchandise : elles sont assurées par une police qui dicte ce qu’elle peut en faire.
Le chef d’orchestre de la pièce de Rachmaninov est un tyran. Quand Elsa s’écarte de la partition, il affiche son exaspération, « faisant tourner sa baguette en cercle près de ses oreilles, se tapotant la tête avec la baguette, haussant les épaules de désespoir, faisant rire le public ».
Dans le monde réel, les trous de mémoire en musique sont monnaie courante. Les interprètes affectés truquent généralement quelques mesures jusqu’à ce que la mémoire musculaire s’enclenche; des chefs d’orchestre chevronnés chercheront à aider un soliste en difficulté. Mais il n’y a rien de collaboratif dans la musique dans le roman de Levy, et cela ne semble jamais concerner la communication avec un auditeur. Elsa nous dit que c’est le chef d’orchestre pour qui ses mains « refusent » de jouer.
Le lien entre cette scène de concert sans âme et le climat plus large de masculinité toxique est explicite. Quand les hommes complimentent l’apparence d’Elsa, ils disent des choses comme « Tu es une machine à tuer en bikini ». A Paris, un touriste à une table voisine lui dit qu’il veut la lécher. Un peu plus tard, le même homme brandit le téléphone portable qu’elle a laissé dans le café et l’agite avec taquinerie « comme s’il dirigeait un orchestre imaginaire ». Lorsque l’ami parisien d’Elsa lui fait lâcher prise en tapant du pied, il lance des insultes aux deux femmes. « Nous étions pédés, nous étions des monstres, nous étions juifs » – le touriste doit être allemand, bien sûr – « nous étions des sorcières, nous étions moches, nous étions folles. La même vieille composition.
Les élèves adolescents d’Elsa doivent également faire vibrer les mesures de la musique qui leur est assignée. Le non-binaire Marcus préférerait danser une imitation d’Isadora Duncan à Schubert plutôt que d’apprendre la musique. Cela exaspère le père, qui traite son enfant de « petit homme ». « Il semblait, » réfléchit Elsa, « leur père avait déjà écrit la composition de son enfant. » Aimée, quant à elle, confie à son professeur lors de leur deuxième cours qu’elle a été agressée par le médecin de famille. Quand Elsa essaie de parler à la mère de la fille, il est clair qu’elle ne s’intéresse qu’aux notes de musique produites par sa fille, pas à ses paroles.
Alors qu’Elsa dérive à travers l’Europe et que des souvenirs bouillonnent dans le silence qui s’est abattu sur sa carrière, il devient clair qu’elle doit accepter sa lignée enchevêtrée avant de pouvoir écrire sa propre partition – la nouvelle composition qui s’est d’abord insinuée en elle. doigts pendant le concert à Vienne.
En cours de route, le livre offre un aperçu du talent de Levy en tant que styliste. Elle peut esquisser une scène avec quelques coups de pinceau précis et évoquer l’émotion à partir d’un espace blanc sur la page. Un appel et une réponse récurrents entre Elsa et son alter ego deviennent un refrain musical qui prend des couleurs toujours nouvelles. Ces références familières à la natation et aux abeilles transparaissent comme des leitmotivs.
Pour un auteur si déterminé à démanteler les stéréotypes, il est dommage que Levy esquisse le sien avec une plume aussi épaisse. Le défi de l’authenticité dans l’art, quel que soit son genre, est un beau sujet : Miles Davis a dit un jour qu' »il faut beaucoup de temps pour ressembler à soi-même ».
Mais l’improvisation ne figure pas dans le rétablissement d’Elsa, bien que compte tenu de l’affinité de Levy pour les métaphores aquatiques, il aurait été agréable de la voir riff sur le concept de flux. Avec Elsa testant tant d’identités, elle aurait pu développer un ensemble de variations pour piano plutôt que de s’écraser sur un concerto.
Le roman de Levy est finalement plus un règlement de comptes qu’une liberté de création. En ce sens, la pièce qui jette Elsa la prodige et donne naissance à Elsa la compositrice devait sans doute être la Seconde de Rachmaninov : un cheval de bataille du répertoire.