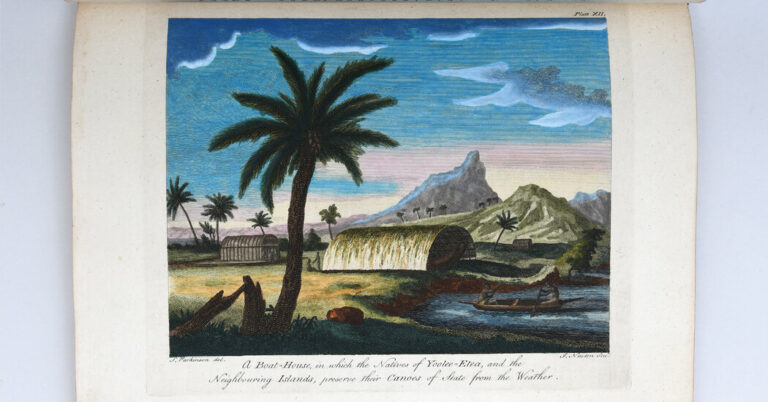Nouveaux livres sur les armées non européennes
L’un des avantages de l’étude des histoires militaires de groupes non européens est qu’elle nous rappelle qu’il existe des moyens très différents de faire la guerre, ainsi que des raisons de le faire.
Dans : (), Wayne E. Lee soutient que le style de guerre fluide et amérindien était assez étranger aux soldats européens qui l’ont rencontré. Des tribus comme les Tuscarora et les Cherokee ont évité les batailles et les sièges conventionnels, menant plutôt ce que Lee appelle « la conquête par le harcèlement » – des campagnes dispersées d’embuscades et de raids, qui pourraient durer des années. Ils voyageaient souvent légers, se nourrissant de maïs desséché complété par des chasses occasionnelles, et combattaient en formations lâches qui récompensaient l’initiative individuelle et l’adresse au tir.
Les objectifs de leurs guerres étaient également différents, affirme Lee, professeur d’histoire militaire moderne à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Nous avons tendance à considérer les guerres comme des guerres visant à conquérir des peuples, à les contrôler et à occuper leurs terres. Mais les Amérindiens menaient souvent la guerre non pas pour coloniser un territoire mais pour le défricher. Plus précisément, ils visaient à éloigner les autres tribus des terrains de chasse privilégiés et à y détenir un accès exclusif.
La faiblesse de la méthode de guerre indienne était qu’elle était difficile à opérer en continu, un fait que les ennemis européens ont exploité. À leur tour, les combattants amérindiens ont compris que la principale vulnérabilité des expéditions militaires britanniques, espagnoles et françaises résidait dans leurs longues lignes de ravitaillement.
Être bon en conquête n’est pas seulement une question de logistique et de tactiques de combat. Les combattants anti-« réveillés » d’aujourd’hui au Congrès seraient probablement surpris par les propos perspicaces de l’anthropologue de l’Université de Boston, Thomas Barfield. Barfield conclut que l’une des clés de la réussite d’un empire réside dans la gestion de la diversité sous toutes ses formes – ethnique, religieuse, culturelle, géographique et économique. « Les empires n’étaient pas seulement à l’aise avec la diversité, ils y prospéraient », écrit-il.
Le califat omeyyade du VIIIe siècle, par exemple, s’étendait de l’Espagne à l’Asie centrale, des régions qui n’avaient jamais été soumises au même régime politique auparavant. Dans une analogie intéressante, Barfield écrit que les Omeyyades dirigeaient un « empire de la franchise », un peu comme McDonald’s, dans lequel les gouverneurs locaux, ou franchisés, étaient libres d’« adapter les coutumes locales tant qu’ils maintenaient des points communs de base ».
Barfield concentre son récit imaginatif de l’histoire mondiale sur les domaines qui ont dominé le territoire eurasien pendant des siècles, en particulier les empires chinois, romain et perse. Parmi ces trois, son préféré est le système persan. D’une part, ils ont mieux géré la succession des dirigeants ; de nouveaux dirigeants émergèrent parmi la royauté, mais il n’y avait pas de file d’attente stricte pour le trône. Cet équilibre, affirme-t-il, a empêché la domination perse « de devenir si insulaire et si étrangère au monde qu’elle ne pouvait plus gouverner efficacement, comme cela se produisait souvent en Chine, mais a évité les guerres civiles brutales qui affaiblissaient périodiquement l’Empire romain ».
En outre, dit-il, les Perses étaient si efficaces en matière d’administration, depuis les services postaux jusqu’à la collecte des impôts, que même après la chute de leurs empires, leurs conquérants ont maintenu les structures administratives en place, sous la direction de fonctionnaires de langue persane.
Mais bon nombre de ces empires possédaient une vulnérabilité commune, constate Barfield : ils ont été essentiellement construits pour contrôler les sociétés agraires et ont été incapables de s’adapter à la révolution industrielle et à la montée du capitalisme.
Barfield conclut en tournant cette analyse vers les grandes puissances d’aujourd’hui. La République populaire de Chine, dit-il, ressemble à une imitation encore plus précaire des anciens empires agraires qui collectaient des revenus auprès des paysans et ne leur donnaient en retour que le strict minimum : la sécurité et la stabilité, mais aucune voix politique. Le pays, écrit-il, en essayant de supprimer les groupes ethniques non-Han, a hérité de « la base territoriale des Qing mais pas de sa vision cosmopolite ».
Il est très pessimiste à l’égard de la Russie, qui, selon lui, fonctionne comme s’il s’agissait du Grand-Duché médiéval de Moscovie mais armée d’armes nucléaires. Il suggère que Vladimir Poutine pourrait conduire son pays vers une nouvelle version de la période de troubles anarchique et ravagée par la famine qui a sévi dans l’Empire russe de 1598 à 1613.
Barfield est un expert de l’Afghanistan, ce que Ian Fritz, qui a servi comme linguiste de l’US Air Force dans ce pays, ne l’est clairement pas. Je voulais aimer celui de Fritz. En effet, il s’agit d’un ajout intéressant, quoique décalé, à la bibliothèque croissante de soldats américains qui ont combattu là-bas et ont écrit des mémoires amères, comme le plus éclairant « Un-American » d’Erik Edstrom. C’est le genre de livres que les jeunes hommes écrivent lorsqu’ils se rendent compte que leur empire les a envoyés tuer sans se soucier des effets que cela aura sur ceux qui sont tués ou sur ceux qui tuent. Le résultat, rapporte Fritz, est une « rage incandescente ».
Le livre est parfois vivant mais finalement décevant. Le titre même est trompeur. J’avais espéré apprendre de ce livre comment les talibans combattaient. Mais l’ennemi en Afghanistan n’a pas dit grand-chose à Fritz, sauf qu’il ne voulait pas de lui là-bas. Fritz est entré dans le pays intelligemment mais avec peu d’informations sur sa population ou son histoire, et en est ressorti à peu près de la même manière, malgré d’interminables heures d’écoute des communications radio des talibans au cours de ses deux déploiements là-bas. « Je ne savais pas grand-chose des hommes que j’écoutais, pas vraiment », se rend-il compte.
Surtout, la guerre le rendait fou. Comme il le dit : « Ma conscience a explosé. » Mais cela ne signifie pas que Fritz ait développé une compréhension de la guerre ou de la nation. Il déclare par exemple que « l’Afghanistan en tant que pays n’est guère plus qu’un conte de fées » construit par le colonialisme occidental, ce qui est tout simplement incorrect. Les racines de la nation remontent au moins au XVIIIe siècle, et sans doute à Mahmud de Ghazni – le premier dirigeant à être un « sultan » – vers le début du XIe siècle.
Finalement, il quitte l’armée, va à l’université puis à la faculté de médecine, mais choisit de ne pas pratiquer la médecine, une décision qu’il n’explique pas vraiment. Par inadvertance, ses mémoires reflètent la guerre américaine en Afghanistan, qui équivalait à une expédition impériale exécutée de manière incompétente, voire négligente, et certainement sans la compréhension culturelle et historique tant appréciée par les empires prospères.