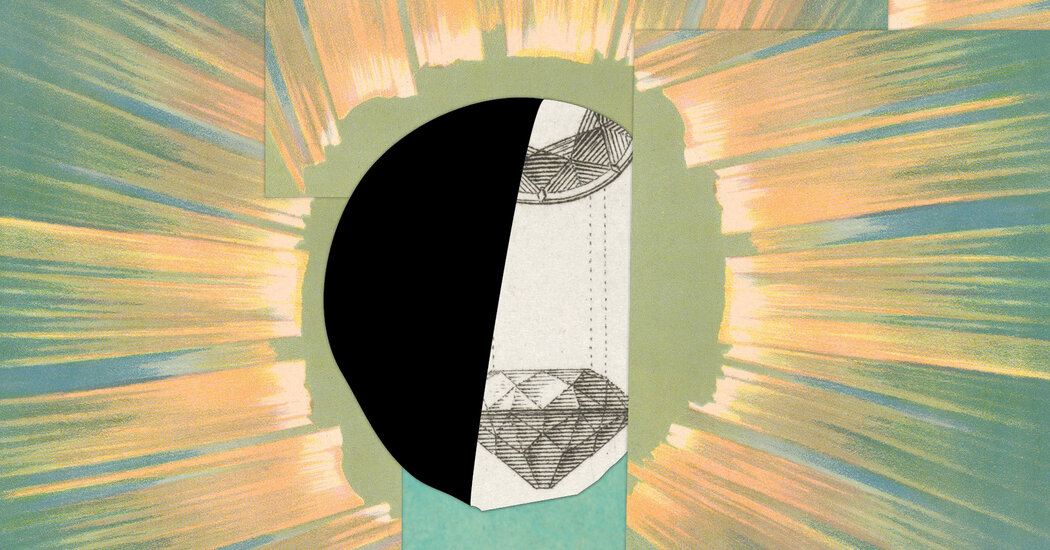Critique : Nouveaux livres internationaux en traduction
Fiston Mwanza Mujila, l’auteur congolais primé de « Tram 83 », écrit des romans et de la poésie qui évoluent sur un rythme contagieux et syncopé. Son dernier ouvrage se délecte particulièrement de cet esprit. Dans le Zaïre des années 1990, où le règne de Mobutu Sese Seko touche à sa fin, la survie est en soi une tâche complexe. Les boîtes de nuit de Kinshasa sont bondées, les rues grouillant d’adolescents en fuite et de rumeurs d’insurrection. Juste de l’autre côté de la frontière, dans un Angola déchiré par la guerre civile, les mines de diamants attirent les rêveurs qui s’enrichissent.
Tous les personnages ont leurs propres dilemmes à résoudre : Sanza, qui est tombé dans un gang de rue renifleur de colle ; Molakisi, désireux de se réinventer en Angola ; Franz, écrivain autrichien qui passe plus de temps au Mambo de la Fête qu’à travailler sur son roman « africain ». Les intrigues et les vendettas zigzaguent et finissent par se croiser. Tout au long du livre, les voix des enfants font entendre certaines des notes les plus convaincantes. « Nous avons fait l’expérience de la rue – la colle, les rivalités avec les gangs adverses, la pluie, les embrouilles avec les soldats – et pourtant les gens ont toujours insisté pour nous imposer l’étiquette pompeuse et morne d’enfant », déplore Sanza.
L’énergie frénétique de Mujila est capturée dans un langage ravissant par Roland Glasser, traduisant du français. Rappelant les romans réalistes et exubérants du Sud-Africain Zakes Mda (« Ways of Dying ») et du Congolais Alain Mabanckou (« African Psycho »), Mujila a donné vie à un récit fiévreux sur la classe populaire africaine, dont les revendications — comme celles de l’auteur — il est difficile de résister. Comme le remarque un personnage : « Nous voulons la réalité, les mines, la colle, la danse du méchant ! »
Si « The Villain’s Dance » est immergé dans la réalité congolaise, celui de Balsam Karam – bien que soucieux également des marginalisés et des ignorés – reste à distance de son matériau.
Dans une ville côtière sans nom, les enfants se rassemblent dans les ruelles étouffantes et les terrains abandonnés, loin des touristes qui affluent dans les cafés du bord de mer. Les jeunes et leurs familles sont des migrants venus d’un pays étranger en difficulté, ne sachant pas comment s’orienter dans ce nouveau monde. Des jeunes femmes disparaissent – peut-être enlevées –, notamment une fille simplement appelée la Missing One. Sa mère la cherche désespérément partout, tandis que sa grand-mère veille tranquillement : « D’ici, elle voit le mouvement de la perte et ne sait pas quoi faire ; elle le voit tout le temps et le craint alors qu’elle est assise là, à surveiller la ruelle.
Karam – qui est d’origine kurde et a déménagé en Suède alors qu’il était un jeune enfant – a l’œil pour les changements de perspectives poignants. L’histoire d’une mère à la recherche de sa fille est parallèle à celle d’une visiteuse, elle-même ancienne réfugiée et future mère, aux prises avec sa propre histoire de déplacement. Les deux récits se réfractent puis se rejoignent dans une convergence poétique. Il y a un ton obsédant et feutré dans le roman, parfaitement évoqué par la traduction suédoise de Saskia Vogel, qui sonde les effets désorientants de l’exil. Comme l’écrit Karam à propos de la mère du disparu : « Les distances intérieures sont plus grandes – entre mémoire et mémoire et d’expérience en expérience, le temps ne passe plus et la femme ne sait pas où elle est ni pourquoi. »
Le premier recueil de nouvelles de l’écrivaine bolivienne Liliana Colanzi, dans une traduction vivante de Chris Andrews, est un étrange mélange de familier et d’irréel. Les histoires se déroulent dans des grottes préhistoriques et des villages paysans, mais mettent également en scène des centrales nucléaires, des voyages interstellaires et des drones.
Colanzi écrit avec un sentiment de menace sur les affrontements de pouvoir dans un paysage qui ressemble souvent à l’Altiplano bolivien. Ses personnages parlent des versions espagnole et aymara et sont préoccupés par les menaces à la fois réelles et imaginaires (les radiations, le poison, le diable). L’histoire principale, basée sur un accident radiologique survenu au Brésil en 1987, prend une dimension surnaturelle entre les mains de Colanzi. Les citoyens locaux, engloutis par « la lueur de la mort, la phosphorescence du péché », doivent réfléchir à la signification existentielle de cette catastrophe contre nature.
Dans une autre histoire, « The Narrow Way », des sœurs adolescentes rêvent d’échapper au culte religieux de leur père ; ils sont retenus captifs dans un complexe où « au-delà du périmètre se trouve la jungle avec ses ombres, et au-delà, la ville avec ses illusions ». Un « collier d’obéissance » les empêche de traverser un champ magnétique qui délivre des chocs de plus en plus puissants. Vont-ils un jour connaître la liberté, et quelles en seront les conséquences ?
Comme d’autres écrivains latino-américains comme Samanta Schweblin, Fernanda Melchor ou Mónica Ojeda, Colanzi cherche à mélanger les genres (horreur, cyberpunk, fiction littéraire). Sa réalité est déformée, oscillant entre un passé violent et un futur effrayant, où la chaleur et les radiations toxiques – et le babillage des voix intérieures – se combinent pour créer une vision hallucinatoire.
Les histoires de l’écrivain cachemirien Hari Krishna Kaul, en revanche, sont fermement ancrées dans son pays contesté de la fin du XXe siècle. Kaul, décédé en exil en 2009 à l’âge de 75 ans, a laissé une œuvre complexe qui se résume à des portraits sournois et détaillés de la vie domestique sur fond de tensions religieuses et politiques.
Mais même lorsque les récits de Kaul se concentrent sur le banal, des lignes de fracture s’ouvrent. Plusieurs histoires de sa collection impliquent des épisodes écrasants de solitude et de désespoir, souvent provoqués par l’isolement des couvre-feux et des avalanches. « Pour l’instant, il fait nuit. Pour l’instant, il fait sombre. Pour l’instant, il fait froid. Dans cette obscurité et ce froid, je suis seul », reflète un personnage confiné à la maison dans l’histoire principale. Dans « Demain – Une histoire sans fin », les choses prennent une tournure surréaliste alors que deux garçons redoublent leur classe d’école primaire pendant des décennies, sans parvenir à vieillir à mesure que la ville qui les entoure se transforme.
« Pour l’instant, c’est la nuit » est une récupération passionnante – et bienvenue – de la fiction de Kaul par une équipe de quatre traducteurs (dont sa nièce, Kalpana Raina). L’œuvre de Kaul scintille de questions sur la réalité et l’illusion, le foyer et l’exil. «Tout comme le trafic bloqué qui avait commencé à circuler», pense un Cachemirien à la dérive à Delhi dans «A Moment of Madness», «sa vie stagnante serait revitalisée s’il s’autorisait à repenser au Cachemire.» Mais comme Kaul nous le rappelle, ce n’est jamais aussi simple. « Une personne peut marcher ou prendre l’avion », réfléchit plus tard le personnage, « mais une destination peut-elle un jour être atteinte ? »