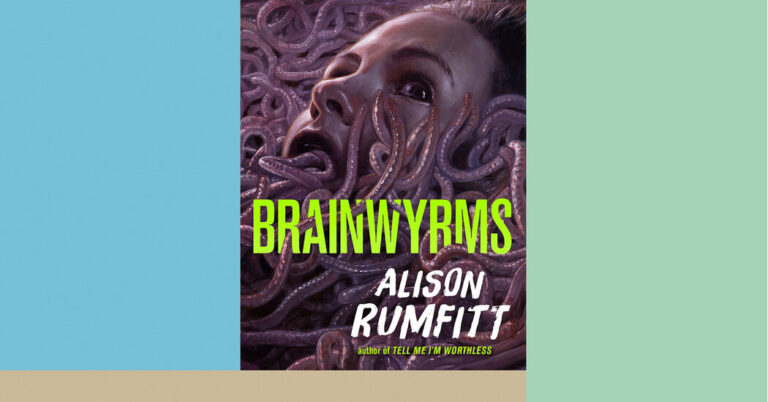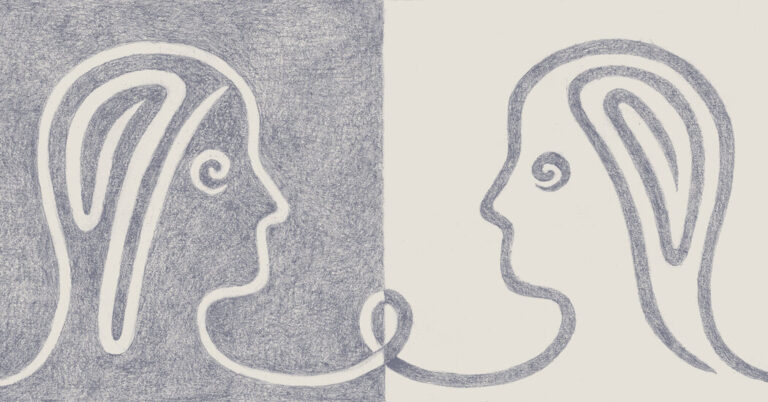Critique de livre : « Yellowface », de RF Kuang
Si cela se lit comme une critique assez directe des conversations contemporaines sur la race et l’appropriation, c’est parce que c’est le cas. Ce n’est pas un livre subtil. C’est en fait si évident qu’on se demande pourquoi Kuang utilise l’artifice d’un narrateur peu fiable. Je n’arrêtais pas de m’attendre à ce que tout le roman se transforme en quelque chose de plus élaboré, de plus complexe – de devoir faire correspondre June, de la surprendre en train de mentir dans un mensonge, de faire l’expérience d’une sorte de révélation à partir d’une accumulation de preuves. Au lieu de cela, la méthodologie de June consiste systématiquement à dire au lecteur ses offenses et à leur offrir des justifications fragiles.
Le livre est plus excitant et efficace quand il y a un grain à lire. June se présente comme une érudite compétente, mais lorsqu’elle fait des références classiques ou philosophiques, ce sont des lectures maladroites ou erronées (confondre les ménades avec les naïades lorsqu’on parle d’Orphée, par exemple) ; elle se présente comme une bonne écrivaine, mais les quelques extraits que l’on voit de sa prose, distincte de celle d’Athéna, sont chargés de clichés. Sa relation avec Athéna et le travail d’Athéna est le site de la plus grande ambiguïté, où elle révise le plus brutalement les déclarations précédentes ou passe sous silence les contradictions au service de sa propre expérience : au début, June prétend que la vie d’Athéna était parfaite, mais révèle plus tard, tout en traversant une tempête sur les réseaux sociaux. , qu’Athéna a reçu des menaces de mort et du vitriol pour avoir fréquenté un homme blanc. Ces moments suggèrent les types de couches et d’intrigues que le livre aurait pu maintenir s’il n’était pas si déterminé à montrer sa main.
Cette évidence n’est pas nécessairement un défaut, mais elle est déroutante. Un narrateur peu fiable déstabilise un texte, attirant notre attention sur la manière dont nos protocoles de lecture leur accordent un certain degré d’autorité sans trouble. Cela ne se limite pas non plus à la fiction en prose: les trois dernières années ont vu une série de discours sur Art Monster enracinés dans les ambiguïtés et les subjectivités de la paternité et la question de savoir à qui une histoire peut légitimement appartenir. Désaccords sur le fond de « Tár » ; la frénésie autour de l’article de magazine de Robert Kolker « Who Is the Bad Art Friend? »; la question de savoir quelle histoire est vraiment racontée dans la nouvelle « Cat Person » de Kristen Roupenian — ces conflits sondent les frontières poreuses entre l’art et la vie et alimentent des vagues de fascination et de dégoût sur les réseaux sociaux. « Yellowface » est une sorte d’histoire d’Art Monster, mais qui ne peut laisser place à l’ambiguïté ou à la révélation sans se précipiter pour remplir cet espace.
Quand « Yellowface » est une satire, je veux qu’elle soit plus nette ; quand c’est de l’horreur, je veux que ce soit plus effrayant ; quand c’est une histoire de fantômes, je veux que ce soit plus obsédant ; quand il évoque une relation vampirique, parasitaire, je veux qu’il soit plus invitant, plus ambigu, plus étrange. Au lieu de cela, toute sa fluidité de genre est au service de la même franchise brutale. Peut-être que l’ironie ultime du livre est ce qu’il a en commun avec son protagoniste : comme June elle-même, « Yellowface » semble désespérée de ne pas être mal comprise.