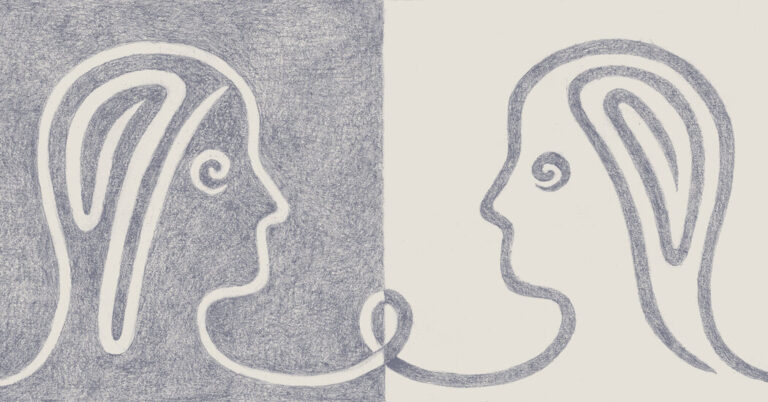Critique de livre : « Sun House », de David James Duncan
Les romans précédents de Duncan, « The River Why » (1983) et « The Brothers K » (1992), étaient des best-sellers contre-culturels, parcourant des sujets tels que la pêche à la mouche, le baseball, la guerre du Vietnam et, inévitablement, la quête spirituelle. « Sun House », qui aurait 16 ans de préparation, surpasse même les 645 pages de « Brothers K. » Il consacre environ 350 pages aux histoires de ses personnages – un alpiniste, un chanteur folk « bardique », un acteur, une rock star, un restaurateur, des cow-boys assortis – puis 400 pages à la culture de légumes, à l’élevage de bétail , buveurs de whisky, communauté «spirituellement éveillée» qu’ils établissent dans la vallée des montagnes fictives d’Elkmoon.
Leur refuge de 4 000 acres a été violé par une multinationale diabolique qui tente de construire un complexe de luxe, le Brokeback Ranch & Country Club, dont la société vole sans vergogne le nom à Annie Proulx. Les Elkmooners, « avec foi dans la régénération naturelle et aucun désir de réaliser un profit rapide », mettent en commun leurs ressources pas si modestes (750 000 $ ici, 400 000 $ là-bas, et bientôt vous parlez d’argent réel) pour guérir le vallée et commercialiser de la viande bovine issue d’animaux abattus avec amour.
Cette idylle éco-capitaliste connaît un revers temporaire lorsqu’un jeune communard végétalien sabote l’opération ; certains Elkmooners veulent qu’elle soit arrêtée, mais ils se contentent de la soumettre à une rééducation sévère, aboutissant à la contrition et à une bouchée de steak pénitentielle. « Je veux goûter le corps et le sang », leur dit-elle. Cet épisode, un incendie de forêt, un sauvetage à haute altitude et une scène de mort prolongée – avec beaucoup de bourdonnement communautaire et un colibri trop commodément piégé et relâché – remplit l’exigence romanesque conventionnelle selon laquelle les choses se passent, bien que rien de tout cela ne corresponde tout à fait à une intrigue conventionnelle.
De toute évidence, Duncan – ou son narrateur à la première personne, connu uniquement sous le nom de Holy Goat, ou «HG» – n’aspire à rien d’aussi réfléchi. « L’histoire millionnaire » de la communauté « est indicible, et quel soulagement ! » il écrit. « Maintenant, moi, la Chèvre Sainte, je peux me tourner vers tout ce que j’aimerais le plus raconter. » Il s’agit en fait d’un autre personnage qui met des mots dans sa bouche, mais peu importe : HG considère ses personnages comme ses co-auteurs, et tout le roman fait preuve d’une méthodologie let-‘er-rip.
Une Elkmooner nommée Risa – la dévote du sanskrit et un parangon improbable de générosité, de perspicacité, d’érudition ésotérique et d’attrait « à dents de gat » – explique à HG pourquoi la vallée ne peut pas être délimitée par la romanisation classique du cerveau gauche qui a créé Mansfield Park. La communauté, dit-elle, « est une fraction infime mais estimable de l’illusion cosmique védique, un fil édenté de Zane Gray en cours de révision féministe et métaphysique… un barrage de poésie allant du vers libre au doggerel de cow-boy aux chants divins des poètes-saints du Maharashtra… à des chants mystiques de la fin du Moyen Âge aux bavardages et chants parfois déchirants de nos propres enfants. Quel genre unique pourrait couvrir tout cela ?