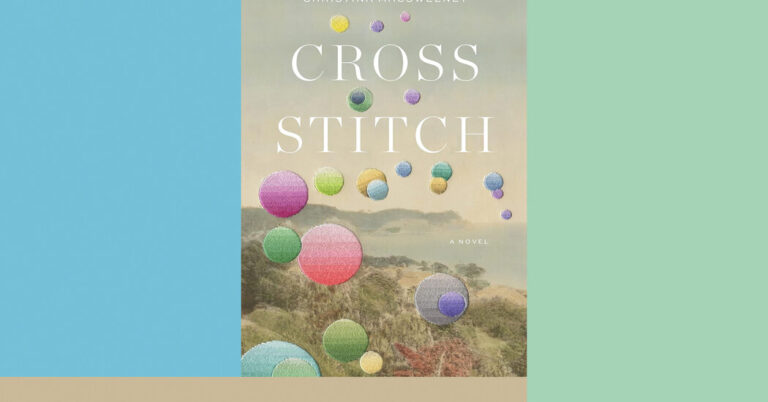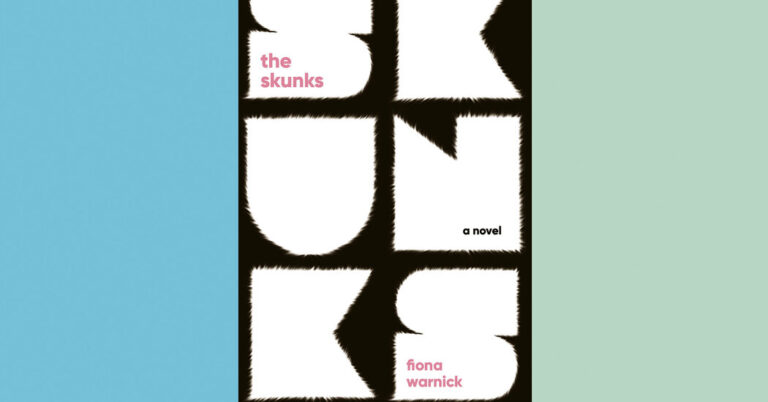Critique de livre : « Nos créatures apparentées », de Bill Wasik et Monica Murphy
En 2007, la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux s'est mouillée les yeux avec des publicités télévisées mettant en vedette la chanteuse Sarah McLachlan. Alors que sa chanson « Angel » jouait en fond sonore, les téléspectateurs ont été confrontés à un défilé de désespoir : des images de chats et de chiens négligés et maltraités, certains d'entre eux grièvement blessés. « Serez-vous un ange pour un animal sans défense ? McLachlan a plaidé.
Les publicités ont été un énorme succès, récoltant 30 millions de dollars pour l'organisation malgré le fait que de nombreux téléspectateurs ne pouvaient même pas supporter de les regarder, y compris McLachlan elle-même. «C'était brutal de faire ces publicités», se souvient-elle des années plus tard. « Je ne peux pas les regarder. Ça me tue. »
Dans leur nouveau livre puissant, « Our Kindred Creatures », le journaliste Bill Wasik (éditeur au New York Times) et la vétérinaire Monica Murphy affirment qu'une telle compassion pour les animaux qui souffrent était rare aux États-Unis jusqu'à un « réveil ». à la fin du 19e siècle. Les auteurs – qui ont co-écrit un précédent livre sur la rage – expliquent que ce mouvement a commencé en Angleterre, où le bien-être animal s'est mêlé et a évolué parallèlement à d'autres croisades morales, notamment l'abolitionnisme. Après la fin de l’esclavage aux États-Unis, les militants américains se sont tournés vers d’autres luttes. Le sort des animaux au cours de l’âge d’or a été très révélateur pour certains d’entre eux.
Les histoires de deux hommes fournissent une structure souple au livre. Henry Bergh a eu son moment de conversion en assistant à une corrida à Séville. Bien que consterné par le traitement infligé aux animaux, il n'en était pas moins agité par ce qu'il appelait le « cruelisme », l'effet dégradant d'une telle violence sur les spectateurs, en particulier les enfants. En 1866, il fonde l'ASPCA
George Thorndike Angell a rejoint le mouvement à peu près au même moment. Il lança une publication mensuelle en 1868 et créa plus tard un réseau de clubs éducatifs. Mais sa contribution la plus indélébile a peut-être été la réimpression non autorisée, en 1890, de « Black Beauty », un roman anglais que les auteurs décrivent comme « le bildungsroman d’un cheval de la classe ouvrière ». Il s'est vendu à 371 000 exemplaires aux États-Unis en moins d'un an, ce qui fait des comparaisons avec le roman anti-esclavagiste galvanisant d'Harriet Beecher Stowe, « La Case de l'oncle Tom ».
Les autres personnages principaux de « Our Kindred Creatures » sont, à juste titre, les animaux eux-mêmes, dont la détresse – propagée par leurs défenseurs – matraque la conscience moderne. Prenez, par exemple, les chiens errants abattus dans les rues de New York au XIXe siècle ; s'ils n'étaient pas réclamés à 16 heures un jour donné, ils étaient noyés dans une caisse métallique pouvant en accueillir plusieurs dizaines en une seule immersion. Ou encore les lapins vivants autrefois utilisés dans les cours de médecine, la gorge ouverte pour démontrer le fonctionnement du système nerveux. Et les millions d’oiseaux récoltés chaque année pour leurs plumes, qui ornaient les chapeaux des femmes élégantes.
Wasik et Murphy concluent que l'éveil a atteint son apothéose avec la création du premier cimetière d'animaux de compagnie du pays, en 1896. Il faut toutefois reconnaître que les auteurs ne proposent pas un récit de simples progrès. Ils mettent plutôt en lumière les contradictions internes du mouvement. Bergh, connu pour rôder dans les rues à la recherche d'agresseurs d'animaux, a adopté la flagellation et la bastonnade comme méthodes de châtiment corporel. Des militants comme Caroline Earle White, opposée aux expérimentations sur les animaux de laboratoire, ont retardé les avancées scientifiques visant à sauver des vies humaines. Le taxidermiste William Temple Hornaday, alarmé par la quasi-extinction des bisons, s'est rendu vers l'ouest en 1886 pour les chasser et les exposer au Smithsonian, afin que les générations futures puissent admirer l'espèce.
Le paradoxe le plus frappant est que, même si les Américains ont appris à sympathiser avec certaines de leurs semblables, ils se sont réconciliés avec la pauvreté des autres. Après tout, c'est au cours de l'après-guerre que l'abattage mécanisé du bétail a pris son essor, avec Chicago comme capitale de l'industrie. Ses célèbres (ou notoires) parcs à bestiaux occupaient des centaines d'acres au sud du centre-ville et sont devenus une attraction touristique lors de l'Exposition colombienne de 1893. Wasik et Murphy ont raison de dire que les forces du marché ont aidé les gens qui possédaient des exemplaires de « Black Beauty » à surmonter leur aversion pour le carnage, que ce soit en raison des profits des entreprises ou de la viande bon marché. Mais la dissonance cognitive est tout de même stupéfiante.
Le ton des auteurs est retenu tout au long du livre, mais ils effectuent un pivot difficile – et bienvenu – dans le dernier chapitre. Dans ces pages, ils plaident en faveur d’un « nouveau type de bonté » qui élèverait les animaux destinés à l’alimentation humaine et d’autres espèces maltraitées au rang de nos préoccupations. Aux sceptiques qui insistent sur le fait qu’une telle tâche est trop lourde, Wasik et Murphy rétorquent que « le changement moral fait se produisent, souvent à grande échelle et à une vitesse remarquable. Espérons-le, non seulement pour le bien du bétail, mais aussi pour le bien de toutes les créatures – y compris les humains – qui souffrent de la catastrophe environnementale en cours.