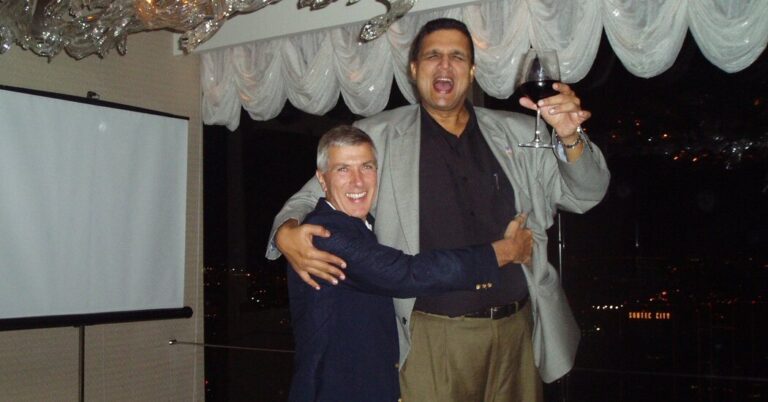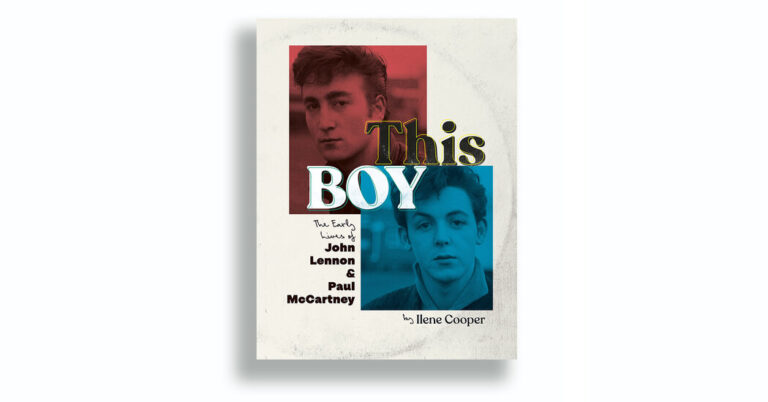Critique de livre : « Le piège d’Achille », de Steve Coll
Les gens aiment imaginer que les affaires mondiales sont un jeu d’échecs, joué par des dirigeants judicieux qui tentent de se déjouer les uns les autres, agissant avec une parfaite connaissance d’eux-mêmes et une compréhension claire de ce que pourrait faire leur adversaire. Mais pensez à Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahu ou Yahya Sinwar. Il peut y avoir un décalage tragique entre les intérêts d’une nation et ceux de ses dirigeants. Les gens qui dirigent le spectacle sont des gens. Ils agissent selon leurs caprices et avec des agendas myopes. Ils se trompent. Appelez cela la théorie historique de l’homme fragile.
Cette inefficacité cosmique et inévitable est le véritable sujet de l’excellent « Le piège d’Achille » de Steve Coll, une chronique des préparatifs de la guerre en Irak. En racontant cette histoire, il rappelle utilement que l’omniscience de l’Amérique est tout aussi susceptible d’être surestimée que les capacités et les intentions de la plupart des acteurs mondiaux.
Coll, rédacteur pour le New Yorker et ancien doyen de la Columbia Journalism School, a écrit une série de livres sur les enchevêtrements de l’Amérique au Moyen-Orient. « Le piège d’Achille » est clairement conçu comme un projet parallèle à son « Ghost Wars », lauréat du prix Pulitzer, une histoire du rôle de la CIA dans les guerres en Afghanistan. Le nouveau livre s’étend des premiers jours de Saddam Hussein au pouvoir jusqu’à l’invasion américaine de l’Irak en mars 2003.
En son cœur se trouve un portrait captivant de Hussein, tiré d’entretiens avec des responsables américains, des inspecteurs en désarmement de l’ONU et des membres survivants du gouvernement du dictateur, ainsi que de ce que Coll appelle les bandes de Saddam : 2 000 heures d’audio rarement consultées lors de réunions de haut niveau. que Hussein « a enregistré avec autant d’assiduité que Richard Nixon ». Les détails qu’il rassemble donnent une image plus intime de la pensée du dictateur sur la politique mondiale, le pouvoir local et ses relations avec les États-Unis qu’on ne l’a vu auparavant.
Le côté américain dans les préparatifs de la guerre en Irak a été bien documenté, en particulier les idéologues mégalomanes de l’administration de George W. Bush et leurs échecs en matière de renseignement. (Et l’opération de la CIA en Irak était surnommée « la maison des jouets cassés » bien avant que quiconque ne parle de gâteau jaune ou de slam dunks.) Coll dépasse rapidement ces préoccupations, qu’il attribue, comme d’autres, à un biais de confirmation : Les États-Unis ont supposé que Hussein mentait lorsqu’il désavouait son projet de posséder et d’utiliser des armes de destruction massive parce qu’il les possédait et les utilisait auparavant.
La veine narrative la plus riche explorée par Coll est l’autre biais de confirmation, beaucoup moins compris : celui de Saddam Hussein, dont la grande erreur a été de penser que les États-Unis étaient tout-puissants et toujours compétents. Comme Hussein l’a raconté plus tard aux enquêteurs américains à propos de son occupation du Koweït au début des années 1990 : « Si vous ne vouliez pas que j’y entre, pourquoi ne me l’avez-vous pas dit ? Hussein pensait également que la CIA savait qu’il n’avait pas d’armes de destruction massive. « Une CIA capable de se tromper complètement sur une question aussi importante sur la base des faits », écrit Coll, « n’était pas cohérente avec les hypothèses fondamentales de Saddam. »
Le nouveau matériel capture un assassin entraîné et un membre d’une tribu rurale qui pouvait être pointu et mondain, mais qui était le plus souvent erratique et paranoïaque. Il a également passé pas mal de temps à lancer des discours antisémites à un cercle restreint de loyalistes pour la plupart effrayés. Hussein était obsédé par Israël et par ce qu’il considérait comme le complot sioniste à l’origine d’une grande partie du comportement de l’Occident. Dans les années 1990, il s’est moqué de Bill Clinton pour avoir porté une kippa lors des funérailles d’Yitzhak Rabin. En 2001, quand l’un de ses ministres a suggéré de promouvoir des officiers militaires parlant l’hébreu, Hussein a rejeté l’idée, craignant que lorsque les officiers rencontreraient leurs homologues juifs, leur langue commune ne créerait « un pont psychologique spécial entre eux ».
« Certaines erreurs de calcul de Saddam semblent compréhensibles », observe sèchement Coll à un moment donné de son histoire. Au cours des décennies de relations entre Hussein et les Américains, le dictateur a dû penser que les États-Unis avaient les mains partout. Washington et Bagdad ont collaboré dans les années 1980 : la CIA a fourni à Hussein des renseignements militaires pour aider le dictateur dans sa guerre contre l’Iran, campagne au cours de laquelle il a déployé des armes chimiques.
Il s’agissait d’une alliance étrange, notamment parce que, comme les médias l’ont finalement révélé, les États-Unis aidaient également discrètement l’Iran. Hussein était déçu. « Vos relations avec le tiers monde sont comme celles d’un paysan irakien avec sa nouvelle épouse », a déclaré Hussein à un diplomate américain. « Trois jours de thé et de miel, puis départ pour la vie aux champs. »
Cette trahison a confirmé l’impression du dictateur quant aux relations avec les États-Unis, et les relations n’ont donc que brièvement souffert. Mais après la fin de la guerre froide, Hussein craignait qu’un Washington qui n’était plus contrôlé par l’Union soviétique se montre encore plus avide de pouvoir et il est devenu moins coopératif. La guerre du Golfe persique de 1991 et les sanctions américaines ont décimé le pays. La visibilité de l’agence en Irak a encore diminué. La stratégie de la CIA s’est éloignée du confinement pour se tourner vers l’espoir que Hussein puisse être destitué par un coup d’État soutenu par l’agence. Plusieurs folies s’ensuivirent. (Coll note que le caractère évasif de l’Irak lors des inspections d’armes était dû à la crainte que la CIA ne collecte des renseignements en vue d’un renversement.)
Alors que la relation s’effondrait, aucune des parties n’a correctement estimé l’autre et elles ont toutes deux atterri sur la même métaphore. « Tous les hommes forts ont leur talon d’Achille », a déclaré Hussein à un groupe de dirigeants arabes en 1990. Il considérait les États-Unis comme trop complaisants pour réellement envahir : « trop arrogants et trop effrayés à l’idée de subir des pertes pour vaincre une nation arabe unie, qui il espérait forger son propre leadership, contre toute évidence », écrit Coll.
Par une pure coïncidence, le programme d’action secret de la CIA contre Hussein dans les années 1990 était codé par câble DB ACHILLES, pour l’idée que le dictateur pourrait être renversé par des troubles menés depuis l’intérieur de l’Irak, où ses mauvais traitements brutaux envers son propre peuple l’ont laissé exposé.
Avec environ 500 pages – le côté le plus court pour un livre de Coll – « Le piège d’Achille » est parfois alourdi par le vertige d’un journaliste avec une pile géante d’articles inédits. Coll raconte la vie de plusieurs Irakiens, dont celle de Jafar Dhia Jafar, un ancien du CERN que Hussein a contraint à poursuivre ses ambitions nucléaires. Cela contribue à donner une idée de ce à quoi ressemblait l’intrigue politique irakienne, mais les différents récits peuvent sembler un peu encombrés.
Pourtant, la majeure partie de l’histoire est vivante et parfois même drôle : dans les années 1980, les responsables irakiens en visite à Washington avaient l’habitude d’acheter des armes et de les expédier chez eux dans des valises diplomatiques. (« Lorsque le président irakien et ses principaux collaborateurs envisageaient les attraits de l’Amérique, ils pensaient aux magasins d’armes », écrit Coll.)
Hussein était fier de son passé difficile, même s’il acquit plus tard certains attributs de l’élite cosmopolite : il jouait aux échecs et, en vieillissant, écrivait des romans. Et pourtant, il n’avait pas la compréhension aiguë du caractère d’un romancier – les défauts et les malentendus qui rendent les représentations de l’humanité convaincantes et réelles – ni lorsqu’il s’agissait de lui-même, ni de ses ennemis.
C’est peut-être une des raisons pour lesquelles ses romans n’étaient pas très bons. Coll note que le dictateur, qui avait un style de prose dégressif, n’a retenu que « certaines » des suggestions de ses éditeurs. (Il avait également le goût d’un cadre hollywoodien pour les spectacles axés sur la propriété intellectuelle. L’un de ses romans, une parabole de propagande sur l’Irak intitulée « Zabibah et le roi », a été mis en scène à la fois sous forme de comédie musicale et de série télévisée en 20 épisodes.)
Contrairement à son personnage principal, Coll réussit en partie parce qu’il a le sens de l’ironie dramatique. Alors qu’il devenait plus clair au début que l’Amérique et ses alliés allaient envahir, Hussein n’a pas atténué sa rhétorique publique pour tenter de les conjurer. Lors d’une réunion privée en mars 2002, comme le révèlent les enregistrements de Saddam, Hussein a déclaré qu’il ne croyait pas à une attaque à grande échelle car cela nuirait à la popularité de Bush dans son pays.
« Le narcissisme est dangereux et peut priver un homme de la possibilité d’être sage », cite Coll. Saddam Hussein n’a pas compris qu’il aurait tout aussi bien pu parler de lui-même.