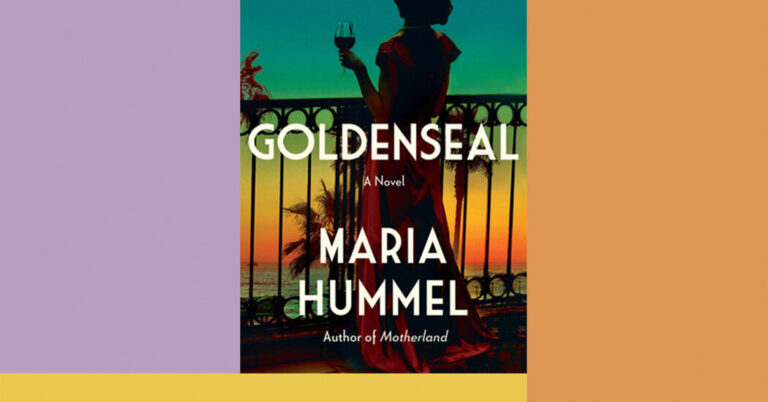Critique de livre : « Le monde à l’envers », de Benjamin Moser
Lorsqu’il a quitté New York pour les Pays-Bas en 2002, Benjamin Moser était au début à la fois de sa carrière et de son histoire d’amour – une situation triplement précaire. Il a trouvé du réconfort dans les musées du pays, en particulier dans les artistes du Siècle d’or hollandais du XVIIe siècle, une époque caractérisée par la mobilité sociale, l’innovation scientifique et l’expansion économique (ainsi que par un colonialisme rampant). Dans « Le monde à l’envers », Moser couvre quelque 18 peintres de l’époque, aussi bien célèbres (Rembrandt, Vermeer, Frans Hals) que moins connus (Adriaen Coorte, Hendrick Avercamp, Rachel Ruysch). Il décrit le livre comme le récit d’une éducation, d’un apprentissage sur et auprès des artistes qui l’ont guidé à travers « une vie incertaine dans un nouveau pays ».
Dans leur travail, Moser a vu le même genre de grandes questions qu’il se posait alors. « Pourquoi faisons-nous de l’art et pourquoi en avons-nous besoin ? » écrit-il dans l’introduction. « Quel est le devoir de l’artiste envers les autres, envers la société, envers soi-même ? … Comment, en un mot, sommes-nous censés vivre ? Bien qu’il présente le livre comme un mélange d’histoire de l’art et d’exploration personnelle, Moser hésite à parcourir cette piste d’enquête. Dans les pages entre l’introduction et la postface, les détails sur ses propres luttes sont rares.
Adapté d’essais publiés au cours des deux dernières décennies dans diverses publications, le livre se lit plus comme un recueil que comme un récit unique et fluide. Il y a beaucoup de répétitions de chapitre en chapitre – chacun considérant un artiste différent et une poignée de ses œuvres – et ensemble, le livre présente un sens fragmenté de l’histoire politique et culturelle de l’époque. Dans plusieurs cas, on dispose de si peu de détails biographiques que Moser en fait une plaisanterie. Mais il ne se laisse pas décourager, tirant le plus de valeur possible d’un minimum d’informations. Moser, qui a remporté le prix Pulitzer pour une biographie de Susan Sontag, tient à donner un sens « romanesque » aux motivations et au travail de chaque peintre, et son besoin de construire des récits soignés est peut-être l’aspect le plus frustrant du livre.
Les points qui décrivent un lustre dans un tableau de Vermeer, par exemple, offrent à Moser l’occasion de « s’accrocher aux quelques bribes » de l’histoire connue de Vermeer et de tirer des conclusions inutiles. «C’était une créature de lumière et non de ténèbres», écrit Moser. « Ses peintures sont l’image d’un homme qui a vu la lumière et les ténèbres – et qui a fait son choix. » Trop occupé à théoriser pour voir l’œuvre qui se trouve juste devant lui, Moser écrit avec peu de sensibilité pour l’histoire humaine de l’œuvre et la manière dont le fait de regarder l’art peut être vivifiant en soi.
Certaines de ses évaluations invitent à la suspicion, voire à la perplexité. L’histoire de l’art, écrit-il, est « si souvent une affaire d’éclats de peinture et de records d’enchères » (dirait-il que l’histoire de la littérature est une histoire de best-sellers ?), comme si c’était une révélation de découvrir qu’elle « peut être aussi chargé d’émotion que les œuvres qu’il étudie. Il explique les arrière-plans sombres de Gerard Ter Borch en spéculant que le peintre « n’avait pas une compréhension avancée de la perspective » et qu’« il aurait été mieux avisé de garder les arrière-plans sombres ». C’est un sacré pas en avant. Moser mentionne que Ter Borch a passé du temps à Madrid mais pas son contact avec Diego Velázquez. bodegonesou «scènes de taverne», et des portraits de personnages vêtus de noir avec des fonds tout aussi austères, noir brunâtre.
D’autres analyses sont teintées par les propres préjugés superficiels de l’auteur. Il décrit qualitativement les peintures de « personnes âgées » de Jan Lievens comme étant « répulsives » ou « simplement dégoûtantes » et rejette deux Vermeer comme étant « histrioniques » et « répulsifs ». Il décrit les effets techniques comme des « astuces d’artiste frimeur » et s’appuie trop souvent sur des mots vagues comme « charme », « charisme » et « humeur » pour exprimer les qualités complexes du travail d’un peintre. « On peut presque sentir un coup de vent souffler sur les livres ouverts sur la table », écrit-il sans enthousiasme à propos des effets « magiques » d’une nature morte de Lievens.
La raison de sa fixation sur la biographie apparaît clairement dans l’avant-dernier chapitre du livre. Le sujet de l’art n’est « pas pertinent », affirme-t-il. « Quand vous regardez un vase de fleurs peint par Picasso, ou van Gogh, ou Manet, vous ne voyez pas les fleurs ; les fleurs ne vous intéressent même pas. Vous vous intéressez à Picasso, Van Gogh ou Manet, dont les personnalités, quel que soit le sujet, ressortent si clairement.
La postface est un grand dégorgement de sentiments et de réflexions qui auraient mieux servi le livre s’ils y avaient été intégrés. « J’ai vécu dans l’Europe de mon propre étranger », dit-il, un monde merveilleux et intemporel si différent du sien. J’aurais aimé qu’il explore cette tension entre sa réalité actuelle et la fuite de l’art dans les chapitres précédents.
Mais la promesse initiale du livre ne se concrétise jamais vraiment. «Je voulais apprendre quelque chose sur l’art parce que je voulais apprendre quelque chose sur la vie», écrit-il. Mais les connaissances qu’il a pu acquérir ne se trouvent pas ici.