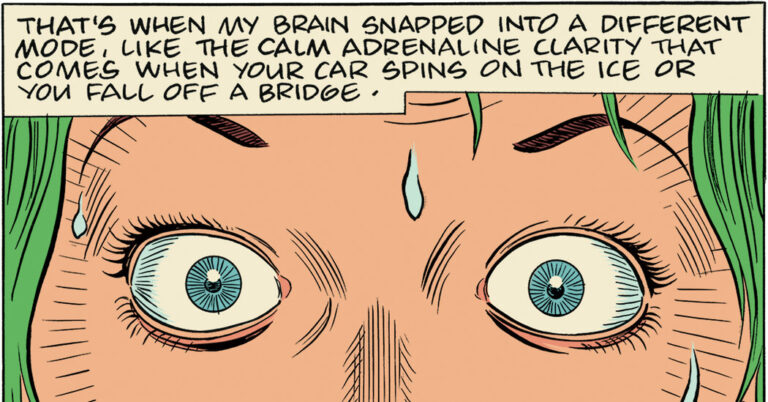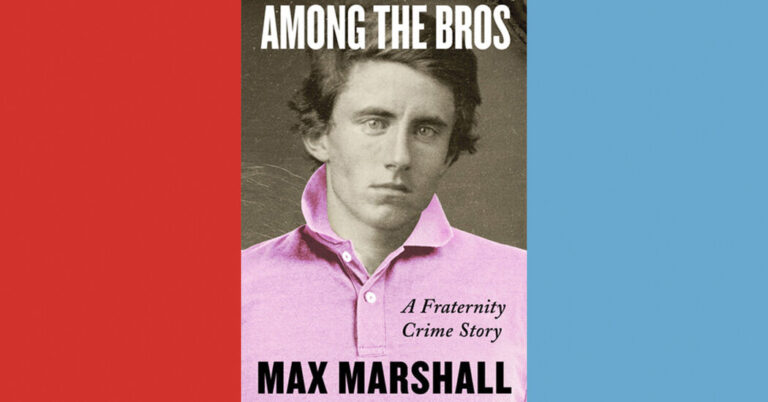Critique de livre : « Le Djinn attend cent ans », de Shubnum Khan
La ville de Durban, sur la côte est de l’Afrique du Sud, se situe psychiquement quelque part entre Miami et la Nouvelle-Orléans. C’est collant à la canne à sucre et au port, un peu glamour, un peu Miss Havisham. Ajoutez à cela des singes vervet et une histoire coloniale turbulente et le gothique de Durban devrait déjà être son propre genre. Cela ne signifie pas que Shubnum Khan donne le ton avec son roman de maison hantée magique et doucement hanté, « Le Djinn attend cent ans ».
La demeure en question est Akbar Manzil, imaginée par Akbar Ali Khan, nouvellement arrivé d’Inde et déterminé à construire sa vie en Afrique du Sud avec sa femme consternée, Jahanara, qui rêve à la place de l’Angleterre. Akbar estime que « la beauté n’est pas un besoin mais une extase », et sa grande folie est un méli-mélo d’influences, avec « des tours gothiques, des arcs islamiques et des balcons européens » et une ménagerie exotique dans les somptueux jardins, comprenant une girafe et un lion. qui circule gratuitement le dimanche.
Autrefois une merveille s’élevant sur la colline, c’est en 2014 un manoir délabré transformé en appartements pour un groupe tout aussi délabré de résidents indiens, dont deux vieilles dames en conflit ; un pianiste glamour délavé ; le doux propriétaire, Docteur, qui travaillait dans les zones de guerre ; et Pinky, obsédée par les films romantiques de Bollywood. Les nouveaux arrivants y résident : Bilal, récemment veuf, et sa fille adolescente livresque, Sana.
En essayant de trouver un endroit « en forme de fille », Sana tombe sur une chambre cachée et un journal perdu sur une romance vouée à l’échec qui pourrait tout bouleverser dans les deux chronologies. Le chroniqueur est Meena, une ouvrière d’usine qui a captivé l’imagination d’Akbar et a plongé la maison dans le tumulte lorsqu’elle a été amenée à contrecœur comme sa seconde épouse.
Tous les habitants sont en quelque sorte hantés, mais il y a aussi de véritables phénomènes surnaturels. Sana est tourmentée par le fantôme de sa sœur jumelle autrefois conjointe, décédée après l’opération chirurgicale visant à les séparer, et qui réapparaît, comme une manifestation particulièrement maligne du dégoût de soi adolescente, pour exprimer ses pensées et ses idées les plus laides.
Cette sœur fantôme la met en garde contre le djinn du titre, boitant les couloirs avec une jambe mutilée et le cœur brisé, lui rongeant les doigts. C’est un témoin muet et un gardien de la mémoire, attiré vers la maison après des siècles d’errance dans le monde par la voix de Meena il y a longtemps. « Tu remues trop de choses », dit sa jumelle. « Il n’aime pas ça. »
La maison, homologue fantomatique plus traditionnelle du djinn, qui vit et respire non plus : « La cuisine se souvient de la dernière fois où la musique du tourne-disque a rempli la maison ; comment les crabes avaient brûlé et la fin était venue si vite », Khan écrit. Alors que le journal de Meena nous catapulte vers ce mystère, la maison est incapable de conserver ses secrets ou sa structure. « Les canalisations commencent à fuir, les murs se fissurent, la moisissure se propage et le froid devient insupportable. »
Malgré les signes extérieurs gothiques, ce n’est pas un roman d’effroi rampant. C’est riche et pâmoison, orienté vers l’extase des poètes soufis comme Rumi, avec un clin d’œil à ces films d’amour indiens épiques que Pinky adore.
« L’amour dans la vraie vie n’est pas une chose pratique. Cela ralentit les gens et rend leur cerveau bancal », sermonne Pinky à Sana. « L’amour, c’est juste pour les films. »
L’auteur, tout comme son protagoniste adolescent et philosophique, n’y croit pas une seconde. L’histoire d’amour au cœur du roman est grandiose, magnifique et courageuse. Parfois, c’est aussi un peu fragile.
Une nuit, Sana trouve le Docteur en train de regarder un chef-d’œuvre indien sur sa télévision en noir et blanc appelé « Kaagaz Ke Phool », une méditation sur la vie inconstante et fragile. Le titre se traduit par « fleurs en papier », une métaphore appropriée pour les rares cas où le roman de Khan (son premier publié aux États-Unis) échoue.
Bien que son nom soit vérifié dans le titre, le djinn n’a pas grand-chose à faire. Jahanara, l’épouse méprisée, se sent méchante d’un point de vue caricatural. Et alors que nous courons vers des fins parallèles, l’une choquante, l’autre prévisible (avec son propre genre de satisfaction), nous perdons de vue Sana elle-même.
Ce sont cependant des problèmes mineurs dans un roman qui est un délice ambitieux, avec des personnages riches et une écriture exceptionnellement belle.
Voici un aparté que vous devriez connaître. Shubnum Khan est également l’auteur d’un livre d’essais intitulé « Comment je suis accidentellement devenu une banque d’images mondiale et autres histoires étranges et merveilleuses ». Lorsqu’elle a accepté d’être photographiée pour un « projet artistique » sans lire les petits caractères, cela l’a lancée comme égérie de centaines de campagnes publicitaires, pour des crèmes pour le visage en Turquie, des tapis à New York et McDonald’s en Chine.
Il y a dix ans, la photographie de Khan faisait sensation. Je soupçonne que son écriture fera de même. C’est le début d’une grande carrière.