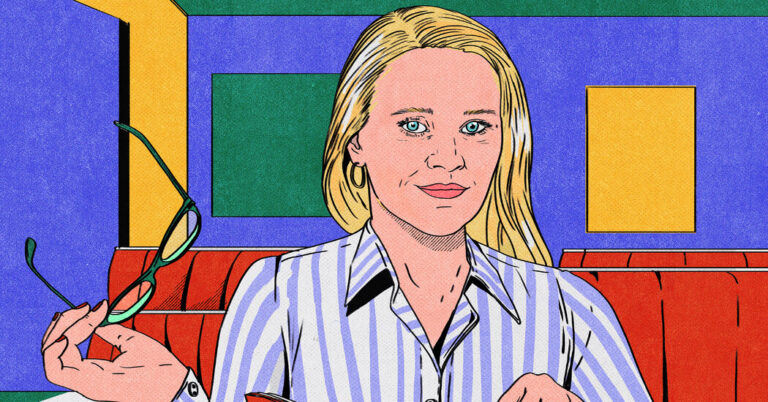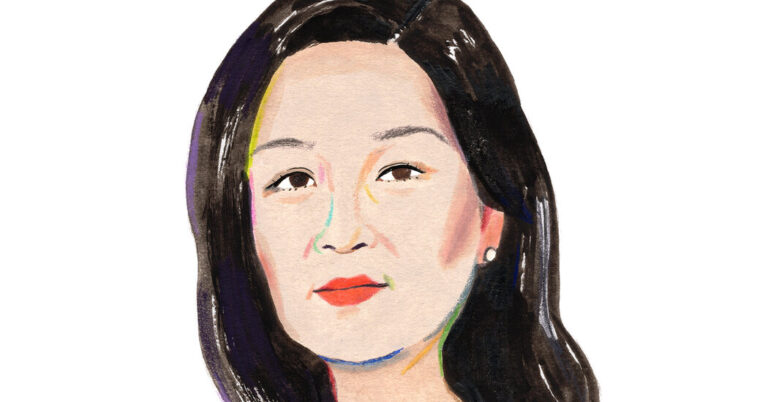Critique de livre : ‘Crook Manifesto’, de Colson Whitehead
Revenant à l’univers de son roman « Harlem Shuffle », le « Crook Manifesto » de Colson Whitehead est un traité éblouissant, une anatomie glorieuse et complexe du braquage, de l’escroquerie et du jeu lent. Il y a un élément de crime ici, certes, mais comme dans les livres précédents de Whitehead, le genre n’est pas le point. Ici, il utilise le roman policier comme une lentille pour enquêter sur la mécanique d’un quartier singulier à un point de basculement particulier dans le temps. Il a raison : la musique, l’énergie, le douloureux calcul de la perte. Structuré en trois périodes – 1971, 1973 et enfin l’année de la célébration du bicentenaire de l’Amérique, 1976 – « Crook Manifesto » fait joyeusement exploser sa satire sur ce monde tout en pénétrant au cœur du lieu et de ses habitants.
C’est une histoire de survie sans rédemption, où la prochaine génération perd certains des instincts bien aiguisés qui ont construit ce monde. Le héros de Whitehead, le vendeur de meubles et petit criminel opportuniste Ray Carney, est plus âgé qu’il ne l’était lors de notre dernière rencontre. Il s’est retiré de sa pratique de travailler dans «l’économie secondaire». Mais à l’extérieur de la vitrine de la salle d’exposition de son entreprise de meubles prospère, Harlem s’agite avec le malaise du changement et de l’oppression.
La présence des Black Panthers et de l’Armée de libération noire a donné un nouvel élan à la bataille séculaire entre le quartier et les policiers blancs qui parcourent ses rues sans ménagement. De derrière la vitrine de son magasin, Carney comprend tout : le bruit sourd des moteurs de voiture, les cris et les railleries, les arrêts d’hommes noirs poussés contre les murs et fouillés par des policiers blancs, les gros titres des policiers tués . Les sirènes coupent les conversations; les gens traversent le fleuve puissant des sons et des odeurs qui sont Harlem.
Carney veut éviter les ennuis, mais sa fille, qui se sent perdue à cause de l’angoisse de l’adolescence, veut des billets pour voir les Jackson 5, un spectacle complet depuis longtemps. Whitehead utilise cette attraction douce-amère de la perte parentale pour plonger dans un voyage comique – et mortel. De là, Carney revisite et ravive les relations qu’il avait autrefois et a payé cher pour les laisser derrière lui. Il fait des gaffes dans les appartements des criminels, transporte des bijoux chauds dans sa mallette et est forcé de voler une partie de poker.
Carney est résigné et observateur, un participant et un otage, alors qu’il se lance dans un tour de fusil de chasse cauchemardesque à travers New York. Son navigateur et terroriste pendant le voyage est un flic blanc corrompu qui n’arrête pas de parler de ringolevio, le jeu de rue auquel Carney et ses amis jouaient à Harlem et que le flic jouait dans son propre quartier d’enfance de Hell’s Kitchen. Plus le flic parle, plus Carney essaie de trouver une issue, une sortie. Il devient un confesseur involontaire et témoin d’une vieille vérité : personne n’y échappe. Il met en place une série de tragédies en cascade, à travers des aventures à la «Don Quichotte», pour rétablir la balance, pour créer un nouveau type de version de qui il est, de ce qu’est Harlem.
Whitehead plie le langage. Il rend sinueux les sons d’une ville et de ses habitants poussant contre les frontières. Il peut être drôlement mordant, avec des exécutants d’antan observant la précision des brutalités passées tandis que le langage dans la tête de Carney concerne l’annonce qu’il doit rédiger – malgré le nombre croissant de corps et de corruptions auxquels il est confronté – pour le bicentenaire du 4 juillet, et ce que ces vacances signifient vraiment dans son Harlem et pour ses clients à la recherche de leur prochain canapé. À d’autres moments, Whitehead donne à ses personnages le calme et l’espace pour émettre le son d’un regret et d’une résignation si profonds : d’être pris au piège, de toutes les chances qui se dressent contre eux, même de l’intérieur.
« C’était comme s’il était redevenu un enfant, commençant tout juste à comprendre la forme de sa tristesse », pense un personnage alors qu’il chasse consciencieusement la térébenthine qu’il utilisera pour allumer un feu illicite. « Décalé même alors, perdu parmi les grands immeubles. »
Les hommes de Whitehead luttent contre les relations, ils portent leurs chagrins et leurs amours perdus près de la poitrine. Ils ont des noms et des surnoms tirés de ce qu’on ne peut qu’appeler des expériences passées traumatisantes : Zippo, Corky. Ils apprécient la loyauté et pourtant ont peu de confiance. Ils divisent les rues, les entreprises illégales, la comptabilité douteuse et les compétences (incendie criminel, safecracking, protection), puis le pouvoir change lorsque les joueurs se dispersent et changent de camp. Pris dans leurs spécialités, ils dirigent les raquettes comme les sociétés corrompues qui dirigent l’Amérique.
Entrez l’artiste et le pyromane non affilié, des « hommes aux yeux sauvages » du « recensement des inadaptés » de Whitehead qui partagent une passion pour quelque chose d’ineffable : évoquer quelque chose de totalement nouveau. D’une part, c’est un film fabuliste dans un théâtre sombre – un film de blaxploitation tourné à Harlem, « Nefertiti TNT », mettant en vedette une actrice d’une banlieue du New Jersey avec une biographie qui dit le contraire. Pour l’incendiaire laïc, c’est la ruée du bruit du feu qui s’empare des rideaux, du canapé réservé ou des os bruts vides d’un bâtiment abandonné. Nous avons tous nos rêves.
Mais pour Carney, les incendies deviennent un point d’inflexion qu’il ne comprend pas, une poussée à l’action qui semble, même pour lui, hors de propos :
« Il était ici ce soir parce qu’un garçon qu’il ne connaissait pas a été pris dans un incendie et qu’une étincelle a attrapé la manche de Carney. Pour venger — qui ? Le garçon? Pour punir les méchants ? Lesquels – il y en avait trop pour les compter. La ville brûlait. Elle brûlait non pas à cause d’hommes malades avec des allumettes et des bidons d’essence, mais parce que la ville elle-même était malade, attendant le feu, le suppliant. Chaque nuit, vous entendiez les sirènes. Pierce a blâmé des années de politique erronée, mais Carney a rejeté ce diagnostic étroit : d’après ce qu’il comprenait des êtres humains, les désordres et les cruautés d’aujourd’hui étaient la dernière version des anciens. Mêmes défauts, visage différent. Tout cela s’est transmis. »
Un seul acte qui défie tous ses instincts bien aiguisés et sa formation de rue révèle Harlem à Carney de toutes les manières dont il a appris à le connaître dans ses parties – la formation de son père, les ambitions de sa belle-famille, son incapacité à planter fermement ses pieds dans cet endroit qu’il a appelé sa maison. Lorsque le roman touche à sa fin, il y a une note de grâce pour Carney, peut-être pas cette retraite insulaire que son redoutable fixateur de flics blancs avait en tête, mais un autre type de paix auquel nous pouvons tous aspirer : survivre à nos propres décisions et rêves, être aimé, appartenir à un endroit que nous aimons.