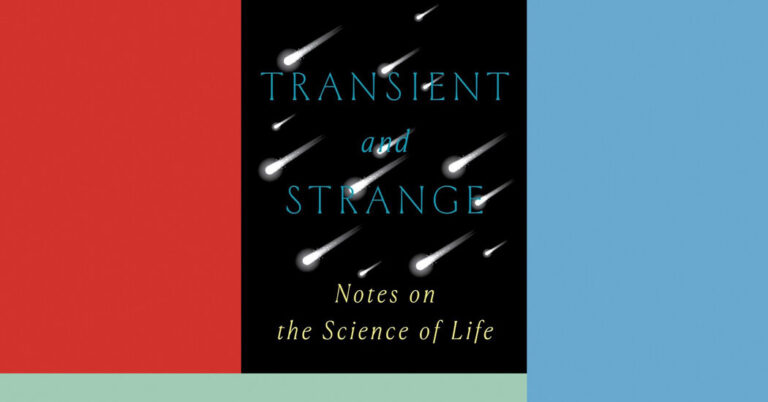Critique de livre : « Glitter & Concrete », par Elyssa Maxx Goodman
En 1967, Crystal LaBeija, troisième finaliste du concours de beauté Miss All-America Camp – un concours national pour drag queens – a fait irruption hors de la scène en signe de protestation, estimant que le concours avait été truqué en faveur des concurrents blancs. Ensuite, elle a livré un monologue furieux, conservé dans le documentaire « The Queen » de 1968, qui nous a donné la phrase immortelle : « J’ai un droite pour montrer ma couleur, chérie. je suis belle et moi savoir Je suis beau! » et se terminait par le renvoi sans équivoque de la gagnante du concours, prononcé comme une condamnation à mort : « Elle avait l’air mauvais.»
Dans « Glitter & Concrete », l’écrivaine et photographe Elyssa Maxx Goodman retrace l’émergence du drag à New York au début des années 1900, sa descente dans la clandestinité après la Grande Dépression et sa renaissance dans les années 1980, stimulée par la culture des clubs. C’est un livre tentaculaire, un peu trop ambitieux, mais animé par le feu d’une reine qui se savait lésée.
En 1845, New York a adopté une loi visant à taxer les manifestants déguisés en Amérindiens. Promettant l’arrestation de quiconque aurait « le visage maquillé, décoloré, couvert ou dissimulé, ou autrement déguisé, de manière à empêcher son identification », la loi sur la mascarade est restée en vigueur jusqu’en 2020, date à laquelle elle a été abrogée en 2020. à la lumière des mandats de masques Covid. Pendant des générations, cela a donné à la police un moyen de harceler toute personne jouant avec le genre en public.
Lorsque l’usurpation d’identité féminine est devenue un trope scénique populaire au tournant du 20e siècle, les premières stars telles que Julian Eltinge – une célébrité internationale qui a joué pour le roi Édouard VII au château de Windsor – ont utilisé le drag non pas pour remettre en question la binaire des genres mais pour la renforcer. Il incarnait des personnages habillés en femmes, non pas pour le plaisir, ni pour l’art, mais pour la farce.
« Il a dû faire clairement comprendre qu’il méprisait les « fées » dont les présentations de la féminité étaient considérées comme « perverses » », écrit Goodman. « Après sa performance, il enlevait son costume, allumait un cigare et accueillait les journalistes dans les coulisses pour qu’ils puissent voir à quel point il était ‘masculin’. »
Malgré une obsession renouvelée pour les rôles de genre qui a suivi l’adoption du 19e amendement, le drag a persisté sur scène et dans les bals masqués organisés par des organisations fraternelles comme le Hamilton Lodge #710 du Grand United Order of Odd Fellows, qui a fait de Harlem le sommet du drag new-yorkais. . Ce n’est qu’en 1940, lorsque les artistes de tous bords furent tenus de détenir des licences de cabaret qui étaient systématiquement refusées aux personnes noires et ouvertement queer, que le drag fut finalement contraint à la clandestinité.
Au cours des décennies suivantes, l’évolution du drag a fait écho à la division du mouvement naissant pour les droits des homosexuels entre les assimilationnistes comme la Mattachine Society et les pédés révolutionnaires rebelles. Les imitatrices professionnelles qui ont montré leurs talents au Club 181, propriété de la mafia, et à la Jewel Box Revue, en tournée à l’échelle nationale, ont pris soin de se distinguer des drag queens, terme qui à l’époque faisait référence aux amateurs, aux travestis et aux femmes trans. Cette tension a explosé en 1969, lors du soulèvement de Stonewall, où ce sont des enfants des rues, des personnes trans, des lesbiennes et des drag queens – notamment Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera – qui ont mené la charge.
Goodman fait un travail louable en écrivant sur les artistes Genderqueer qui ont travaillé des décennies avant l’évolution du langage moderne pour les décrire. Elle décrit le drag comme « un refuge pour tout monstre autoproclamé qui se sentait à sa place ailleurs, un terrain de jeu pour l’art de la non-conformité de genre sous toutes ses formes théâtrales », et refuse d’exclure qui que ce soit de la fête.
Et comme le drag est encore trop souvent décrit comme appartenant uniquement aux hommes gays cisgenres, il est rafraîchissant de voir autant de pages consacrées au travail pionnier des drag kings et des imitateurs masculins, de Florence Hines, une femme noire que le New York Clipper a qualifiée de « la plus grande artiste féminine vivante de chant et de danse » en 1890, à Johnny Science et Diane Torr, dont les ateliers Drag King un siècle plus tard enseignaient aux aspirants rois à marcher comme s’ils étaient entourés d’un « fossé de trois pieds ».
Mais l’engagement de Goodman à explorer tous les recoins de l’histoire du drag de la ville signifie que son histoire avance trop rapidement, passant par des tournants majeurs, comme Stonewall, pour que le nom de chaque club et de chaque artiste célèbre puisse être enregistré. Le livre gagnerait à être organisé thématiquement plutôt que chronologiquement ou en se concentrant sur une poignée de plus grandes personnalités, comme Eltinge, Rivera, Hines et LaBeija. En donnant à chacun le même poids, « Glitter & Concrete » rend difficile l’appréciation complète de chacun d’entre eux.
Ce problème devient aigu à mesure que Goodman se rapproche du présent et que la recherche archivistique cède la place à des souvenirs « il fallait être là » de la culture partisane qui a lancé le drag dans le courant dominant dans les années 80, 90 et 2000. On nous dit qu’« il y avait une atmosphère de tout va qui ne peut tout simplement pas être reproduite aujourd’hui », mais nous ne disposons pas du matériel narratif nécessaire pour ressentir ce que nous avons manqué. Étudier les récits de performances spécifiques contribuerait davantage à donner vie à des lieux comme le Pyramid Club et le Bar d’O.
Même s’il va trop loin, tout livre célébrant des personnes comme Crystal LaBeija est précieux. Quelques années après son apparition dans « The Queen », on lui a demandé d’organiser un bal pour les reines noires à Harlem. Faisant preuve de l’instinct d’auto-promotion d’une star, elle a dit oui, écrit Goodman, « à condition qu’elle puisse être au centre de l’événement ». Elle a ensuite fondé la Maison LaBeija, inspirant le système de maisons qui a offert refuge, famille et inspiration aux personnes queer au cours des décennies suivantes.
Chaque fois qu’une reine dit « Chéri ! », elle honore son nom.