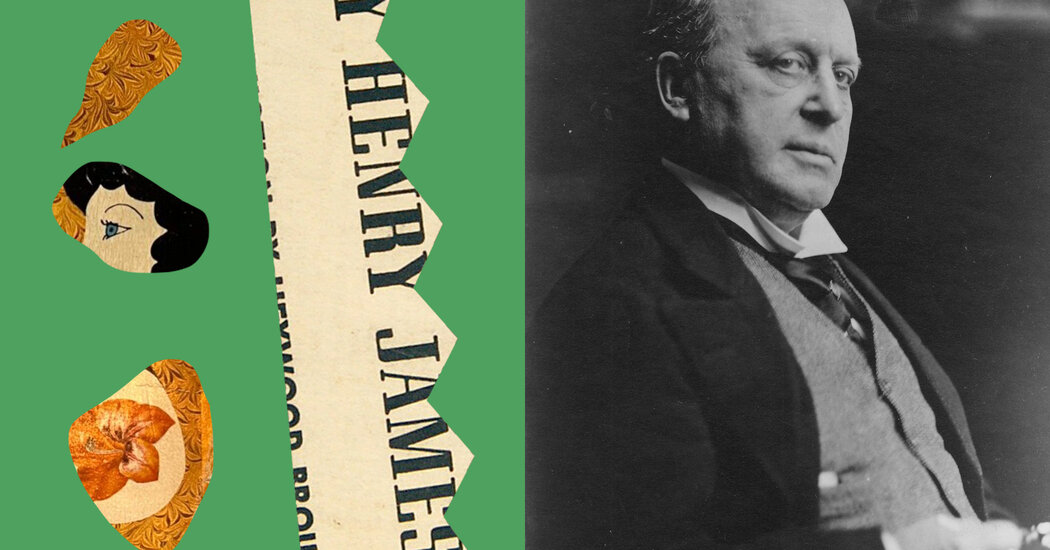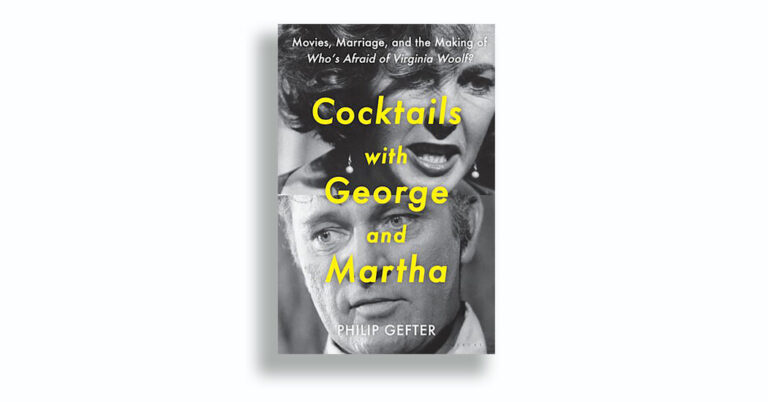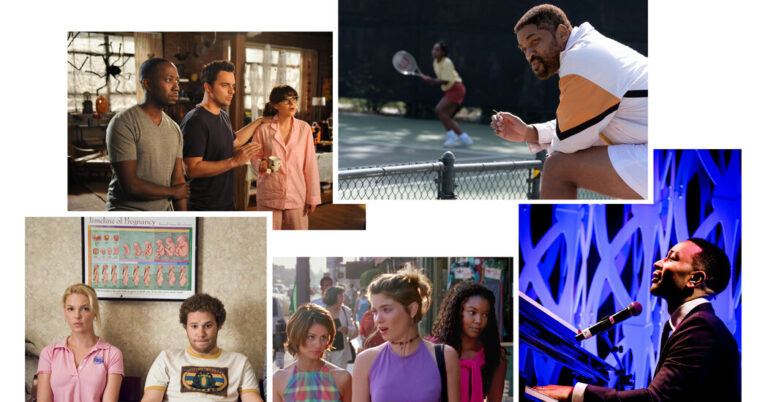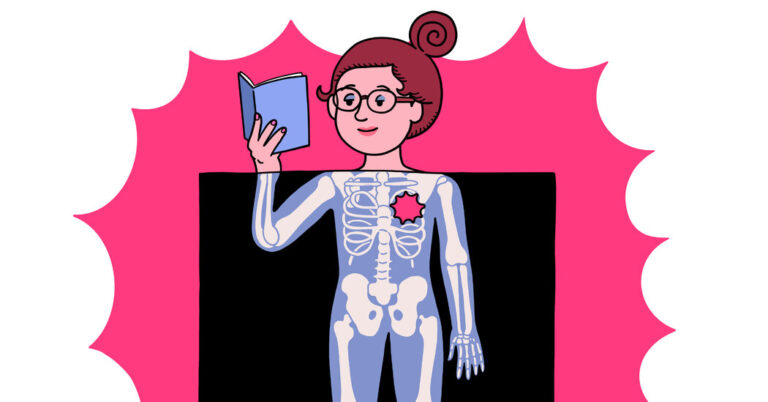Les meilleurs livres d’Henry James : un guide
Oubliez tout ce que vous avez déjà entendu sur le fait que moins est plus, sur l’économie de syntaxe, sur la profondeur de lecture entre les lignes de la « prose de rechange » à larges marges et à double interligne. Lire un paragraphe d’Henry James – un seul peut s’étaler sur plusieurs pages – revient à se complaire dans un excès linguistique.
Expatrié américain ayant passé sa vie adulte en Angleterre, James (1843-1916) était le saint patron de la verbosité exquise ; de phrases détournées et compulsivement sous-clauses qui contiennent tous les rebondissements et aventures qui manquent à ses intrigues. En lisant le prodigieux corpus de fiction qu’il a produit pendant quatre décennies, entre 1871 et 1911, on a le sentiment qu’il s’est perdu si profondément dans ses thèmes récurrents – l’innocence de l’Amérique contre l’expérience et la dépravation de l’Europe, la richesse psychologique de la vie quotidienne – qu’il ne pouvait s’empêcher de continuer.
Cela s’appliquait également à sa non-fiction. James n’a pas seulement écrit des romans ; il a écrit sur l’écriture de romans, obsédé par son métier comme ses personnages sont obsédés par les détails de leur vie. Rejetant les romans d’incidents « superficiels » de Dickens, James s’est imposé comme un étudiant du réalisme psychologique de George Eliot, devenant un ancêtre pré-moderniste d’écrivains d’Edith Wharton à Virginia Woolf.
« Le pouvoir de deviner l’invisible à partir du visible, de retracer l’implication des choses, de juger l’ensemble de la pièce par le modèle, la condition de ressentir la vie, en général, si complètement que vous êtes sur la bonne voie pour connaître n’importe quel coin particulier. de celui-ci – on peut presque dire que cet ensemble de dons constitue une expérience », a écrit James dans son essai fondateur de 1884 « The Art of Fiction ». Là où l’historien consigne consciencieusement la réalité observée, pensait-il, le rôle du romancier est d’exploiter les « impressions » pour en faire une image imaginée.
Deuxième des cinq enfants du théologien Henry James Sr. et de l’héritière Mary Walsh, James a grandi en se déplaçant entre son New York natal, la Nouvelle-Angleterre, Londres, Paris et Genève. Ses fictions continueront à refléter son éducation transatlantique ainsi que l’influence de son frère aîné, William, psychologue de Harvard et auteur de « The Varieties of Religious Experience », entre autres ouvrages.
James a passé sa vie à disséquer les dynamiques subtiles entre les Américains à l’étranger et les Européens à la vieille fortune qu’ils ont rencontrés là-bas. Parmi ses plus de 20 romans, des dizaines de recueils d’histoires et de nouvelles et des volumes de critiques, de lettres, d’essais et de poèmes, ce sont les livres les plus essentiels à lire pour comprendre le grand héritage d’Henry James.
Donnez-moi le meilleur de lui-même.
C’est le livre que j’ai lu plus de fois que tout autre, même si – ou parce que ? – il ne s’y passe pas grand-chose. Au début de « » (1881), une orpheline de 21 ans nommée Isabel Archer est convoquée d’Albany en Angleterre, où elle hérite de la richesse de son oncle, reçoit et rejette deux propositions de mariage différentes et se retrouve finalement mariée à un père veuf. , Gilbert Osmond, à Rome. Autre expatrié vivant en Europe depuis son enfance, Osmond est à la fois le réceptacle de James pour tous les périls moraux de la société continentale et son plus grand méchant.
C’est à peu près tout. La lutte intérieure d’Isabel entre son indépendance et ses affections, entre l’attrait de la splendeur italienne vieille de plusieurs siècles et les sombres ombres romaines qu’elle commence à détecter en elle, constitue le roman. Et pourtant, le lecteur est tellement captivé par son esprit torturé et brillant que cette jeune femme apparemment banale reste l’une des héroïnes les plus durables de la littérature anglaise.
Dans une préface de l’édition de 1908, James écrit à propos d’Isabel :
Qu’y a-t-il de plus vrai que d’un côté – du côté de leur indépendance face aux inondations et aux champs, aux accidents en mouvement, aux combats, aux meurtres et à la mort subite – ses aventures doivent être douces ? Sans son sens d’eux, son sens pour eux… ils ne sont presque rien du tout ; mais la beauté et la difficulté ne sont-elles pas simplement de montrer leur conversion mystique dans ce sens, leur conversion en matière de drame ou, mot encore plus délicieux, d’« histoire » ?
Les préfaces de James à ses diverses œuvres de 1908 sont elles-mêmes un traité digne de ce nom sur la théorie littéraire, et cette introduction particulière persuade le lecteur d’ignorer les critiques passés et futurs qui « sourient encore de sa volonté de réduire presque rien en poudre », comme l’a souligné Anthony Lane. paru dans le New Yorker en 2012.
Pour son insistance sur l’intériorité plutôt que sur l’incident, son ambiguïté narrative et morale, sa capacité à attirer le lecteur si profondément dans la conscience d’Isabel qu’elle nous manque sincèrement après la dernière page, je recommande « Le Portrait d’une dame » non seulement comme le livre le plus important. des livres de James, mais l’un des livres les plus importants, point final.
J’aimerais lire James au sommet de ses pouvoirs.
Le dernier grand roman de James, « » (1904), parle d’un rectangle d’amour salace entre la protagoniste, Maggie Verver ; son père veuf, un financier nommé Adam Verver ; un prince italien, Amerigo, dont la famille n’a plus aucune richesse à proprement parler ; et l’amie d’enfance de Maggie, Charlotte Stant. C’était aussi, pour l’auteur lui-même, « la plus composée, la plus construite et la plus achevée… la plus solide, jusqu’à présent, de toutes mes fictions ».
Comme dans ses œuvres antérieures, le drame ici est de type intérieur et domestique. Ce qui distingue cette histoire est qu’elle se concentre étroitement sur quatre personnages centraux seulement, sans la galaxie tentaculaire habituelle de satellites moins dessinés.
« Le Bol d’Or » était le troisième bouchon de porte publié par James en seulement trois années consécutives, après « Les Ambassadeurs » en 1902 et « Les Ailes de la Colombe » en 1903. Dans cet ouvrage, il tisse un réseau de connexions savamment tendu – père et fille, mari et femme, vieux amis et amants extraconjugaux – se chevauchant de manière inconfortable et passionnante.
D’autres gros tomes, s’il vous plaît.
En parlant de (1903), celui-ci m’a fait crier sur les pages : Regarder deux Londoniens tromper notre héroïne américaine involontaire d’une manière atrocement lente est presque trop difficile à supporter pour un lecteur sensible.
Milly Theale est une héritière new-yorkaise incroyablement riche qui arrive en Angleterre avec son amie d’âge moyen, Mme Stringham. Là, ils rencontrent Maud Lowder et sa nièce amoureuse, Kate Croy, qui a très peu d’argent et de nombreux problèmes avec son père.
Kate est amoureuse de Merton Densher, un journaliste britannique qui a charmé Milly lors de ses précédents voyages en Amérique. Lorsqu’ils découvrent que Milly est en mauvaise santé – les détails de sa maladie restent mystérieux – Kate et Merton complotent pour la tromper et l’épouser, afin qu’il puisse hériter de sa richesse à sa mort, puis épouser Kate.
Milly est, jusqu’à un acte final de commandement déchirant, l’un des protagonistes les plus tragiques et les plus complaisants de James, non pas parce qu’elle manque de perspicacité ou d’observation, mais à cause de la bonté frustrante et infatigable de son cœur. Ce livre est le point culminant de la longue suspicion de James selon laquelle en Europe, la pure conscience américaine est vouée à être confrontée à une manipulation richement ornée.
Me faire flipper!
Inspirée d’une histoire de fantômes réelle qu’il a entendue de l’archevêque de Cantorbéry trois ans plus tôt, la nouvelle de James (1898) se présente aujourd’hui comme une histoire véritablement effrayante d’enfants hantés dans une vaste maison de campagne de l’Essex. Les enfants orphelins ont été recueillis par leur oncle, qui a donné à notre narrateur anonyme, leur nouvelle gouvernante, des instructions strictes de ne jamais le déranger avec les détails de leur éducation.
Lorsqu’elle arrive au manoir, l’un de ses protégés, Miles, vient d’être expulsé du pensionnat et de rentrer chez sa sœur cadette, Flora, et leur gentille naïve gouvernante. Au début, la narratrice trouve les deux enfants étrangement bien élevés, jusqu’à ce qu’elle commence à soupçonner qu’ils sont mêlés à d’étranges personnages adultes qu’elle voit errer dans la propriété à distance. La gouvernante confie que le domaine comptait deux anciens employés, Miss Jessel et Peter Quint, qui étaient amants, et qui sont décédés depuis.
Ce chef-d’œuvre de la fiction d’horreur évoque la terreur intemporelle de la corruption infantile tout en laissant tant de questions sans réponse.
En fait, j’aimerais m’éclater.
Le deuxième roman de James, « » (1875), fut son premier roman majeur, et peut-être le plus amusant. Précurseur du Dorian Gray d’Oscar Wilde, Hudson n’est pas tant le protagoniste du roman que l’objet doré d’affection du protagoniste. Le mécène de l’art de Boston, Rowland Mallet (James a eu la main un peu dure avec ce nom) reprend Hudson de sa petite vie d’étudiant en droit et de sculpteur amateur à Northampton, dans le Massachusetts, et élargit ses horizons à travers l’Europe, où Mallet essaie pour inciter un talent naissant à s’épanouir.
Bien qu’il lui manque la surréalité gothique du Portrait de Dorian Gray, Roderick Hudson prédit une trajectoire similaire pour son personnage principal, qui devient de plus en plus obsédé par la beauté, le plaisir et l’abondance jusqu’à ce qu’il tombe, comme Icare, en ruine. Le narrateur omniscient à la troisième personne fait souvent un clin d’œil au lecteur, nous mettant en confiance alors que nous assistons à l’implosion inévitable de l’orgueil esthétique. (Le roman présente également le personnage récurrent infiniment séduisant et énigmatique de James, la princesse Casamassima, qui a obtenu son propre titre en 1886.)
Que diriez-vous d’un malheureux entrepreneur américain ?
James aurait tout aussi bien pu nommer Christopher Newman, le protagoniste de (1877), Christopher Newmoney. Homologue masculin des héritières américaines riches et dociles de James et homologue plus jeune des patriarches dynastiques de ces héritières, Newman est une race de richesse peu familière pour le continent. «Je suis dans les affaires depuis l’âge de 15 ans», raconte-t-il à Madame de Bellegarde, aristocrate française et future belle-mère. La nature précise de son commercialisme est presque hors de propos. (À une époque, il y avait des baignoires ; à une autre, du cuir.) Le but était de travailler très dur et de devenir très riche.
Il a réussi, mais tout cela s’est passé avant le début de ce roman ; James s’intéresse davantage aux implications sociales granulaires de cet entrepreneuriat qu’aux détails banals du commerce mondial. Parti pour une tournée européenne avec le vague objectif de « voir davantage le monde » et d’être « délicieusement paresseux », le trentenaire retraité rencontre à Paris une jeune veuve nommée Claire de Cintré et s’arrête dans son élan proverbial.
Le nœud du drame bouillonnant de James est que les Bellegarde sont aussi tentés par les millions de Newman que découragés par l’idée que ces millions ont été créés par eux-mêmes. La fin promet un scandale de feuilleton et une chasse au chantage, la morale du Nouveau Monde de Newman transmuée, dans l’Ancien Monde, en son contraire.
Je veux en savoir plus sur James lui-même.
Pour ceux qui s’intéressent à la vie personnelle quelque peu obscure de James, deux biographies, l’édition mise à jour et abrégée des cinq volumes de Leon Edel et celle de Michael Gorra (2012), offrent tous les détails démystifiants, et plus encore.
Edel a remporté à la fois un Pulitzer et un National Book Award pour sa série, publiée entre 1953 et 1972 et qui reste peut-être encore le manuel pour la bourse James et pour toute personne intéressée par le métier de la biographie plus largement. Même la version condensée couvre beaucoup de terrain. Il s’agit d’une enquête de 750 pages sur l’enfance nomade de James ; ses premières études de droit inachevées à Harvard ; et ses relations avec William et surtout sa sœur cadette Alice, décédée d’un cancer du sein dans la quarantaine, laissant James sans ressources. Et cela évoque son installation permanente en Angleterre et son exposition à ses grandes inspirations européennes, parmi lesquelles George Eliot, Gustave Flaubert et Ivan Tourgueniev.
Cette version, éditée par Edel dans les années 1980, contient également les révisions nécessaires à son traitement de l’éventuelle homosexualité de James, que le biographe en est venu à considérer comme « excessivement indirect ».
Le livre de Gorra, finaliste Pulitzer, a deux sujets : « Le Portrait d’une dame » et son auteur, tissant l’analyse textuelle avec la biographie et l’histoire dans un travail fascinant d’érudition littéraire.
Le romancier Colm Tóibín n’hésite pas à aborder la question de la sexualité de James dans sa biographie fictive, « Le Maître », qui s’étend sur cinq ans avant le début du siècle, lorsque James était au sommet de ses pouvoirs, et peut-être de lui-même. -doute.
Tóibín traite James de la même manière que James traitait ses propres personnages, creusant un trou profond dans son cerveau et l’habitant avec délectation. Comme tout roman, en particulier celui de James lui-même, « Le Maître » ouvre une fenêtre sur des aspects de la vie individuelle qui ne sont pas moins vrais pour leur présentation dans la fiction.