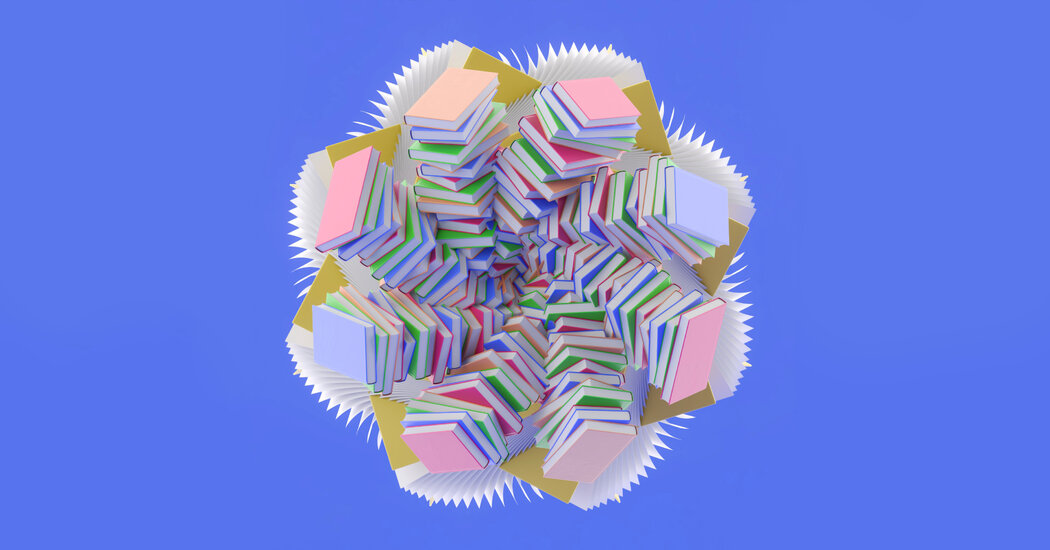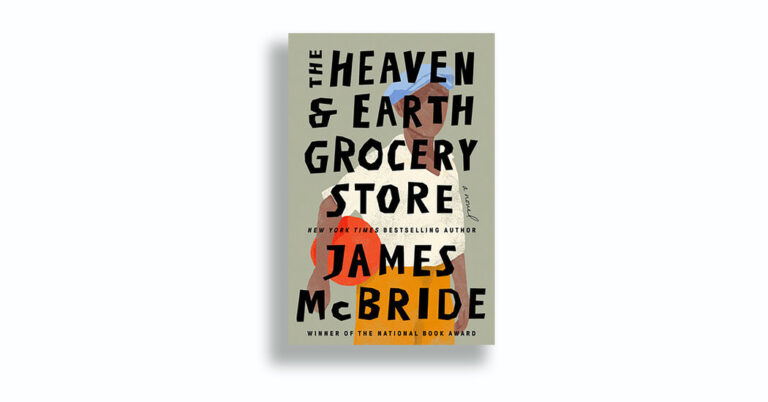Le choix des critiques : une année de lecture
Jennifer Szalaï
Comme je ne passe en revue que des non-fictions, je suis parfois chargé d’écrire sur des mémoires politiques – dont un certain nombre visent à vous faire croire ce que leurs auteurs politiques veulent vous faire croire, voire à insister sur le fait que vous devriez simplement fermer votre esprit et les laisser. réfléchissez à votre place. C’est donc avec plaisir et soulagement que j’ai découvert cette année quelques livres à caractère philosophique. Au milieu de toutes les ventes difficiles et de toutes les prises de vue, ces livres ont fourni une contre-programmation nécessaire. Leurs auteurs sont plus intéressés à ouvrir de nouvelles voies de compréhension qu’à dire aux gens quoi faire.
« Humanly Possible » de Sarah Bakewell vous donne le sentiment que lorsqu’il s’agit d’humains, rien est possible – pour le meilleur ou pour le pire, ce qui fait partie de ce qui donne à ce livre son charme indéniable. Bakewell, qui a également écrit des livres sur l’existentialisme et Montaigne, est si généreux et résolument ouvert d’esprit. Qu’elle soit capable de rassembler sept siècles de pensée humaniste dans un récit vif et lisible est une véritable réussite, même si ce nouveau livre est plus diffus que son ouvrage précédent. Elle est honnête sur les limites des humanistes, qui peuvent parfois privilégier la réflexion au-dessus de l’action – voyant constamment les deux côtés d’une question, même lorsque l’un d’entre eux promeut un fanatisme cruel.
Mais « Humanly Possible » regorge aussi d’histoires drôles. Nous sommes des créatures limitées, malgré nos prétentions contraires. Bakewell discute de « Des bonnes manières pour les garçons », dans lequel Erasmus aborde des questions aussi urgentes que la façon de faire passer l’essence en bonne compagnie. Les courants les plus féconds de l’humanisme reconnaissent ce que nous partageons avec les animaux non humains. Après que Bertrand Russell ait eu un accident d’hydravion, un journaliste a demandé à quoi son contact avec la mort l’avait fait penser : au mysticisme, peut-être ? Non, a dit Russell. « Je pensais que l’eau était froide. »
En lisant « Une aventure terriblement sérieuse : philosophie et guerre à Oxford, 1900-1960 » de Nikhil Krishnan, je me demandais comment il y parviendrait. Il s’agissait d’un érudit déterminé à donner vie à une école de pensée (difficile à faire) qui tournait autour de distinctions capricieuses dans le langage (extrêmement difficile à faire). Le tournant « linguistique » ou « analytique » de la philosophie a résisté aux grandes spéculations sur la réalité et la vérité. Krishnan avait décidé de dramatiser une approche qui n’était absolument pas dramatique.
Krishnan admet que même lui a eu du mal à s’habituer à son sujet lorsqu’il l’a découvert pour la première fois alors qu’il était étudiant en philosophie à Oxford. Une partie de ce qui rend son livre si gagnant est qu’il traite son lecteur comme un partenaire, présentant une gamme d’idées avec le respect qu’elles méritent, de sorte que nous ayons l’impression de réfléchir à ses côtés. Il se souvient de son hypothèse noble selon laquelle les idées les plus profondes étaient intrinsèquement « ineffables », avant de reconnaître qu’il apprenait quelque chose de nettement moins élevé mais peut-être plus profond : comment faire la différence entre ce qui ne peut pas être mis en mots et ce qui peut le faire.
Cet écart est également une préoccupation de l’un de mes livres préférés cette année, « La rigueur des anges », de William Egginton. Professeur de sciences humaines à l’Université Johns Hopkins, Egginton associe philosophie, biographie et critique pour explorer « la nature ultime de la réalité » à travers la vie et l’œuvre de trois personnages : l’écrivain argentin Jorge Luis Borges ; le physicien théoricien allemand et pionnier de la mécanique quantique, Werner Heisenberg ; et le philosophe allemand du XVIIIe siècle Emmanuel Kant. Ces acteurs apparemment disparates sont rassemblés ici parce que les trois hommes avaient quelque chose en commun : ils ont résisté à la tentation de présumer qu’il existait une réalité, là-bas, qui se conformait docilement à nos expériences.
La seule façon de raconter cette histoire avec clarté est d’écrire, comme le fait Egginton, avec élégance et patience. L’idée selon laquelle nous créons notre propre réalité peut sembler être l’autorisation d’une terrible arrogance, mais ce n’est que si nous arrêtons de penser comme Egginton nous pousse à le faire. Nous, les humains, ferions mieux de reconnaître ce que nous pouvons et ne pouvons pas savoir, suggère-t-il. Notre connaissance est toujours partielle et contingente. Au lieu de décréter l’importance de soi, il invite à une certaine humilité.
Je continue de penser souvent à ces trois livres qui sont assez différents mais qui semblent néanmoins dialoguer les uns avec les autres. S’engager à apprendre comme un dialogue entre les gens, plutôt que comme une leçon délivrée d’en haut, exige de l’auteur qu’il fasse quelque chose de risqué : renoncer à un certain contrôle d’auteur. Comme Krishnan le dit si bien dans son livre : « Que personne ne se joigne à cette conversation s’il ne veut pas être vulnérable. »
Alexandra Jacobs
J’ai commencé l’année en révisant les mémoires du prince Harry, « Spare », et j’écris ceci après avoir terminé les 970 pages de Barbra Streisand, « My Name Is Barbra » — éponge délicatement les sourcils avec un mouchoir – donc ceux-ci sont une priorité en ce moment. Comme les livres politiques, ceux des célébrités peuvent étouffer les tendres pousses de fiction comme de la mauvaise herbe. Mais chacun de ces éléments était remarquable, même s’il était imparfait. Harry a travaillé avec JR Moehringer, lui-même un mémoriste profondément talentueux (« The Tender Bar »), ce qui, je parie, lui a donné une saveur plus littéraire. Barbra — vous avez davantage l’impression que cela a été dit à un dictaphone, et elle lit le livre audio, si vous prévoyez un road trip de 48 heures dans un avenir proche. (Tant… beaucoup… d’ellipses !) Mais le long arc de sa vie et ses formidables réalisations dans tous les secteurs font également de ce livre une histoire culturelle, et il est difficile de résister au niveau de détails intimes.
Un autre livre fascinant, quoique imparfait, qui a élu domicile en permanence sur mon étagère – sans doute en partie à cause de sa couverture groovy et parfaite d’époque – est « Les Sullivaniens » d’Alexander Stille. Comme d’autres critiques l’ont souligné, c’est répétitif par endroits. Mais j’étais trop fasciné par le monde perdu qu’il fait revivre – une commune de l’Upper West Side vouée à l’explosion de la famille nucléaire, transformée en culte sexuel abusif – pour m’en soucier.
Les archives psychiatriques ont été bien sondées cette année : voir l’exploration brutale mais audacieuse et potentiellement très utile du suicide de Clancy Martin, « Comment ne pas se suicider ». Je considère « The Best Minds » de Jonathan Rosen, sur son ami schizophrène Michael Laudor, comme le meilleur livre absolu de 2023 : un véritable brise-genre, complexe et émouvant. Dans cet esprit, j’ai également aimé revisiter le classique terni « Sybil » à l’occasion de son 50e anniversaire, même si les lecteurs m’ont, à juste titre, reproché de suggérer que seules les femmes ont du mal à affronter cet anniversaire. Mea culpa!
Une autre revisite, extrêmement agréable, a été la nouvelle édition du roman « Ex-Wife » d’Ursula Parrott. Je n’avais jamais entendu parler de Parrott, à ma grande honte, et elle s’inscrit dans une tradition très importante de l’écriture féminine (et il y a une nouvelle biographie pour l’accompagner). J’aimerais savoir ce qu’en pense Gay Talese – hé, il produit toujours des bangers à 91 ans – et j’aimerais aussi savoir si Talese a déjà été dans une pièce avec George Weidenfeld, l’éditeur haut en couleur dont la biographie, « The Maverick », de Thomas Harding, était un favori inattendu.
Mais en revenant au pays de nouveau fiction, avec tous ses hauts et ses bas, j’ai été frappé de constater que trois de mes romans préférés cette année — « Y/N » d’Esther Yi, « The Vegan » d’Andrew Lipstein et « People Collide » d’Isle McElroy — mettent tous en scène des personnages qui changent de corps ou survolez les fuseaux horaires d’une manière magique. Se pourrait-il que les réalités brutales de notre monde actuel – guerre, creusement des inégalités de revenus, changement climatique – motivent davantage de fictions fantastiques ?
Je suppose que nous verrons dans l’année à venir.
Dwight Garner
Dans le nouveau roman de Sigrid Nunez, « Les Vulnérables », elle présente ce qui est considéré comme un remède infaillible contre le blocage de l’écrivain. L’astuce, écrit-elle, est de commencer par les mots « Je me souviens ». J’ai l’intention de suivre les conseils de Nunez pour cela, mon retour sur une année de lecture ciblée. Les choses dont nous nous souvenons dans les livres ne sont pas toujours celles que nous pensons pouvoir – ou celles que nous devrions. Voici ce que certains des titres de cette année me rapportent.
Je me souviens, en parcourant un volume du journal intégral de Franz Kafka, de son obsession pour les nez. C’était grâce à eux qu’il pouvait comprendre la personnalité de quelqu’un.
Je me souviens, en examinant les mémoires de Priscilla Gilman sur son père, le critique Richard Gilman, que (a) il avait une bonne voix de Cookie Monster et (b) il ne s’est jamais remis de ne pas avoir été sollicité pour contribuer régulièrement à la New York Review of Books. .
Je me souviens, dans le formidable roman d’Eleanor Catton « Birnam Wood », de la raison pour laquelle un personnage s’est lancé dans le jardinage. C’est la même qui peut inciter une personne à lire : « Cela offrait un répit dans cette habitude de critique intérieure acharnée. »
Je me souviens, dans le roman contrefactuel de Catherine Lacey « Biographie de X », qu’elle a permis au poète Frank O’Hara de vivre après avoir été heurtée par cette Jeep sur Fire Island. Je me souviens aussi de m’être ridiculisé. J’ai écrit dans ma critique que son personnage principal « a découvert et enregistré une chanteuse qui ressemble à Karen Dalton ». C’est vrai, dans la mesure du possible. Ce que je ne savais pas, c’est que la personne dont elle parlait, Connie Converse, était une vraie musicienne et une très bonne.
Je me souviens, dans le livre tant attendu de Mack McCormick sur sa recherche du bluesman Robert Johnson dans les années 1970, d’une scène émouvante dans laquelle il localise enfin un groupe de personnes qui connaissaient bien Johnson. Il organise une soirée d’écoute pour eux. Il fait écouter les enregistrements vinyles de Johnson à des personnes qui n’ont pas entendu cette musique depuis 30 ans. C’était comme si, écrit-il, il entendait la musique de Johnson pour la première fois.
Je me souviens, dans les mémoires d’Henry Threadgill sur sa vie dans le jazz, d’un moment de son service dans l’armée pendant la guerre du Vietnam. Lorsqu’on lui a demandé d’arranger un medley de classiques nationaux pour une cérémonie à Fort Riley, au Kansas, Threadgill a tellement étendu les chansons familières, d’une manière quelque peu atonale qui définirait sa carrière, qu’il a été renvoyé du groupe et envoyé au milieu de les combats à Pleiku, au Vietnam. Une « peccadille musicale », écrit-il, lui avait valu une probable condamnation à mort.
Je me souviens, dans le livre de James Campbell « NB by JC », un recueil de ses chroniques pour le Times Literary Supplement, de son commentaire selon lequel les éditeurs étaient autrefois adulés pour avoir publié des livres interdits tels que « L’amant de Lady Chatterley », « Ulysses » et « Lolita. » Aujourd’hui, écrit-il, « un éditeur risque d’être licencié pour avoir publié quelque chose qui ne correspond pas à l’idée que quelqu’un d’autre considère comme « approprié ».
Je me souviens du roman « Kairos » de Jenny Erpenbeck comme d’un pleureur que j’ai pleuré à moitié parce que j’étais d’humeur. Je me souviens également de son observation selon laquelle certaines fleurs (pensées) ressemblent à Karl Marx et que regarder dans le réfrigérateur d’un inconnu équivaut à aller au cinéma.
Je me souviens, dans « Be Mine », le dernier roman de Frank Bascombe de Richard Ford, d’une longue et électrique description de Donald Trump à la télévision qui comprend les mots « Mussolini aux lèvres de chien et aux bras croisés ».
Je me souviens, dans le recueil d’histoires « Onlookers » d’Ann Beattie, du personnage qui prend Burt Bacharach pour Jeffrey Epstein.
Je me souviens, dans le recueil d’histoires « Disruptions » de Steven Millhauser, de la toute petite femme qui atteint l’orgasme en glissant le long de l’oreille de son amant.
Je me souviens avoir appris, grâce à une biographie du dramaturge August Wilson, qu’il fumait même sous la douche.
Je me souviens, dans une biographie de l’artiste, mystique et collectionneur Harry Smith, qu’il aimait collectionner des bandages décollés de tatouages frais, imprimés d’images miroir sanglantes qu’il considérait plus intéressantes que les tatouages eux-mêmes. Il a également collecté « les toux mortelles enregistrées des clochards ».
Je me souviens, dans une biographie de Larry McMurtry, qu’il disait qu’il pouvait lire et conduire en même temps, du moins dans les plaines du Texas. Une fois, arrêté pour excès de vitesse, il a expliqué qu’il avait écrit dans sa tête et qu’il était tout excité.
Je me souviens, dans les mémoires de Werner Herzog, qu’il espérait diriger une production de « Hamlet » et « faire jouer tous les rôles par des commissaires-priseurs de bétail champions : je voulais que la représentation dure moins de 14 minutes ».
Je me souviens de Jonathan Raban, dans ses mémoires posthumes « Père et Fils », écrivant sur un grave accident vasculaire cérébral dont il a été victime à 68 ans. Il n’avait aucune patience avec certains de ses soignants. L’un d’eux lui a posé des questions sur ses selles, et il a trouvé la question impertinente et hors de propos. Poussé plus loin, il répondit finalement : « OK, alors. Les miens sont toujours des modèles en leur genre.
Enfin, pour célébrer l’année, je me souviens d’un autre moment du livre de Priscilla Gilman sur son père. Lors de sa cérémonie commémorative, sa femme a déclaré au public en deuil : « Merci de lui avoir manqué. Il aime qu’on lui manque.