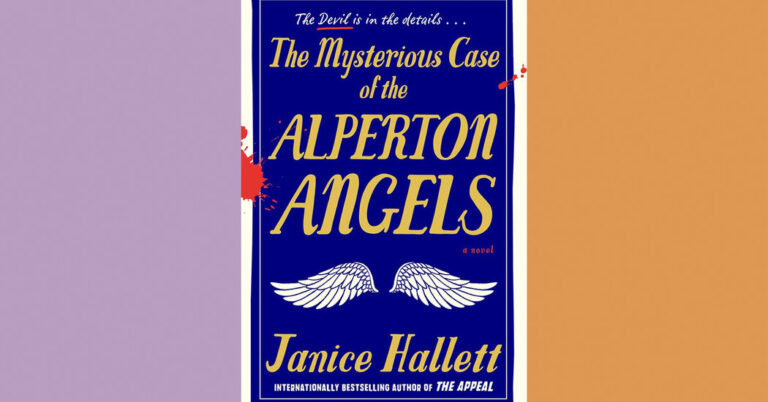Critique de livre : « Time’s Echo » de Jeremy Eichler
En 1947, la musicienne noire allemande Fasia Jansen se tenait dans une rue de Hambourg et commençait à chanter la musique de Brecht avec son fort accent bas-allemand à tous les passants. Peut-être avait-elle appris ces chansons auprès des prisonniers et des internés de Neuengamme, le camp de concentration où elle avait été contrainte de travailler quatre ans plus tôt. Peut-être les avait-elle apprises au début de l’après-guerre, lorsqu’elle se produisait avec des survivants de l’Holocauste dans un hôpital en 1945. Une chose était claire : alors que Jansen luttait contre son traumatisme, la chanson était au centre de son expérience.
Jansen n’apparaît pas dans le nouveau livre de Jeremy Eichler, « Time’s Echo », mais l’envie de se tourner vers la musique pendant et après l’Holocauste en est au cœur. Eichler, critique en chef de la musique classique au Boston Globe, suggère que la musique peut nous aider à nous souvenir de ce que nous avons perdu. « L’écho du temps» est un projet de relance captivant qui révèle la profondeur de la capacité – et de l’incapacité – de l’Europe à pleurer ces pertes.
En apparence, le livre d’Eichler est une histoire culturelle de quatre œuvres musicales : « Metamorphosen » de Richard Strauss, « Un survivant de Varsovie, » d’Arnold Schoenberg.» Le « Requiem de guerre » de Benjamin Britten» et la symphonie « Babi Yar » de Dmitri Chostakovitch. Plus profondément, c’est un appel fascinant à inscrire les histoires des musiciens dans nos actes d’écoute et un témoignage convaincant de la relation entre la musique et la mémoire. Non seulement nous nous souvenons de la musique mais, tout aussi important, «la musique aussi se souvient de nous», argumente Eichler. Face aux innombrables tentatives visant à enterrer le passé, la musique « possède le pouvoir unique et souvent sous-estimé de brûler les réserves froides de l’histoire ».
En prose lyrique, Eichler raconte l’histoire des Juifs germanophones d’Europe qui, à partir de la fin du XIXe siècle, ont finalement connu un certain soulagement face aux lois antisémites qui pesaient sur leur vie et en sont venus à adopter la musique, la littérature et l’art allemands comme une source d’inspiration. signifie façonner leur nouveau moi. « En théorie du moins », écrit Eichler, « n’importe qui pourrait adopter ces idéaux de transformation personnelle sur les ailes de la culture. » Schoenberg est devenu majeur à ce moment-là. Pour lui, comme pour beaucoup d’autres Juifs d’Europe centrale, tout semblait possible, y compris réinventer la musique elle-même.
La montée du nazisme dans les années 1930 a brisé cet optimisme. « Comme mon cœur saignait quand l’idée m’est soudainement venue que je ne devais plus être Allemand », a réfléchi plus tard Schönberg. Méprisé par la société dans laquelle il avait grandi, ses œuvres commençaient à refléter de plus en plus son héritage juif.
La réponse de Richard Strauss aux nazis continue de confondre ses admirateurs. Strauss, qui n’était pas juif, a directement bénéficié de la purge des Juifs des institutions européennes, en acceptant des postes musicaux très vénérés au sein du Troisième Reich. Lorsque son librettiste juif Stefan Zweig se plaignit de son travail culturel auprès du régime en 1935, Strauss répondit : « Soyez un bon garçon, oubliez Moïse ».
En 1944, nous raconte Eichler, Strauss a tenté de dégager la grand-mère de sa belle-fille juive d’un camp de concentration au nord de Prague. « Je m’appelle Richard Strauss et je suis venu emmener Mme Neumann », a-t-il déclaré à un garde, ce qui a suscité l’amusement et le ridicule. L’année suivante, caché du monde dans la ville bavaroise de Garmisch-Partenkirchen, Strauss termine ses « Metamorphosen ».
Certaines des œuvres antérieures de Strauss, comme son opéra-comique « Le Chevalier à la rose » de 1911, sont pétillantes, ironiques, voire nostalgiques. Mais dès les premiers instants de « Metamorphosen », les basses descendent immédiatement une ligne chromatique vers un profond deuil. « Finies les façades scintillantes de l’ironie et de l’esprit », écrit Eichler, « Finies les héros libérés ».
Il s’agit d’une œuvre luxuriante et sa beauté est d’autant plus choquante si l’on considère les activités de Strauss pendant la guerre – ce qui est exactement le point de vue d’Eichler. Connaître les histoires de ces compositeurs, affirme Eichler, devient « une partie de ce à quoi nous arrivons ». entendre dans les œuvres elles-mêmes.
S’il y a un rebondissement dans « Time’s Echo », il survient dans la seconde moitié, quand Eichler nous transporte dans la Grande-Bretagne de la guerre froide et en Union soviétique pour nous montrer comment les artistes ont absorbé l’Holocauste en dehors de l’Europe centrale. Pour Benjamin Britten, dans l’Angleterre des années 1960, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale avaient cimenté sa pensée pacifiste.
Son « War Requiem », créé pour la première fois en 1962, est un opus magnum envoûtant qui met en musique la poésie anti-guerre de Wilfred Owen. Dans un premier passage, le son des cloches et la prière d’une chorale pour les soldats tombés au combat sont interrompus lorsqu’un ténor chante la question brûlante d’Owen : « Quelles cloches passantes pour ceux qui meurent comme du bétail ?
La même année, Chostakovitch compose une pièce commémorant le massacre de Babyn Yar en 1941, au cours duquel les Allemands ont assassiné plus de 33 000 Juifs à Kiev, en Ukraine. Le gouvernement soviétique des années 1960 a refusé de reconnaître que le génocide antisémite était au centre du nazisme et a tenté de censurer l’œuvre. En décembre de la même année, le public assis au Conservatoire de Moscou pour la première de la symphonie a éclaté sous les applaudissements. Pourtant, « Babi Yar » n’a eu qu’une poignée de représentations dans le bloc soviétique avant d’être effectivement interdit.
Le livre d’Eichler excelle lorsqu’il s’interroge sur les luttes, peut-être futiles, de ces œuvres pour remplir leurs propres missions. À quoi sert un message pacifiste face au génocide et au déni historique ? En tentant de créer une déclaration universelle de perte avec son « War Requiem », écrit Eichler, Britten « a laissé les ténèbres de l’histoire plus récente sans récit ni réconciliation ». Sur la dernière page de « Metamorphosen », Strauss a écrit les mots « IN MEMORIAM », mais n’a jamais précisé exactement de qui ou de quoi il voulait qu’on se souvienne.
Cela vaut la peine de se demander si ces quatre hommes canoniques constituent les meilleurs canaux par lesquels raconter cette histoire particulière du passé. Il n’y a pas de place ici pour les Fasia Jansens ou les Ruth Schonthals du monde.
Ces dernières années, un débat a pris feu parmi les historiens sur la question de savoir s’il fallait ou non réunir le colonialisme et l’Holocauste dans un même cadre. Nous pourrions prêter attention à la place de la musique classique dans cette discussion tendue dans l’œuvre du brillant chef de chœur nigérian Fela Sowande, qui a composé des pièces orchestrales pour le ministère britannique de l’Information pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors que Strauss et Britten étaient tous deux cachés à la campagne en 1944, Sowande dirigeait sa « Suite africaine », un mélange de mélodies ouest-africaines et d’instruments européens, pour la radio de la BBC dans un Londres bombardé. La suite prend un nouveau registre lorsqu’on l’entend comme un artefact qui amplifie la position compliquée d’un sujet colonisé chargé de servir l’effort de guerre au nom de l’empire.
Malgré ces absences, les riches détails historiques qu’Eichler a choisi de rassembler dans son livre en font une lecture émouvante. « Time’s Echo » propose le même genre d’expérience immersive qu’il nous encourage à explorer en musique. Sa belle méditation sur les ombres sombres qui ont poussé, propulsé et finalement hanté la musique classique en Europe pendant et après la Seconde Guerre mondiale inspire nos oreilles.