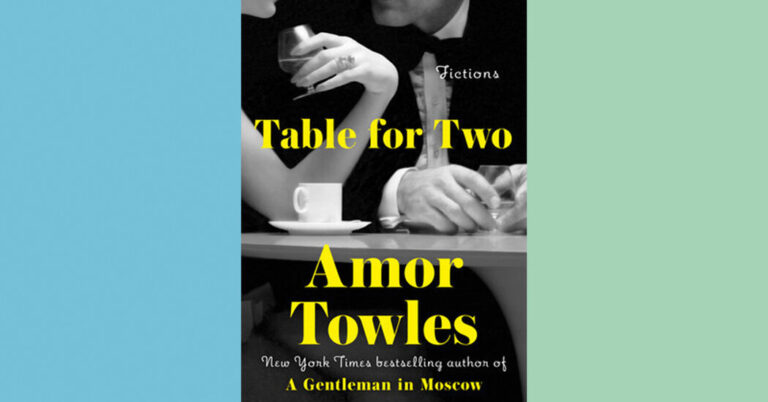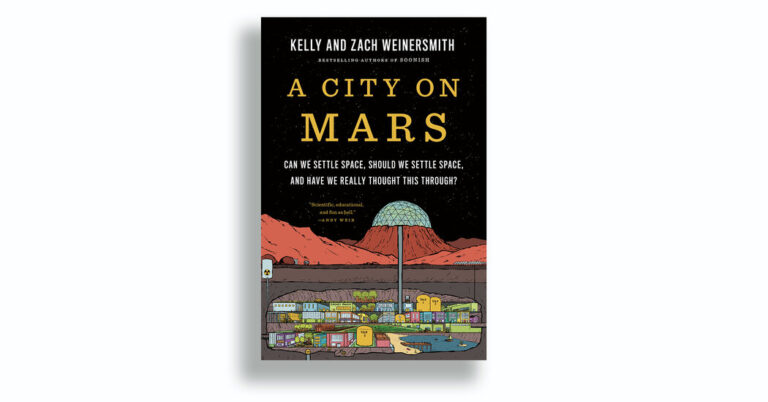Critique de livre : « The 272 », de Rachel L. Swarns
Pendant la guerre de 1812, une grande famille élargie de Mahoneys a vécu et travaillé comme esclave dans plusieurs plantations du sud du Maryland. Ils étaient les descendants d’une femme noire nommée Ann Joice, qui était arrivée d’Angleterre vers 1676 en tant que servante sous contrat. Pendant des années, elle a servi l’un des hommes les plus riches du Maryland, Charles Calvert, comme domestique dans son manoir. En 1684, elle fut transférée au cousin de Calvert, Henry Darnall, un riche catholique, qui brûla rapidement ses papiers d’engagement, la rendant esclave à vie.
Au milieu de la guerre, Thomas Mulledy et William McSherry, deux jeunes Virginiens, étaient étudiants au petit Georgetown College (aujourd’hui Georgetown University) à Washington, DC, la première institution catholique d’enseignement supérieur du pays, alors âgée d’un peu plus de deux décennies. . Fils d’immigrants irlandais devenus esclavagistes, le couple a rejoint la Compagnie de Jésus, un ordre de prêtres catholiques fondé en 1540 et connu dans le monde entier pour son dévouement à l’éducation et la création d’écoles et de collèges. Les jésuites ont saisi le chemin du pouvoir et de la richesse dans le Maryland d’avant-guerre, asservissant des centaines de personnes et exploitant plusieurs plantations de blé et de tabac dans l’État.
« The 272 », le nouveau livre profondément documenté et révélateur de Rachel L. Swarns, est l’histoire du remarquable clan Mahoney et comment leurs vies, près d’un siècle et demi après celle d’Ann Joice, se sont croisées avec celles de Mulledy, McSherry et des jésuites en l’une des tragédies les plus meurtrières de l’esclavage américain. « The 272 » est une méditation fascinante sur le sens de l’esclavage et des personnes converties à la propriété et aux marchandises – actifs de richesse et objets de vente. C’est un livre qui voyage au cœur des ténèbres de l’esclavage : vers la séparation des familles, la terreur d’être vendu dans le vaste inconnu et des corps transformés en profits et en investissements. Mais c’est aussi l’histoire humaine émouvante de certaines des personnes qui ont enduré et survécu à cette épreuve, et qui attendent depuis longtemps d’être redécouvertes.
Swarns, écrivain collaborateur pour le New York Times et professeur de journalisme à NYU, est un catholique afro-américain qui a grandi à Staten Island. En commençant par un article dans The Times en 2016, elle a révélé l’histoire des jésuites en tant que propriétaires d’esclaves et commerçants, ce qui a conduit à un bilan étonnant de l’Université de Georgetown avec son passé ainsi qu’au sein de l’ordre jésuite lui-même. Swarns écrit avec un œil vif et une voix distinctive à la fois sur ses sujets noirs et sur l’hypocrisie et la brutalité de leurs anciens propriétaires. Cependant, les jésuites n’étaient pas un monolithe de cupidité et de mal ; Swarns entretient de l’empathie pour certains qui ont tenté, en grande partie sans succès, de protéger les esclaves qu’ils avaient connus de si près de l’agonie de la vente qui plane sur cette histoire.
Dans les archives jésuites en Europe et aux États-Unis, dans les archives de l’État du Maryland et en particulier dans les archives de l’esclavage de Georgetown, Swarns a découvert une saga profonde, parmi un nombre croissant, sur les origines d’une université et ses enchevêtrements avec l’esclavage. Pendant si longtemps, sur de nombreux campus, y compris le mien, Yale, il y a eu des silences dans les livres mais pas dans les archives. Ce sous-domaine en plein essor de l’étude historique a à peine 20 ans et a déjà produit d’importantes monographies, mémoriaux et histoires narratives. La réalisation phare de Swarns consiste à reconstituer l’histoire d’une tempête lente et dévastatrice se déplaçant à l’horizon du Maryland, alors que le jésuite Georgetown, endetté à la suite d’une ambitieuse campagne de construction aggravée par une mauvaise gestion fiscale, a décidé en 1838 de vendre près de 300 personnes afin d’assurer sa survie.
À ce moment-là, McSherry était devenu président de Georgetown, succédant à Mulledy, qui a assumé le poste de chef jésuite pour la province du Maryland. Les deux hommes croyaient qu’une vente de biens humains était le seul moyen de sauver Georgetown de la ruine financière. Un débat angoissant entre les jésuites a finalement abouti à la vente de 272 hommes, femmes et enfants à deux planteurs de la Louisiane, Henry Johnson, un membre du Congrès, et Jesse Batey, un médecin.
Les Mahoney avaient depuis longtemps une « promesse » des jésuites les plus proches d’eux que leur famille ne serait jamais séparée. Harry, le patriarche, avec sa femme, Anna, avait servi héroïquement lors de l’invasion britannique du comté de St. Mary en 1814, protégeant la propriété et les intérêts des jésuites. Mais lorsque la nouvelle de la grande vente a envahi leurs humbles cabines, Swarns écrit: « L’amour de Harry et Anna, à lui seul, ne suffirait pas à assurer la sécurité de leurs enfants. »
Cela ne protégerait pas non plus tant d’autres familles d’esclaves déchirées par la vente. Certains jésuites ont été indignés par la transaction; d’autres sont tombés sur des justifications répétées depuis longtemps sur «l’immoralité» et le manque de fiabilité pesant de la population asservie. La vente à Johnson et Batey a rapporté aux jésuites et à Georgetown la coquette somme de 115 000 dollars, soit environ 422 dollars par personne, soit un total d’environ 3,76 millions de dollars aujourd’hui. Parmi les 130 passagers de l’un des navires loués pour transporter les êtres humains vendus au sud de la Nouvelle-Orléans se trouvaient deux personnes de 70 ans et un bébé de 2 mois.
Lorsque Swarns écrit sur les descendants des 272, son histoire est tout aussi convaincante, bien que son récit passe quelque peu à la hâte à la guerre civile, à la « liberté » et au-delà. Avec peu de données sur lesquelles s’appuyer, elle spécule sur la vie de deux des filles de Harry, Anna et Louisa. Anna et ses deux jeunes enfants ont été expédiés dans une plantation Johnson en Louisiane, puis dans une autre. Louisa est restée avec ses parents dans le Maryland, parmi une demi-douzaine de Mahoney laissés pour compte. La chronologie et les structures familiales peuvent être un peu confuses dans le récit par ailleurs magnifiquement écrit de Swarns. (Le livre aurait bénéficié de quelques arbres généalogiques.) Afin de créer un contexte où elle n’a pas de sources spécifiques, Swarns s’appuie sur des récits d’esclaves célèbres pour raconter son histoire. Elle s’appuie probablement un peu trop sur « Twelve Years a Slave » de Solomon Northup.
Un thème central, que Swarns aurait pu approfondir encore, est le catholicisme lui-même. La famille Mahoney est restée catholique au fil du temps, tandis que d’autres, notamment en Louisiane, ont abandonné l’église. Dans un récent article d’opinion dans The Times, Swarns a observé que son lien avec l’église n’avait fait que se renforcer à travers le processus de travail sur cette histoire déchirante. Mais à part montrer comment les jésuites s’occupaient de leurs troupeaux de fidèles et mentionner des chapelets, des hymnes, des prières et d’autres rituels, l’enjeu du catholicisme dans ce livre semble irréalisé.
Ici et là, un faux pas historique se produit, bien que ceux-ci ne devraient pas affecter l’impact du livre dans le milieu universitaire et au-delà. Par exemple, les Européens ont fait peu de « saisie » de « territoire » lorsqu’ils se sont déplacés vers l’Afrique de l’Ouest pour faire le commerce des esclaves. Swarns rappelle plus que nécessaire l’hypocrisie des jésuites ; tout le livre incarne ce fait. Pourtant, elle démontre bien le rôle du Vatican en rejetant parfois puis en approuvant les ventes d’esclaves dans le Maryland. La performance des dirigeants de l’église dans cette histoire a été essentiellement irréprochable.
Ce qui ressort le plus efficacement, c’est le chagrin et la détermination à survivre des esclaves que Swarns met en lumière à travers sa prose détective et résonnante. (À propos d’Ann Joice, Swarns écrit : « Elle n’aurait ni richesse, ni terre, ni économies pour quitter sa famille, mais elle avait toujours son histoire. … L’histoire serait son héritage. » Swarns souligne également l’importance de Georgetown. efforts pour obtenir de sérieuses réparations pour les actes de ses premiers dirigeants. L’université a identifié plus de 6 000 descendants des 272 d’origine, leur a offert un statut officiel d’« héritage » pour l’admission, a demandé l’expiation par le biais d’excuses très médiatisées et a créé un fonds qui consacrerait 400 000 $ par an à des projets communautaires, y compris le soutien aux cliniques de santé et écoles, susceptibles de profiter aux descendants. Les dirigeants de la conférence jésuite des prêtres se sont également engagés à établir une fiducie de 100 millions de dollars au profit des descendants et à promouvoir la réconciliation raciale.
Aucun ouvrage historique ne peut remédier à la question délicate de la réparation de l’esclavage en Amérique, mais « The 272 » fait avancer la conversation et défie la conscience collective ; sans connaître cette histoire dans sa complexité, il ne nous reste plus qu’une mémoire brute et inexplorée.