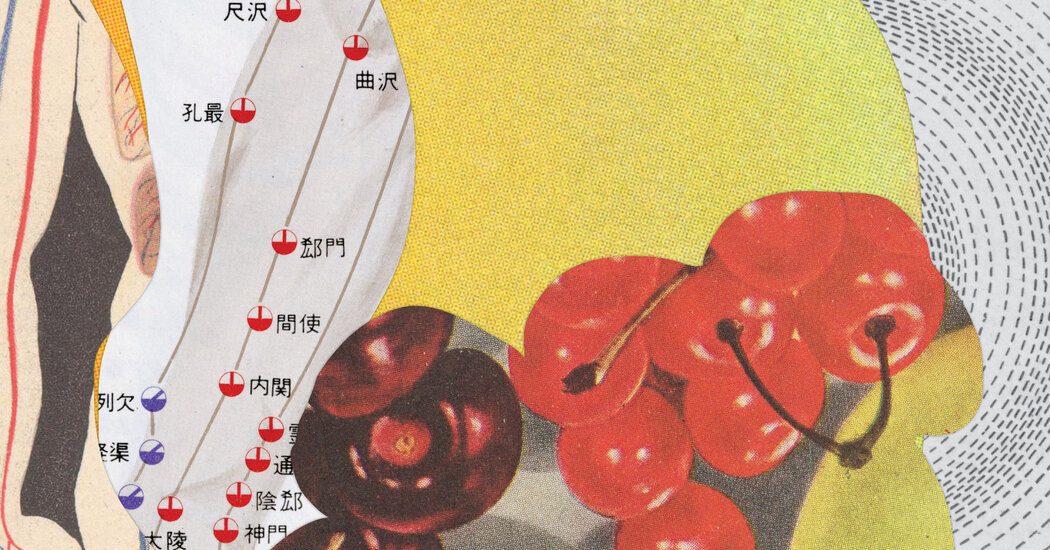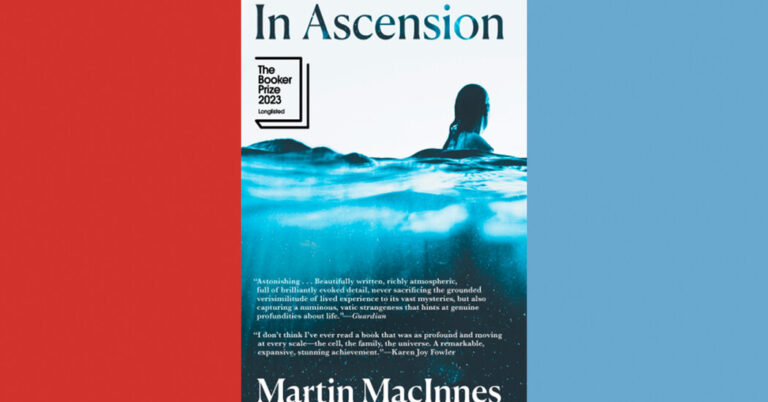Critique de livre : « Si tard dans la journée », de Claire Keegan ; « Tomb Sweeping », d’Alexandra Chang ; « Déjeuner des dames », de Lore Segal ; « L’enfant du mercredi », de Yiyun Li
L’écrivain de nouvelles « ne peut pas créer de la compassion avec de la compassion, ni de l’émotion avec de l’émotion, ni de la pensée avec de la pensée », a écrit Flannery O’Connor. « Quand vous pouvez énoncer le thème d’une histoire, quand vous pouvez le séparer de l’histoire elle-même, alors vous pouvez être sûr que l’histoire n’est pas très bonne. » Selon cette métrique, Claire Keegan, un recueil d’une nouvelle et de deux nouvelles explorant toutes la misogynie à travers les yeux de femmes qui y réagissent et d’hommes qui y réagissent, n’est rien de moins qu’un chef-d’œuvre. À travers les récits d’un mariage annulé, de la résidence interrompue d’un écrivain et de la dangereuse infidélité d’une femme avec un étranger, la main délicate de Keegan éloigne le lecteur de la moralisation évidente vers la banalité du sectarisme.
Dans la nouvelle titre, l’auteur irlandais de « Small Things Like These » et « Foster » dépeint Cathal abandonné juste après que sa fiancée, Sabine, l’ait quitté. Il dresse le bilan de leur relation comme un grand livre de coûts et de charges : les cerises qu’il a payées à contrecœur lorsqu’elle a oublié son portefeuille, le catalogue des biens qu’elle a emménagé dans sa maison « comme si la maison lui appartenait désormais également ». En retenant l’accusation de chauvinisme de Sabine jusqu’à la seconde moitié, Keegan circonscrit le lecteur dans les petites obsessions de l’amertume de Cathal, rendant impitoyablement les préjugés les plus insidieux de ceux qui ne peuvent pas se voir.
Comme pour laisser entendre qu’une telle haine et une telle répression défient toute comparaison figurative, la fiction se rapproche le plus de la métaphore poétique dans l’évitement par Cathal des bavardages avec un étranger dans un bus, ses réponses brèves « enfilant le discours dans un coin, où il pourrait aller ». pas plus loin. »
En revanche, « Days of Distraction », la suite d’Alexandra Chang à son premier roman, « Days of Distraction », évoque peu de personnages, d’émotions ou de conflits mémorables. Bien que les préoccupations thématiques des histoires sur le caractère insaisissable des classes sociales en Amérique, en particulier celles vécues par les communautés d’immigrés, soient nécessaires et convaincantes (les personnages montent et descendent péniblement les échelons de la sécurité du logement, de l’éducation, de l’emploi et de la documentation), la collection échoue pour l’essentiel à convaincre. situer ces thèmes dans les particularités émotionnelles de la vie de chaque protagoniste. Les sentiments sont exprimés sans ambages, plutôt que exprimés par des actions illustratives : « Elle aimait tellement sa mère que cela lui faisait peur » ; « Depuis, je n’ai plus ressenti autant de sentiments pour un ami. »
Dans un livre sur les liens entre des individus qui tentent d’équilibrer leur propre survie avec les dettes qu’ils ont les uns envers les autres, il faut s’attendre à un excès de dialogue ; mais celui de Chang s’appuie trop sur des exclamations en bois comme « bon sang », « hmmm », « ouais ! et « duh », ennuyant les opportunités de compréhension.
Bien que Chang suive parfois une curiosité formelle avec un effet intéressant – « Li Fan » retrace un récit de l’itinérance à l’envers, remettant en question les hypothèses sur qui exactement le malheur peut frapper – les conclusions peuvent paraître faibles et anodines. À la fin de « Klara », la narratrice pense qu’elle sent son téléphone vibrer avec un texte de son ancienne amie titulaire, pour se rendre compte que la vibration était un « sentiment fantôme ».
Un léger dialogue dissimule la gravité dans la collection mystérieuse et fascinante de Lore Segal, dont les histoires liées suivent principalement un groupe d’amis dans les années 80 et 90 vivant à New York. Un lecteur moins attentif pourrait être charmé par ces vieilles femmes – qui luttent pour se souvenir de certains faits, rangent leurs cannes pour aller chercher des martinis lors d’un shiva – mais Segal sape habilement la pulsion de la société à infantiliser, voire à déshumaniser, les personnes âgées.
Ses personnages, souvent hilarants, affichent une profondeur de compréhension qui dépasse le pédantisme des détails oubliés. «Je ne comprendrai jamais pourquoi quelque chose conçu pour paraître tridimensionnel ou virtuel nous excite plus que la chose réelle devant notre nez», dit Lotte. «Mimesis», répond son amie Farah. « Est-ce Aristote ou est-ce moi qui ai dit que nous aimons une ressemblance, dans laquelle, je suppose, nous nous cherchons ? »
S’il ne se passe pas grand-chose dans « Ladies’ Lunch », les conversations parfois schmaltzy des femmes sur leur passé et sur d’autres personnes cèdent la place à des portraits enrichissants de qui elles sont seules. Le lien qui se dilue progressivement entre Lotte et sa plus vieille amie Bessie constitue le centre émotionnel bouleversant du livre ; ce qui apparaît dans certaines histoires comme une distance anodine entre eux se révèle dans d’autres comme une aliénation glaciale. Dans une lettre à Bessie, Lotte décrit son dégoût pour le mari riche et xénophobe de son amie, comparant sa pelouse clôturée à « un jardin de jouets conservé dans la boîte dans laquelle il est arrivé ».
Segal est un grand manipulateur de stéréotypes, insistant sur le fait que le vieillissement ressemble moins à une peinture allègrement superposée qu’à une galerie de portraits contradictoires, souvent pénibles à divertir dans le même esprit.
Celle de Yiyun Li est une autre fouille triomphale, quoique plus oblique, du vieillissement. Dans « Such Common Life », à la fois pointu et tendre, le narrateur nage facilement entre l’esprit d’un praticien de médecine orientale d’âge moyen et celui d’un biologiste de 88 ans qui est sceptique quant à l’expertise du premier. Impressionniste chevronné, Li juxtapose des images sensuelles – une femme âgée faisant du patin à glace avec les mains d’un accompagnateur de chaque côté d’elle, « son rôle étant celui des sépales sur sa fleur » – avec des poignards aphoristiques : « La façon de vivre de chacun détermine sa façon de vivre ». en train de mourir. » La portée étroite des histoires maintient la sentimentalité à l’écart et la vie réelle des personnages dans une proximité querelleuse.
Bien qu’elle soit virtuose de la narration à la troisième personne plus traditionnelle et omnisciente, Li est à son meilleur dans le registre moderne à la première personne de l’histoire finale, « All Will Be Well », racontée à distance de plusieurs décennies et à la suite de la défaite. un enfant. La narratrice, professeur et mère de famille élevée à Pékin, se souvient s’être retrouvée il y a longtemps « accro à un salon » en Californie où elle faisait semblant de ne pas comprendre le cantonais parlé par le personnel, leur disant qu’elle avait été adoptée par des parents néerlandais et élevée principalement en les États Unis. La narratrice n’explique jamais la raison de son mensonge, ni pourquoi elle a ressenti du ressentiment en écoutant les histoires d’amour du propriétaire du salon laissées dans son Vietnam natal. Cette discontinuité fascinante entre la vie intérieure et la vie extérieure rappelle au lecteur que la meilleure courte fiction, même lorsqu’elle commente le monde dans son ensemble, opère avec plus de puissance au niveau des personnages individuels – compliquant leur vision d’eux-mêmes et clarifiant notre compréhension du comportement. que cette grande douleur rend possible.