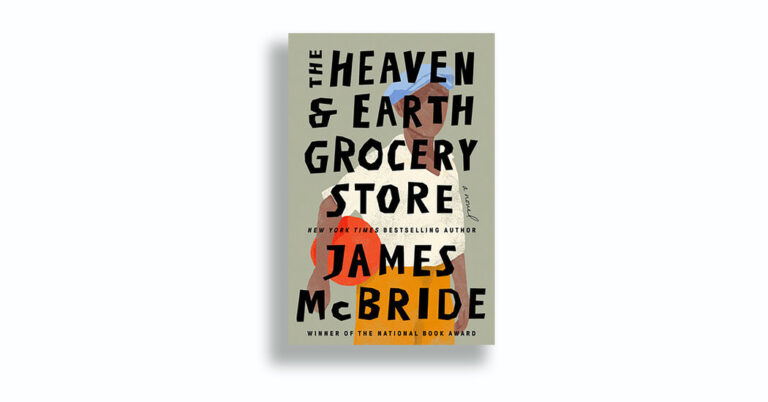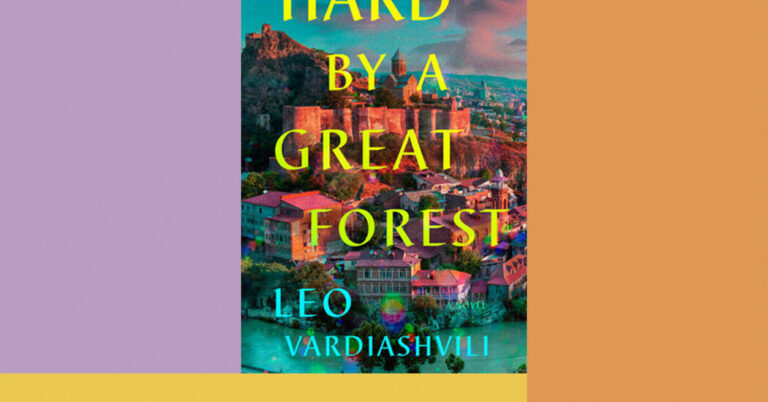Critique de livre : « Si nous brûlons », de Vincent Bevins, et « The Loom of Time », de Robert D. Kaplan
Début novembre 1914, alors que les nuages d’orage de la Première Guerre mondiale se rapprochaient du Moyen-Orient, le consul général américain à Beyrouth envoya un message urgent au secrétaire d’État américain. « Monsieur », a écrit W. Stanley Hollis, « j’ai l’honneur de signaler que les conditions vont de mal en pis ici. »
Je me suis souvenu des notes de Hollis en lisant « If We Burn » de Vincent Bevins et « Le métier à tisser du temps » de Robert D. Kaplan. Dans les deux ouvrages, nos interlocuteurs, récemment revenus de voyages dans certaines des zones les plus intempérées de la planète, exposent leurs découvertes. Leurs montures sont assez différentes. Alors que Bevins s’intéresse aux mouvements de protestation de masse des quinze dernières années et se demande pourquoi les choses ont si mal tourné, Kaplan a parcouru le grand Moyen-Orient à la recherche d’indices sur ce que pourrait lui réserver l’avenir proche. Alerte spoiler : il semble que Hollis l’avait à peu près bien fixé.
En tant que correspondant du Los Angeles Times, Bevins a passé une grande partie du début des années 2010 à faire des reportages en Amérique latine, suivi d’une longue tournée en Asie du Sud-Est pour le Washington Post. Son premier livre, « Méthode de Jakarta », acclamé par la critique, était un exposé cinglant du rôle central joué par la CIA dans l’orchestration du sauvage pogrom anticommuniste indonésien de 1965. « Si nous brûlons » est à la fois plus ambitieux et plus vaste.
Depuis les révoltes du Printemps arabe au Moyen-Orient jusqu’à ce qu’on appelle la Révolution aux chandelles en Corée du Sud, selon Bevins, les années 2010 ont vu plus de manifestations de masse dans le monde que toute autre période similaire dans l’histoire de l’humanité. « Il pourrait même être possible de raconter l’histoire de cette décennie comme celle de manifestations de masse et de leurs conséquences inattendues », écrit-il.
Si tel est le cas, l’histoire est décidément triste. Sur les dix mouvements de protestation qu’il relate, Bevins n’en identifie qu’un comme un succès absolu, et sept comme des échecs lamentables, avec des conditions politiques souvent pires qu’elles ne l’étaient au départ. « Comment est-il possible, demande-t-il, que tant de manifestations de masse aient apparemment abouti à l’opposé de ce qu’elles demandaient ?
Bevins affirme que l’explosion des médias sociaux a contribué à alimenter un mépris croissant à l’égard des partis politiques traditionnels dans les pays démocratiques, un mépris qui se reflète dans les manifestations ainsi que dans tout, du mouvement Brexit en Grande-Bretagne à la scène underground anarcho-punk au Brésil. Il souligne également que, comme les manifestations spontanées manquaient souvent de dirigeants clairement identifiables, tout vide de pouvoir qui en résultait était rapidement comblé par l’État, les différentes composantes des mouvements de protestation se disputant ou se faisant concurrence.
Ces deux choses sont peut-être vraies dans les pays démocratiques, mais Bevins compare des pommes avec des oranges lorsqu’il transmet ces idées aux pays autocratiques, en particulier ceux touchés par le Printemps arabe. Aussi imparfaites soient-elles, les gouvernements du Brésil et de la Corée du Sud sont en fin de compte responsables devant le peuple ; leurs instruments de répression sont limités. On n’a jamais dit la même chose de l’Égypte, du Yémen ou de la Syrie, où les régimes dictatoriaux ont bénéficié d’un vaste répertoire de mesures pour contrôler leurs mécontents, allant jusqu’à les mitrailler dans les rues.
En désamorçant le mouvement des Parapluies à Hong Kong, par exemple, les autorités ont essentiellement attendu que l’opposition disparaisse. En Syrie, ils ont largué des barils explosifs sur eux et réduit en cendres des quartiers entiers. Dans la mesure où un point commun existe ici, il pourrait être réduit à l’aphorisme cynique : « Celui qui a les armes gagne ». Cela semble être une récompense plutôt mince pour le long voyage que nous avons entrepris.
Et vraiment aucune récompense pour des gens comme Robert Kaplan, journaliste renommé et auteur d’une vingtaine de livres. Le métier de Kaplan est de savoir comment la géographie peut façonner la culture d’un pays et, par extension naturelle, sa politique. Son livre le plus célèbre, « Balkan Ghosts », a cartographié les fissures internes qui se trouvaient sous la surface de l’ex-Yougoslavie et aurait servi de lecture essentielle au président Bill Clinton alors qu’il tentait de surmonter les conséquences de l’effondrement sanglant de la nation. Sur une note plus ignominieuse, Kaplan était un ardent défenseur de l’invasion américaine de l’Irak en 2003, espérant que cela mettrait fin au « totalitarisme sanglant de Saddam Hussein », un plaidoyer qu’il considère désormais comme un faux pas colossal et dont il s’excuse depuis lors. .
Cela dit, ses nombreux voyages à travers le grand Moyen-Orient ont fait de lui un homme dur – même s’il préférerait sans doute le terme de « réaliste ». Pas pour lui les notions fantaisistes d’engagement civique ou de démocratie parlementaire ; au lieu de cela, affirme-t-il dans « The Loom of Time », une autocratie éclairée est probablement la meilleure que la région puisse espérer.
« Plutôt que de nous plaindre exclusivement de la démocratie dans le grand Moyen-Orient, nous devrions plutôt souhaiter des régimes consultatifs plutôt que des régimes arbitraires : c’est-à-dire des régimes qui sondent l’opinion publique même s’ils n’organisent pas d’élections », écrit-il. « En d’autres termes, visez ce qui est possible plutôt que ce qui est simplement juste. »
Si un tel point de vue est un anathème pour les penseurs libéraux, il y a quelque chose à dire en faveur d’un tel point de vue – il suffit de voir à quel point les élections organisées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan se sont bien déroulées – mais c’est en insistant sur ce point que Kaplan s’épuise un peu.
En plus de remonter dans l’histoire pour rassembler le panthéon habituel des orientalistes – Arnold Toynbee, Elie Kedourie, Samuel Huntington – dans la plupart des pays visités par Kaplan, il convoque une liste de têtes parlantes locales. Il s’agit généralement d’un groupe bien accrédité, mais ils sont également largement impossibles à distinguer les uns des autres puisque leur fonction première est d’être d’accord avec les affirmations de l’auteur selon lesquelles la tyrannie est toujours préférable à l’anarchie et que les États-Unis feraient mieux d’en prendre conscience.
Dans un chapitre sur l’Égypte, son chœur dénonce les troubles qui ont secoué le pays en 2012, en attribuant la responsabilité au gouvernement éphémère de Mohamed Morsi, qui s’est terminé par une prise de pouvoir militaire sanglante. Kaplan affirme que la plupart des Égyptiens sont « encore traumatisés par leur expérience » pendant l’ère Morsi, et que « l’écrasante majorité » ne souhaite « que le calme et la sécurité économique ».
Cela est peut-être vrai pour les Égyptiens privilégiés avec lesquels Kaplan s’est entretenu, mais sûrement pas pour l’ensemble des 13 millions d’électeurs qui ont fait de Morsi le premier dirigeant démocratiquement élu de leur pays, ni pour les quelque 70 000 prisonniers politiques qui croupissent aujourd’hui dans la dictature la plus brutale de l’Égypte récente. histoire.
De même, les saoudiens interrogés les uns après les autres se lèvent pour défendre le règne du prince héritier Mohammed ben Salmane dans un langage étrangement similaire, faisant suite à une liste de mesures progressistes adoptées au cours de son mandat – élargissement des droits des femmes, répression de la corruption – avec une version de la question rhétorique : « N’est-ce pas un droit de l’homme ? C’est comme si, avant de rencontrer Kaplan, ils avaient tous reçu le même mémo de discussion du ministère saoudien de l’Information. Kaplan lui-même admet que le prince Mohammed est sujet à des « erreurs horribles », comme le meurtre et le démembrement à la scie à os du journaliste Jamal Khashoggi.
Derrière tout cela se cache une admiration pas si cachée pour le caudillo. Alors que Kaplan concède tièdement une certaine irascibilité dans leur comportement, il considère clairement le Syrien Hafez al-Assad – celui qui a participé au massacre de Hama en 1982, qui a fait environ 20 000 morts – comme le meilleur dirigeant que cette nation obscurcie était susceptible d’avoir, tout en suggérant que l’Égypte Abdel Fattah el-Sisi (« plus à l’aise avec les ingénieurs et tous ceux qui construisent des choses qu’avec les intellectuels ») suit le même « chemin ambitieux » que l’un des dictateurs éclairés préférés de Kaplan, Lee Kuan Yew de Singapour.
Même si ce n’est sûrement pas son intention, l’appréciation constante de Kaplan pour l’ordre plutôt que le désordre, jointe à son estimation du type de gouvernance qu’il estime que les peuples du grand Moyen-Orient sont capables de réaliser, commence à remettre en question la raison pour laquelle il avait une telle vision. problème avec Saddam Hussein en premier lieu.