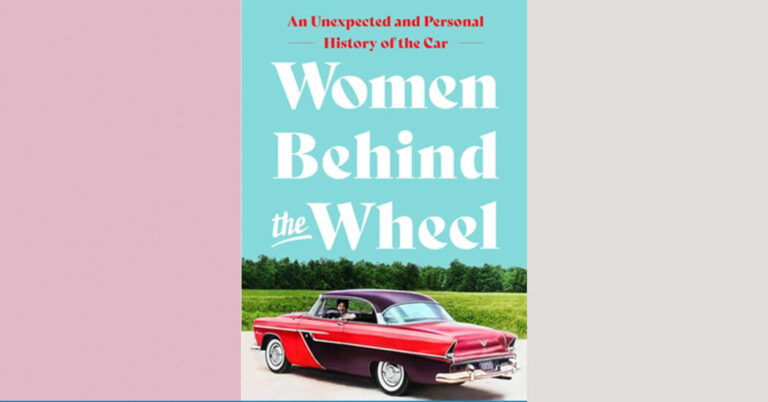Critique de livre : « Partir », de Roxana Robinson
Chaque histoire d’amour a besoin d’un obstacle, de quelqu’un ou de quelque chose qui menace de séparer les amants. Quels obstacles conviennent à une histoire d’amour américaine contemporaine ? L’auteur d’une telle histoire souhaitera peut-être éviter la communication excessive, la tolérance (réelle ou jouée) et le blasement qui dissipent les tensions romantiques. Les amoureux peuvent-ils encore être « maudits », condamnés dès le départ à travailler sous une « étoile maligne » ?
Ils le peuvent, dit Roxana Robinson, dans son élégante histoire d’amour « Leaving ». (Robinson est l’auteur de neuf œuvres de fiction antérieures, ainsi que d’une biographie de Georgia O’Keeffe.)
Warren et Sarah, deux sexagénaires qui formaient un couple dans leur jeunesse, se croisent lors de la représentation de « Tosca ». Il y a des années, Sarah avait envisagé d’épouser Warren, mais avait décidé qu’il ne serait pas un choix judicieux comme compagnon. Ce qui le rend charmant une fois réapparu à 60 ans – ses enthousiasmes, son intense désir d’intimité – a effrayé la jeune Sarah, et elle a plutôt misé sur Rob. Il s’est avéré qu’il n’était pas le bon choix et le mariage a été un échec. Lorsque Warren et Sarah se rencontrent à l’opéra, ils ont une affaire inachevée.
Les deux vivent une vie heureuse jusqu’à cette rencontre. Warren est marié, tandis que Sarah, mère de deux enfants adultes et divorcée depuis longtemps de Rob, est mariée à sa maison boisée, à sa solitude et à son chien exceptionnellement humain. Mais au fur et à mesure que le récit évolue en douceur entre les deux points de vue, nous les voyons s’étonner et se transformer l’un par l’autre. L’affaire qui s’ensuit est mature, même si elle est destructrice. Sarah, issue d’un milieu extrêmement aisé, est une femme sobre qui parle avec des phrases auto-éditées. Nous apprécions sa méta-connaissance de sa position. À une amie qui a enduré la liaison de son propre mari, Sarah fait remarquer : « Je suis l’autre femme. »
Nous ne détestons pas non plus la femme de Warren, Janet, mais nous ne voudrions pas être mariés avec elle. Elle est plutôt maladroite, trop littérale et « effrayée par les gens qui ne lui ressemblent pas ». D’un autre côté, elle ne mérite pas la duplicité de Warren, qui essaie de « réaliser son mariage sans lui causer de douleur ».
Tous les adultes du livre sont rendus avec douceur. Des années après l’affaire, Warren écrit à sa fille toujours furieuse : « J’ai fait quelque chose qui a nui à notre relation, mais comme vous le savez, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour expier ce que j’ai fait. » Expier, il le fait.
Il s’avère que c’est Kat – la fille adulte de Warren – qui est l’antagoniste de cette histoire d’amour. Quand Kat apprend que Warren a décidé de quitter sa mère pour Sarah, elle le supplie : « S’il te plaît, ne fais pas ça, papa. Vous ne l’avez pas encore fait. Ne le faites pas. Vous allez nous tuer. Vous allez tuer notre famille. La douleur de la fille se transforme bientôt en quelque chose de plus intense. Finalement, Kat pose ses conditions : « Si tu divorces de maman, je divorcerai de toi. Je vais divorcer complètement. Ce qui suit peut mettre à rude épreuve la crédulité de certains lecteurs et paraître inconfortablement réaliste à d’autres. Nous regardons Warren hésiter face à l’exil de sa fille unique. « Il s’est avéré qu’il était un père plus que tout. Il l’était en premier.
Les exigences de Kat sont scandaleuses, et pourtant elles ont quelque chose de logique. Nous ne sommes pas « mariés » à nos enfants, mais nous sommes impliqués dans quelque chose de profondément contractuel. Nous pouvons culturellement situer la position de Warren comme le résultat final de l’état actuel de la parentalité – certains diraient une parentalité excessive – qui est devenue la norme pour de nombreuses familles qui en ont les moyens et le temps. Cette intimité que nous avons eu ou essayé d’avoir avec nos enfants a un prix, et nous laisse encore plus démunis sans eux. Un parent de ce style ne peut pas invoquer rétroactivement les impératifs sociaux d’autrefois, lorsque les enfants étaient coupables du devoir et du contact continu.
Au plus profond du livre, « Leaving » ressemble à un remix de Westchester de « La Dame au chien » de Tchekhov, une autre histoire d’adultère avec une confrontation au théâtre. La narration de Robinson est classique, page après page, composée de scènes rapides et d’une écriture aussi précise que des rangées de terre labourée. Robinson retravaille musicalement la courte phrase, la répétant et la revenant jusqu’à ce que les mots donnent leur sens. En tant que fille, Sarah n’avait « jamais passé beaucoup de temps avec des garçons ; elle les trouvait mystérieux. De quoi voulaient-ils parler ? Qu’était-ce que les femmes étaient autorisées à dire ? Le désaccord n’était pas permis avec son père ; il n’aimait pas ça. Ne faites pas de scène, lui disait sa mère. Qu’était-il permis de dire aux garçons ? Mais je me suis détendu dans les cadences et les idées magistrales de Robinson. Le dialogue est élégant et tendu, même si par moments la retenue semble être celle d’une autre époque. Après avoir lu « Leaving » et son roman sur la dépendance de 2008, « Cost », j’avais lu n’importe quelle histoire qu’elle avait à raconter.
J’avais espéré, en raison de mes sentiments tendres pour toutes les personnes impliquées, que cette histoire se terminerait avec les mêmes assurances que celle de Tchekhov. Mais il s’avère que lorsque Robinson dit « Tosca », elle veut dire « Tosca ». La fin est une bombe, tout à fait discutable. Ce roman souple captive. Robinson prouve que les écrivains peuvent encore évoquer les silences et les renoncements qui contrarient le désir, et que les étoiles se croisent encore.