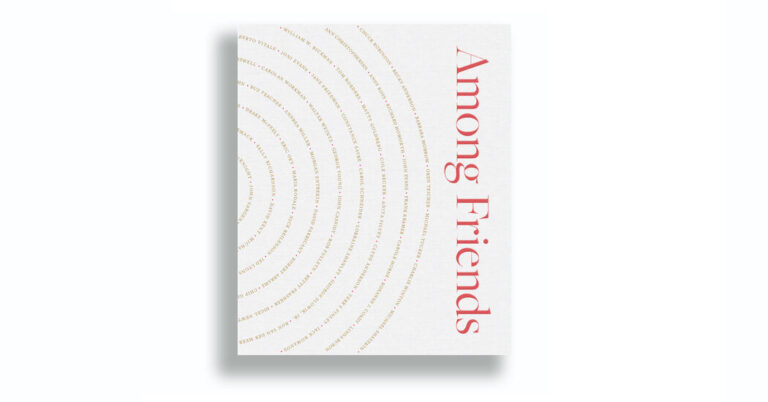Critique de livre : « Mon nom est Barbra », de Barbra Streisand
Bonjour, énorme.
De cours Les mémoires de Barbra Streisand, en préparation depuis 10 ans si l’on ne compte pas le chapitre qu’elle a griffonné à la main dans les années 1990 puis perdu, allaient se rapprocher des proportions de « Power Broker ».
D’une part, elle est – malgré les crises d’insécurité – une véritable intermédiaire du pouvoir : elle abat les barrières entre Broadway, Hollywood, l’industrie du disque et Washington, DC, comme Robert Moses sur un chantier de démolition.
D’autre part, comme l’écrit Streisand dans « My Name Is Barbra », un tour de victoire de 970 pages devant tous ceux qui ont douté, diminué ou dénigré d’elle, avec des applaudissements persistants pour les nombreux partisans, elle a tendance à s’inquiéter du processus d’édition.
Après avoir ajouté du matériel à sa version de « A Star Is Born » pour Netflix en 2018 – « Je pense que je l’ai amélioré. Mais l’ai-je fait ? Je ne suis jamais vraiment sûre » – elle fantasmait sur de nouveaux montages plus complets à la fois de « Funny Girl », qui a fait d’elle une star de cinéma dès son arrivée, et de « Yentl », ses débuts en tant que réalisatrice. Planifiant son mariage avec l’acteur James Brolin en 1998, elle a tenté de trier une longue liste de desserts avant de décider :Nous les aurons tous… pourquoi pas ?»
Il n’est pas nécessaire d’être psychiatre – même si Streisand, 81 ans, en a consulté de nombreuses, en a joué un dans « Le Prince des marées » et a même intégré le cadre thérapeutique dans une tournée de concerts – pour comprendre pourquoi elle a pris une telle bouchée de vie. Comme l’a raconté auparavant une flottille de biographies, dont aucune n’était autorisée (et au moins une révélatrice d’un des premiers colocataires, qui a été rapidement fantôme), elle a grandi dans une situation de privation économique et émotionnelle dans un projet de logement à Flatbush, Brooklyn. Au lieu d’une poupée, elle portait une bouillotte – « Je jure que cela ressemblait plus à un vrai bébé qu’à une poupée froide » – pour laquelle un voisin sympathique a tricoté un chapeau et un pull roses.
De tels détails sont peut-être familiers aux fans, mais pour la plupart, ils résonnent de manière plus retentissante dans le récit bavard et parsemé d’ellipses de Streisand. Elle possède peut-être une renommée en mégawatts – « un trophée creux », nous assure-t-elle – mais entre ces couvertures, elle n’est que Bubbe Barbra à une table de cuisine, parlant de tissus et d’hommes qui sont devenus frais et de « mon premier manteau de fourrure, vendu à moi sous le nom de « Zorina ». », alias « zibeline d’Alaska », mais en réalité… mouffette.
Son père, un éducateur d’origine juive orthodoxe, est décédé à 35 ans des suites d’un traumatisme crânien alors que Barbara, comme on l’écrivait alors, avait 15 mois et son frère 9 ans. (Elle a toujours l’exemplaire des « Contes de Shakespeare » de son père. pour les enfants sur sa table de chevet : « Qui sait ? Peut-être qu’il l’avait acheté pour me le lire. »)
Sa mère s’est remariée avec un homme nommé Kind qui était tout sauf, a donné naissance à une autre petite fille et avait des nuances distinctes de Madame Rose, chantonnant dans un microphone à balai, etc. « Où sont mon des cadeaux ? » a-t-elle crié lors d’une fête de Noël en 1964, date à laquelle sa fille aînée avait sorti le hit « People » du Top 40 et était apparue trois fois dans Vogue. « Je suis la mère ! Elle n’est rien sans moi !
Le fait que les droits cinématographiques de « Gypsy » aient échappé à Streisand après une longue taquinerie semble être l’un des crimes passibles de poursuites du showbiz. (Elle engloutit même des nems, M. Goldstone !) Un autre : ce livre, qui est orné de plus de noms en gras que de paillettes sur le tailleur-pantalon Arnold Scaasi qu’elle portait aux Oscars en 1969, n’a pas d’index. Vous avez en quelque sorte envie de ressusciter le magazine Spy pour en créer un, comme cela a été le cas pour « The Andy Warhol Diaries ».
La petite Barbara souffrait d’acouphènes non diagnostiqués, peut-être un bug que Dieu avait planté dans son oreille, la poussant à fuir le dysfonctionnement de sa famille. Elle a juré de devenir interprète après avoir vu Susan Strasberg, la fille du gourou de la Méthode Lee, dans « Le Journal d’Anne Frank » au Théâtre Cort, et a ensuite organisé une rencontre avec Strasberg Sr., qui ne l’a pas du tout intimidée. (« Il m’a rappelé mon oncle Irving. »)
Elle s’évanouissait également au cinéma près d’Erasmus Hall High, où elle était étudiante spécialisée ; son camarade de classe Bobby Fischer, le futur prodige des échecs, « ressemblait à une sorte de pilote dérangé d’un film des années 1940 », a-t-elle noté avec prévoyance.
Streisand a rassemblé des mentors qui l’ont initiée aux livres et aux disques, et a amassé de l’argent pour des cours de théâtre, mimant une pépite de chocolat et lisant « Médée » de Jean Anouilh : « Pourquoi as-tu fait de moi une fille ? Même si elle déteste voler, elle aspirait à s’échapper et deviendrait une experte en sillonnant les siècles et les cultures à l’écran.
Mais c’est son chant chatoyant, presque totalement intuitif, d’abord dans un bar gay puis au supper club Bon Soir de Greenwich Village, qui va d’abord éblouir le public. Elle a trouvé le projecteur « chaleureux et réconfortant », a rapidement coupé le deuxième « a » de son prénom et nous rappelle maintenant que le deuxième « s » de Streisand est doux, téléphonant à Tim Cook pour faire corriger la prononciation sur Siri.
L’auteur associe « My Name Is Barbra », le titre recyclé de son émission spéciale de 1965 qui lui-même associe le nom d’une chanson de Leonard Bernstein, à des yiddishismes : bibelots (elle aime ceux de porc) ; Gonifou voleur (son ex-petit ami Jon Peters) ; fakakta (ce que son agent de l’époque, David Begelman, appelait la nouvelle d’Isaac Bashevis Singer qui était à la base de « Yentl »).
Ensuite, il y a les généreuses cuillerées de chutzpah. En plus de harceler Strasberg, elle a réussi d’une manière ou d’une autre à résister à tous les conseillers qui lui ont dit de baisser son long nez, d’abandonner les vêtements des friperies et de choisir des numéros plus standards que, disons, « A Sleepin’ Bee » d’Harold Arlen, avec des paroles de Truman Capote. .
Personne n’a mis Barbra dans un coin. Elle s’est heurtée très tôt au dramaturge et metteur en scène épineux Arthur Laurents, insistant pour qu’elle interprète le solo éponyme de la secrétaire Miss Marmelstein dans « I Can Get It for You Wholesale » depuis une chaise pivotante. « Vous n’y arriverez jamais, vous savez ». lui gronda-t-il, même si le public était devenu fou de la séquence. « Jamais! » (Ils se réuniraient plus tard, sur le film à succès « The Way We Were ».)
Beaucoup d’hommes semblaient en vouloir à sa conduite. « J’ai plus de talent dans mes pets que toi dans tout ton corps! » Walter Matthau lui a dit sur le tournage de « Bonjour Dolly ». Mike Wallace l’a qualifiée de « totalement égocentrique » et l’a fait pleurer dans « 60 Minutes ».
Mais bien d’autres sont tombés à ses pieds, dont Marlon Brando, qui les a frottés. Le roi d’Angleterre a siroté Constant Comment dans sa tasse. Pat Conroy, l’auteur du « Prince des marées », l’a comparée à la déesse Athéna. (Athéna à propos de la danse de Conroy : « Mon garçon, il pouvait vraiment lancer ce truc ! ») Stephen Sondheim a réécrit les paroles pour elle.
Comptabiliser tous les petits amis et admirateurs – «Je pensais que nous allions avoir une liaison», l’a implorée Mandy Patinkin, mariée en larmes, pendant «Yentl», écrit-elle – pourrait nécessiter un deuxième indice.
Bien qu’elle ait la réputation d’être contrôlante (essentiellement la définition d’être réalisatrice), Streisand souligne ici, de manière convaincante, quoique quelque peu exhaustive, sa spontanéité. Contrairement à Ethel Merman, qui s’est déclarée Miss Bird’s Eye lorsqu’on lui a présenté de nouvelles paroles lors des répétitions de « Call Me Madam », elle pense que « geler quelque chose, c’est le tuer ».
Elle voulait imprimer les mots « ceci est un travail en cours » au dos de son album de lieder de 1976 – Glenn Gould a adoré ! – un exemple de son refus obstiné de rester dans une seule voie. « À bien y penser, je devrais aussi le mettre sur ce livre… »
Les éditions futures pourraient donc exclure quelques des longues citations d’éloges de ses pairs, comme celle prétendument de Tennessee Williams recueillie par un intervieweur dont la véracité a été remise en question par Helen Shaw dans le New Yorker. Sans vouloir trop en parler, Streisand aurait peut-être pu faire appel à un collaborateur de confiance, un JR Moehringer ou même un JJ Hunsecker, pour freiner certaines indulgences, comme de longues listes d’amis audacieux lors de concerts de fin de carrière.
Il y a cependant quelque chose d’exubérant et de glorieux dans la série d’autoportraits et de photos de fête de Streisand. En effet, à propos de tout ce banquet interminable d’un livre. Vous n’aurez peut-être pas envie de vous attarder sur tout cela, mais vous trouverez quelque chose qui vaut le détour.
Il y a tellement de Streisands scintillants à contempler pendant tant d’années : chanteuse, actrice, réalisatrice, productrice, philanthrope, activiste, amante, mère, épouse, amie, autobiographe. «Je ferais une très bonne critique», suggère-t-elle à un moment donné, et alors que j’ai du mal à mettre un bouton là-dessus, tout ce que je peux répondre est : Barbra, sois mon invitée.