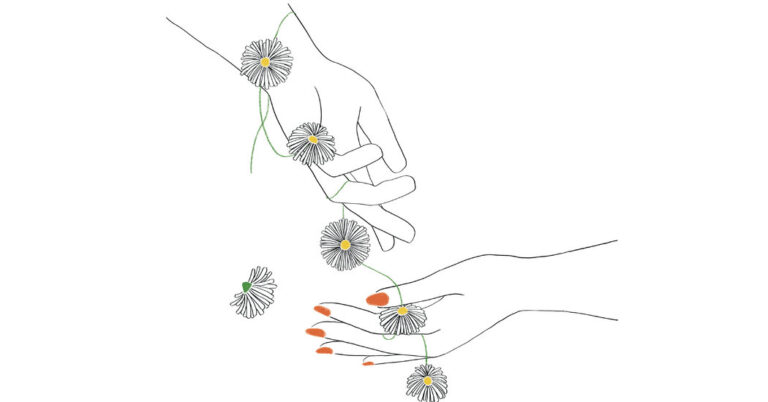Critique de livre : « Les bars sont à nous », de Lucas Hilderbrand
Dans la pénombre d’une boîte de nuit en 2011, Amanda Lepore ressemblait exactement à ce qu’elle était sur Internet : toutes les courbes, aucun angle, du champagne et de la crème versés dans des strass, tirés dans un sablier. J’ai tremblé devant elle, joyau du Club Kids qui régnait sur les nuits de Manhattan au début des années 90. Adolescente, je rêvais du New York d’Amanda. Sa célèbre bouche – gonflée et tendue, rouge crise – s’entrouvrit. Je m’attendais à ce qu’il sourie, mais ce n’est pas le cas. « Je m’appelle Amanda », ronronna-t-elle.
Je lui ai dit le nom auquel je répondais à l’époque, un nom que je réviserais bientôt pour qu’il paraisse plus doux, plus potable. Féminin. « Tu es fabuleux, » croassai-je. « Je veux dire, tu es le transsexuel le plus célèbre du monde. » (C’est ainsi qu’elle s’appelait.)
Finalement, elle sourit, pas seulement avec ses lèvres mais avec tout son corps. « Aimeriez-vous prendre un verre? » elle a demandé.
« Oui, » criai-je. J’ai bu ce qu’elle a versé.
«Bienvenue à New York», a déclaré Amanda Lepore.
Dans les mois suivants, je me présenterais à n’importe quelle fête qu’elle organisait. J’achèterais ma première paire de talons aiguilles et volerais ma première palette de fards à paupières. Je rencontrerais d’autres sirènes de nuit transsexuelles : Sophia Lamar, DeSe Escobar, Juliana Huxtable. Je faisais boire des boissons aux poupées, puis je les questionnais sur l’hormonothérapie substitutive (à ma grande surprise, elles me faisaient plaisir). En 2014, j’aurais fait une transition médicale, ce que je n’aurais peut-être pas fait si tôt – ou pas du tout – si je n’avais jamais rencontré ces femmes dans les boîtes de nuit.
L’attrait de tels sanctuaires pour leurs acolytes est le sujet de « The Bars Are Ours », le récit tentaculaire, ludique et rigoureux de Lucas Hilderbrand sur les clubs et les bars qui ont servi de boîtes de Pétri à l’identité gay américaine. Hilderbrand, professeur d’études médiatiques à l’Université de Californie à Irvine, passe au crible des dizaines de gazettes, affiches, journaux et histoires orales queer qui documentaient les espaces publics à travers le pays, des bars en cuir de San Francisco aux cabarets de dragsters de Kansas City. .
À partir des années 1960, époque où les bars queer commençaient à s’annoncer comme « sans ambiguïté gay », son regard parcourt les bains publics, les sex clubs et les discothèques, esquissant des archétypes (le clone de Castro moustachu et serré de Levi’s) et personnages (Drew Macaroni-and-Cheese, un go-go boy qui dansait avec rien d’autre qu’un poisson en plastique attaché autour de sa taille comme une « pièce de monnaie littérale »).
Hilderbrand écrit que les bars gays sont devenus un « médium » pour la communauté queer et une scène d’autodétermination. Des noms au-dessus de leurs portes au jargon crié sur leurs caissons de basses, il retrace l’évolution de l’identité gay dans une révolution du langage gay. Par exemple, le mot « gay » cède la place dans son récit au terme « queer », plus inclusif, parmi les non-conformistes du genre freak-chic de la scène rave de No-Cal. Il s’appuie également sur des définitions transcontinentales : à New York, S&M signifiait « sadique et masochiste », tandis que Los Angeles privilégiait « esclave et maître » et qu’au moins un client de longue date du Mary’s bar à Houston a opté pour le ironique « paillettes et mascara. »
Même si « les bars sont à nous » propose plus d’ethnographie que de théorie, cela suscite des étincelles lorsque Hilderbrand se livre à cette dernière, comme dans son exploration du camp. Selon Hilderbrand, le camp est né d’une « adoration commune pour le vieux cinéma hollywoodien et ses divas » et a cultivé « l’esprit vicieux et la catharsis » qui unissaient les hommes homosexuels de tous bords au cours des premières décennies de la scène des bars nationaux.
Hilderbrand est proche de Susan Sontag, qui a décrit le camp en 1964 comme ce qui est « bon parce que c’est horrible », mais il s’écarte du canon en suggérant qu’un camp « satisfaisant » peut survenir et se produit effectivement. exprès, notamment entre les mains expertes de ses prêtresses : les drag queens. Le camp de Hilderbrand est une rénovation postmoderne destinée aux lecteurs les plus susceptibles de se laisser prendre au piège, en grande partie à cause de la prolifération de la culture gay au cours du siècle dernier.
Aujourd’hui, la langue et la culture gay se sont, à bien des égards, intégrées à celles de leurs homologues hétérosexuels, peut-être même en les englobant. (La génération Z a arraché le « meurtre » aux drag-balls ; les millennials hétérosexuels et célibataires ont attrapé le « partenaire » d’une génération gay légalement interdite de « mari » et de « femme ».)
« The Bars Are Ours » éclaire un chemin semé d’embûches vers ce grand présent gay. Dans les années 80, une grande partie de la scène gay américaine tournait autour du mot « boy ». « Il y avait une préoccupation de décorum strictement post-SIDA », a écrit un observateur à propos du Boy Bar de New York, ouvert en 1983. « Les ‘garçons’ ne s’adonnent pas au S&M : les ‘garçons’ n’utilisent pas de poppers. » Même danser « était totalement verboten.«
De l’autre côté du pays, Ben Dhong, le major des affaires de la Bay Area, a lancé ses soirées « BOY » sur invitation uniquement en 1986. Il a décrit les rassemblements comme « de qualité » et « sains », déclarant au San Francisco Sentinel qu’il voulait juste « pour s’intégrer au reste de la société. Sans surprise, les soirées « BOY » s’adressaient aux prepsters blancs avec une politique de porte qui éliminait effectivement tous les autres.
L’esthétique hétérosexuelle a continué à s’infiltrer dans la culture gay jusqu’au 21e siècle. La majeure partie du livre se concentre sur les espaces dominés par des hommes homosexuels blancs et cisgenres, dont les privilèges raciaux et socio-économiques offrent le plus large éventail d’options de loisirs et de plaisir après la tombée de la nuit, mais un chapitre écrit avec Dan Bustillo, ancien directeur de doctorat d’Hilderbrand et bientôt -être professeur à l’UCLA, décrit Chico, une boîte de nuit gay latino ouverte en 1999 dans l’East Side de Los Angeles : « Chico a érotisé et reproduit une image performative de la masculinité latino – le cholo, l’homothug, l’homiesexuel. »
Comme les « garçons », le groupe Chico s’est inspiré de la société hétérosexuelle. Mais là où les « garçons » cherchaient à satisfaire les yuppies blancs, la scène « Chico », écrivent Bustillo et Hilderbrand, servait « d’alternative à la blancheur de West Hollywood ». Si ses participants faisaient preuve de rectitude, c’était pour se gratifier eux-mêmes plus que quiconque. Pourtant, il est clair que les garçons et les Chicos partageaient un fantasme : des retrouvailles interdites, peut-être, avec une certaine valeur « masculine » tâtonnée sur le chemin de la vie gay.
Tout au long de « The Bars Are Ours », Hilderbrand refuse de présenter une théorie unifiée des identités et des appétits gays. Il s’agit peut-être d’une précaution nécessaire, compte tenu de la diversité illimitée de la communauté gay américaine au fil des décennies. Mais ses recherches, ainsi que celles de Bustillo, incitent les lecteurs à se demander : qu’est-ce que les homosexuels attendent de la nuit ? Qu’en gagnons-nous et qu’avons-nous perdu dans la journée ?
En 2018, j’étais devenue une sirène de nuit comme Amanda Lepore : un phare transsexuel pour les enfants qui m’approchaient dans l’obscurité sur la piste de danse. L’ère Trump gémissait et frémissait autour de moi. J’étais épuisé. Une sirène était-elle un humain ? J’avais envie – soudainement et ardemment – d’être une femme et rien de plus.
J’ai teint mes cheveux en blond et j’ai fui à Los Angeles. J’ai quitté Gaultier pour Gunne Saxe ; Je traînais dans des bars rock avec des hétérosexuels. Je me suis couché tôt et seul et je me suis réveillé en pleurant. Je suis tombée amoureuse d’un hétéro qui portait une Rolex. Il m’a quitté environ un mois et demi après mon changement de sexe. J’ai pensé à me suicider, mais je suis retourné à New York.
David, un vieil ami du parti, m’a invité dans une maison de Fire Island, et j’y suis allé parce que je n’avais nulle part où aller. Un vendredi soir, nous étions en route pour la soirée sous-vêtements au Palais de Glace, où, comme le rappelle un participant dans « Les bars sont à nous », lui et ses amis se sont « amusés plus que quiconque dans le monde ». histoire de civilisation.»
« Je vais être la seule femme là-bas », ai-je ricané. « Je ne pense pas », roucoula David. « Sérieusement? » « OK, probablement. »
Je me suis précipité sur le lit double. « C’est non-oo lieu pour un LA-DY comme moi ! » Je gémis en agitant une cigarette imaginaire, étirant mes voyelles de Blanche DuBois à Margo Channing. Où en effet était une place pour une femme comme moi ? Je ne savais pas, alors je me suis arraché du lit.
Au clair de lune, nous avons marché sur la plage jusqu’à Cherry Grove. Nous sommes entrés dans le Palais de Glace, ouvert en 1970, et avons enlevé nos vêtements. Les muscles se tordaient dans le noir sur un morceau house que je connaissais mais que je ne pouvais pas nommer. J’ai pris la main de David et j’ai secoué la tête alors que nous disparaissions, gays ou queer, dans les corps.