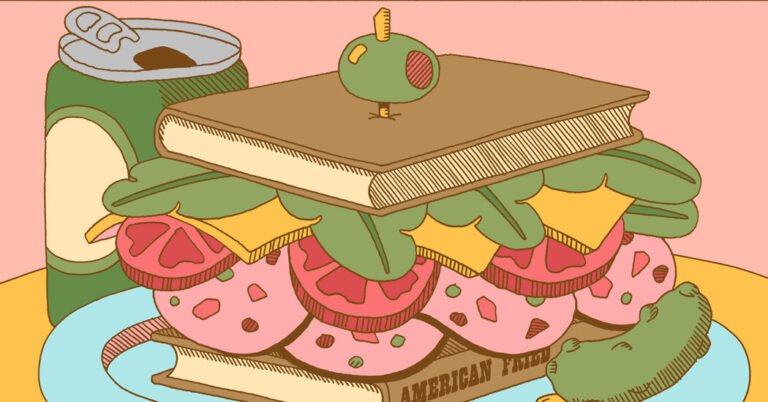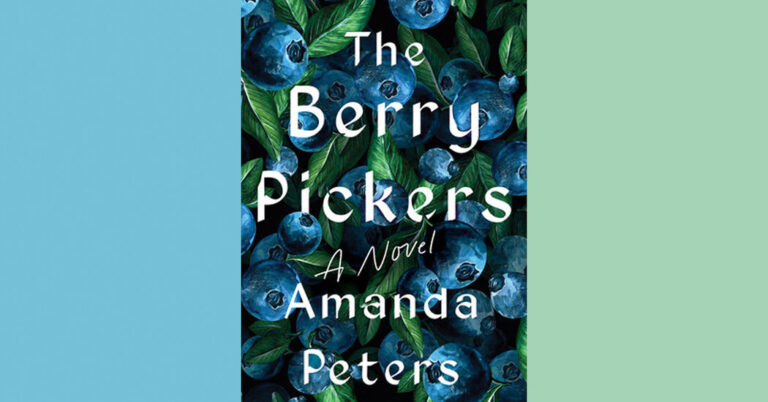Critique de livre : « Le problème de Bill Gates », de Tim Schwab
Il y a un quart de siècle, Bill Gates est devenu un symbole international d’avidité, d’arrogance et d’orgueil pour sa direction sans restriction de Microsoft.
Puis, peu de temps après que le gouvernement américain ait poursuivi l’entreprise pour abus de ses pouvoirs monopolistiques, Gates a connu une transformation. Il a mis de côté ses ambitions commerciales et a consacré ses énergies à donner sa vaste fortune. Il est passé du statut de méchant d’entreprise à celui de philanthrope qui sauve le monde – du moins c’est ce que raconte l’histoire.
Dans son nouveau livre, « The Bill Gates Problem », le journaliste Tim Schwab qualifie cette métamorphose de fable fantaisiste. Le vrai Gates, selon Schwab, reste un maniaque du contrôle narcissique et avide de pouvoir, et la tentaculaire Fondation Bill et Melinda Gates n’est guère plus qu’un moyen lui permettant d’accumuler et de déployer une influence à une échelle bien plus grande qu’il ne le pourrait en tant que simple. magnat du logiciel milliardaire. C’est profondément antidémocratique et cela renforce les inégalités, affirme Schwab.
Gates et son épouse d’alors ont créé leur fondation vers 2000 pour relever certains des défis mondiaux les plus urgents, notamment la santé publique, la planification familiale, la faim et l’éducation. Dotée d’environ 67 milliards de dollars, la fondation est mieux équipée que de nombreux gouvernements pour lutter contre les maladies et la malnutrition.
Mais la fondation ne se contente pas de distribuer l’argent de Gates à de bonnes causes, selon Schwab. Gates exerce un contrôle. Sa « croyance inébranlable en lui-même, qu’il est à la fois juste et juste dans tout ce qu’il fait », l’a amené à penser que lui et lui seul sait comment aborder au mieux les problèmes les plus complexes du monde. La fondation a mis un poids considérable en faveur de causes que certains experts n’aiment pas, comme les techniques permettant d’augmenter les rendements agricoles, et que d’autres considèrent comme peu prioritaires, comme l’éradication de la polio.
L’une des sections les plus intéressantes du livre concerne le soutien de la fondation à la planification familiale. La méthode de contraception préférée de Gates est un implant hormonal qui est inséré dans les bras des femmes et empêche une grossesse jusqu’à cinq ans. La fondation a conclu un accord avec les sociétés pharmaceutiques pour les encourager à vendre des dizaines de millions de ces implants à des prix très réduits. Face à l’inondation du marché, les cliniques de santé de pays comme le Malawi et l’Ouganda ont commencé à recourir à des « tactiques de vente difficiles » pour pousser les femmes à accepter des implants dont elles ne voulaient pas. Schwab le décrit comme une forme de coercition inspirée par l’eugénisme.
Même si Schwab admet que Gates a de bonnes intentions et que la fondation a sauvé des vies, il montre comment elle a tendance à exagérer, voire à concocter des données sur l’impact de son travail, y compris des chiffres largement cités sur le nombre de vies qu’elle a réellement sauvées.
Et les catalogues Schwab ont raté des occasions d’en faire plus. Par exemple, la fondation avait conclu des accords avec des sociétés pharmaceutiques et de soins de santé qui lui permettaient d’obtenir gratuitement des licences sur tout ce que les sociétés produisaient avec l’argent de la fondation. Pourquoi, demande Schwab, la fondation n’a-t-elle pas insisté pour que certaines de ces entreprises fassent don de leurs vaccins et d’autres produits et équipements aux pays pauvres ?
Ce sont des questions raisonnables, et Schwab fait valoir avec force, sur la base d’années de reportage, que sous la direction d’un homme plus humble, la Fondation Gates serait probablement une force plus efficace pour le bien.
Le problème est que Schwab se contente rarement de laisser les faits parler d’eux-mêmes. Page après page, cela se transforme en insinuations et en discours contre le capitalisme. Et la colère palpable de Schwab envers Gates « aux yeux morts », « bêlant » m’a parfois laissé remettre en question la fiabilité de son récit.
Il critique tour à tour les fondations en dépensant trop d’argent et en étant trop avare. Il déplore son caractère impérieux dans le développement de vaccins, puis se plaint qu’il n’ait pas fait davantage pour créer des installations de fabrication de vaccins dans les pays les plus pauvres. Il affirme que les milliards de la fondation seraient mieux gérés par des gouvernements démocratiquement élus – et critique ensuite la fondation pour avoir fait don de sommes importantes aux gouvernements nationaux et locaux.
En Inde, on découvre l’approche de la fondation pour lutter contre le VIH et le sida, notamment en distribuant des préservatifs. Schwab considère que cela est voué à l’échec parce que cela ne change pas le comportement sous-jacent des gens ni ne s’attaque aux causes profondes de la crise. Mais il cite à contrecœur les responsables de la santé publique affirmant que le travail de la fondation a sauvé des vies. Schwab se rabat sur un argument plus fragile selon lequel la fondation pourrait « déplacer le gouvernement ».
Il en va de même pour la lutte contre le paludisme, une priorité de la Fondation Gates. Schwab critique l’accent mis par la fondation sur les vaccins comme une solution « magique » et se plaint que « sous la direction de la fondation, les progrès contre le paludisme se sont stabilisés ». Mais il concède que les milliards de dollars de dons de la fondation ont permis de financer des moustiquaires indispensables dans la campagne contre la maladie.
J’ai trouvé les calomnies désinvoltes de Schwab envers d’autres journalistes particulièrement déplaisantes. Il note que la fondation a donné de l’argent à de nombreuses agences de presse d’investigation à but non lucratif. Il suggère ensuite que les journalistes de ces médias transportaient de l’eau pour Gates. Ses preuves de cela, quand elles existent, sont rares. Par exemple, il qualifie d’humiliante une émission de radio publique parce qu’elle « ne semble jamais avoir cherché à demander des comptes à Bill Gates ou à la Fondation Gates ». (Plus justement, Schwab critique le New York Times pour avoir initialement omis de divulguer que deux contributeurs qui avaient écrit favorablement sur la Fondation Gates dirigeaient une organisation largement financée par celle-ci. En outre, divulgation : deux de mes collègues du Times sont travaillant sur leurs propres livres sur Gates.)
Vers la fin de son livre, Schwab note que les lecteurs pourraient se demander : « Comment devrait quelqu’un comme Bill Gates dépense son argent philanthropique ? C’est vrai, c’est exactement ce que je me demandais.
Schwab dévie. Il soutient qu’il est corrosif pour une seule personne de posséder un tel pouvoir financier. Il suggère que le Congrès pourrait forcer la Fondation Gates « à agir de manière plus charitable », ou peut-être que des étrangers pourraient mettre en place un conseil de surveillance indépendant, composé d’enseignants, d’étudiants, de médecins et de patients des pays pauvres, « pour s’assurer que Bill Gates ne puisse pas agir ». contrôler à lui seul la manière dont l’argent de la fondation est dépensé.
Ce sont des idées intéressantes (bien qu’utopiques). Mais l’incapacité de Schwab à répondre à sa propre question sur la façon dont Gates devrait dépenser son argent m’a laissé insatisfait. Les milliardaires existent. En l’absence d’alternatives viables, n’est-il pas préférable pour le monde de donner son argent plutôt que de le thésauriser ?