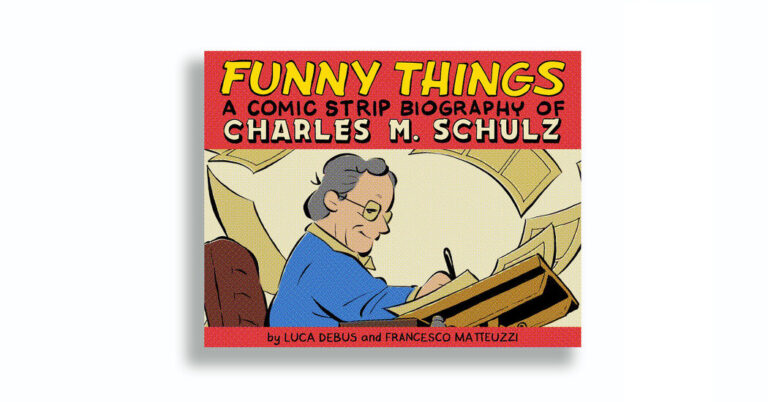Critique de livre : « La vie et les mensonges de Charles Dickens », d’Helena Kelly
Un siècle et demi plus tard, les archives sont bien plus accessibles qu’avant, et Kelly est prête à s’essayer à « Dickens le prestidigitateur » pour un livre qui équivaut à une « gestion de marque posthume ». Parmi une longue liste d’accusations de parjure se trouve la plus grande révélation de Forster : que le roman « David Copperfield » était semi-autobiographique, inspiré par le travail d’enfance de Dickens dans une usine de cirage à bottes pendant le (premier) séjour de son père John dans la prison pour dettes. Dickens, qui a rédigé ses propres communiqués de presse, avait réussi à supprimer les faits les plus élémentaires sur son parcours ; désormais, les lecteurs demandaient à Forster de « confirmer » ce qu’ils soupçonnaient depuis le début.
« L’image du jeune Charles comme un enfant inexplicablement négligé travaillant désespérément dans un entrepôt au bord de la rivière pendant que son père languit dans la prison de Marshalsea est terriblement touchante », écrit Kelly, « mais pouvons-nous être sûrs qu’elle est exacte ? » Ce n’est pas une question nouvelle – et l’auteur n’y répond pas non plus. Dans un numéro de 1872 de The North American Review, un critique qualifiait le mensonge de « bon exemple de cette particularité du caractère de Dickens et de l’apparente incapacité de M. Forster à la détecter ».
En fait, bon nombre des incohérences, des omissions et des mensonges purs et simples évoqués par Forster ont depuis été corrigés et affinés ; et Kelly – un doctorat d’Oxford. dont le livre précédent était « Jane Austen, the Secret Radical » – est remarquablement peu généreuse avec ses citations, qui incluent pour la plupart des sources du XIXe siècle, omettant ostensiblement les générations d’érudits qui l’ont précédée pour éclairer les malhonnêtetés de Dickens.
Lorsque Kelly libère le critique littéraire qui est en elle, elle ravit les lecteurs avec des pages et des pages illustrant l’influence durable de la biographie fictive de Dickens sur sa fiction : le prisonnier John Barsad revient dans sa famille dans « A Tale of Two Cities » ; l’orpheline Esther Summerson enterre une poupée qui est un vestige de son ancienne vie à « Bleak House » ; la titulaire « Little Dorrit » est née et a grandi à Marshalsea.
Se positionner comme une diseuse de vérité : « Des faits gênants continuent de surgir du brouillard », écrit-elle ; « il y a peu de fondement qui puisse supporter un quelconque poids » — Kelly n’a aucun scrupule à extrapoler ses propres théories non fondées à partir des indices textuels de Dickens. Sur la base de sa connaissance approfondie des maladies de l’ère victorienne, Kelly soupçonne que l’auteur était atteint de syphilis et que, comme « les hommes culpabilisés qui apparaissent dans ses derniers romans », il l’a transmise à sa famille sans le savoir, y compris Catherine, une enfant qui est mort in utero et un autre, Walter, décédé subitement à 22 ans. « La preuve ? Non, pas ça », admet Kelly. « C’est une théorie. »