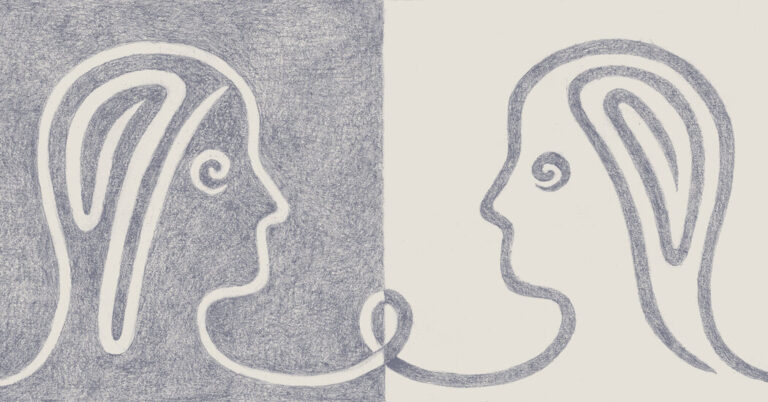Critique de livre : « Language City », de Ross Perlin
« Au sixième étage d’un ancien immeuble commercial le long du canyon sans soleil de la 18e rue, se trouve une pièce où convergent les langues du monde entier. » Il est logique que l’Endangered Language Alliance, la seule organisation au monde axée sur « la diversité linguistique des villes », vive ici, dans un bureau offert dans la métropole la plus linguistiquement diversifiée de la planète. C’est également ici que Ross Perlin commence « Language City », son magnifique nouveau récit de New York, raconté à travers les centaines de langues parlées dans ses cinq arrondissements.
Chaque jour, le bureau exigu de l’ELA regorge de gens chantant en Bishnupriya Manipuri (originaire du Bangladesh), écrivant en Tsou (Taiwan) et enregistrant en Ikota (Gabon). Un appelant du Bronx, avec une voix « pleine de nostalgie », cherche des enregistrements de la langue qu’il a laissée à la frontière Mali-Burkina Faso quand il avait 7 ans.
Perlin, codirecteur de l’ELA et lui-même linguiste accompli, explique que près de la moitié des 7 000 langues du monde risquent de disparaître au cours des prochains siècles. Mais son livre est moins une lamentation sur la mort de langues en voie de disparition qu’un récit de la façon dont, comme leurs locuteurs, ils ont construit une nouvelle vie dans un endroit où la moitié des habitants parlent une langue autre que l’anglais à la maison.
Perlin raconte l’histoire familière de la ville à travers le prisme de son histoire linguistique exceptionnelle, en commençant par les langues autochtones comme le lenape (dans lequel Manaháhtaan signifie « l’endroit où l’on obtient des arcs »). Les premiers colons comprenaient les 32 premières familles wallonnes à vivre de façon permanente à New Amsterdam et des locuteurs kikongo réduits en esclavage du Royaume du Kongo.
Alors que le Massachusetts et la Virginie étaient des « colonies exclusivement anglaises fanatiquement intolérantes », la Nouvelle-Amsterdam ne semblait pas s’en soucier ; en 1643, un prêtre écrivait qu’il avait trouvé 18 langues parmi quelques centaines d’hommes seulement. New York s’est rapidement vanté non seulement de langues comme l’anglais, l’espagnol, le français et le russe, mais aussi du basque et du breton, du catalan et du maltais. Quelque 200 ans plus tard, la loi Hart-Celler de 1965, qui a mis fin aux quotas d’immigration d’origine nationale de longue date, a contribué à faire du bengali et de l’ourdou deux des langues les plus parlées de la ville.
Tout au long de son ouvrage, Perlin ne manque jamais l’occasion de souligner un point clé : l’histoire des langues les moins connues de New York est aussi celle des traumatismes de nombreux locuteurs. Certains ont fui le génocide (comme dans le cas de l’arménien occidental et du judéo-grec), d’autres la déportation massive (langues du Caucase du Nord), la violence raciale (Gullah, un créole basé en anglais) ou la famine (irlandais). Les minorités linguistiques « ont été surreprésentées dans la diaspora », souligne Perlin, car elles sont « les plus durement touchées par les conflits, les catastrophes et les privations et sont donc contraintes de partir ».
L’excellent récit de Perlin sur la ville actuelle raconte l’histoire de six New-Yorkais travaillant tous, d’une manière ou d’une autre, à prolonger la vie de leur langue. Cela inclut Rasmina, qui emmène Perlin au « 380 », un immeuble de six étages à Flatbush qui a hébergé plus de 100 des 700 locuteurs mondiaux de Seke, une langue tibéto-birmane. Ibrahima gère un site Web en N’ko, un alphabet ouest-africain créé en 1949, et Irwin écrit de la poésie en nahuatl, une langue autochtone qu’il a absorbée en écoutant dans l’épicerie de son grand-père au Mexique.
Husniya prévoit de publier des livres pour enfants en wakhi, une langue pamirienne parlée là où se rencontrent le Tadjikistan, le Pakistan, l’Afghanistan et la Chine. Dianne, probablement la dernière locutrice native de Lenape, dit à Perlin avec nostalgie : « Maintenant, il n’y a nulle part où entendre la langue en dehors des murs de ma tête. »
C’est difficile d’avoir de l’espoir. Le transfert intergénérationnel de langues en danger est particulièrement difficile. Pourtant, Perlin démontre de manière convaincante pourquoi leur préservation est importante non seulement pour les locuteurs, mais pour l’humanité elle-même. C’est un argument qu’il vit dans sa propre vie. (Je vous invite également à regarder en boucle les fascinantes dépêches YouTube de Perlin depuis la Chine – en yiddish.) Mais le changement est inévitable. Comme le dit Perlin : « Un jour, l’anglais aussi sera épuisé par son dernier locuteur. »
À peu près à mi-chemin de la lecture de « Language City », j’ai pris la Bible à la recherche de l’histoire de la Tour de Babel. Je connaissais les bases de l’histoire de la Genèse : à une époque où le monde avait « une seule langue et un langage commun », les habitants de Babel décidèrent de construire une ville avec une tour atteignant le ciel. Dieu désapprouva et « confondit » leur langage « pour qu’ils ne se comprennent pas ». Les travaux sur la ville – et sur la tour – ont été interrompus.
Mais j’avais oublié ce qui s’est passé ensuite : Dieu a dispersé le peuple de Babel sur la surface de la terre. « Language City » est une réfutation habile de la morale de cette parabole. Loin de se disperser, les gens ont plutôt convergé vers la ville, emportant avec eux leurs paroles. Et les tours de New York n’ont jamais été aussi hautes.