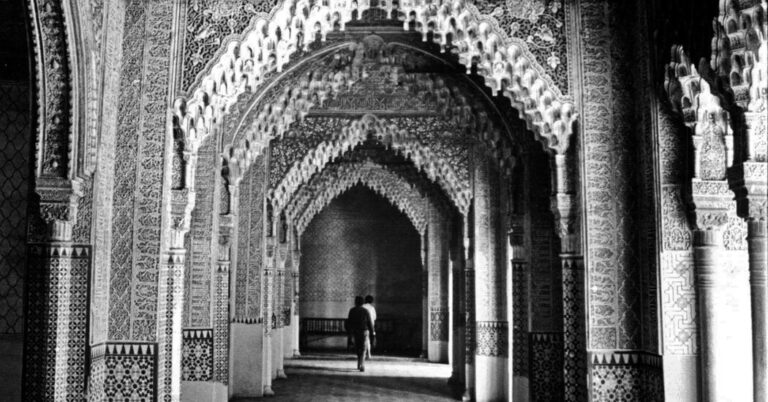Critique de livre : « La chasse au faucon », de John Guy et Julia Fox
Anne Boleyn jeta un coup d’œil par-dessus son épaule à plusieurs reprises alors qu’elle attendait à la Tour de Londres son bourreau, un épéiste spécialisé qui avait été convoqué de France. Henri VIII, qui pouvait épargner des vies avec autant de désinvolture qu’il les éteignait, épargnerait-il la sienne sur l’échafaud comme il l’avait fait auparavant ?
Anne avait été soumise à une journée de torture émotionnelle extrême. Croyant qu’elle allait mourir le matin, elle avait prié toute la nuit avec son aumônier, pour attendre encore 24 heures le coup définitif du connétable de la Tour à la porte de sa prison. Il n’y aurait pas de sursis. Henry considérait déjà que lui épargner une mort plus sanglante – par le coup de hache – était un geste de générosité notable.
Les spectateurs ont raconté que les lèvres et les yeux d’Anne bougeaient encore après que sa tête ait été tranchée de son cou particulièrement mince. « L’épée », écrivent John Guy et Julia Fox dans leur nouvelle biographie passionnante, « sifflait » dans l’air.
« Rien n’est dit sur la réaction de la foule », nous disent-ils, « à part le fait qu’elle est morte ‘audacieusement’, mais il est difficile de croire qu’ils n’ont pas eu le souffle coupé. »
Il est également difficile de croire qu’il existe une énième biographie d’Anne aux mille livres, mais « La chasse au faucon » est un tour de force féroce et érudit. Les auteurs, une équipe d’historiens mari et femme, forment un duo de rêve. Leurs recherches sont intenses : elles fouillent des documents endommagés par l’eau et cachés dans des collections moisies ; les chiffres et signatures réinterprétés dans les missives Tudor brûlées par le feu ; les marginalia révélatrices dans les manuscrits et les in-folios ; les apartés concis des courtisans dans les journaux ignorés.
Leurs aperçus les plus récents portent sur la vie prélapsaire (c’est-à-dire avant Henri) d’Anne, d’abord en tant que demoiselle d’honneur de Marguerite d’Autriche, à la cour des Habsbourg à Malines, puis en tant que demoiselle adolescente à Paris auprès de la reine Claude de France, épouse de Le roi François Ier.
Ces deux femmes royales ont été des modèles formateurs. Margaret, fille de l’empereur romain germanique Maximilien, était, nous dit-on, « une femme glamour, totalement confiante, pleinement maître de son propre destin » dont la devise se traduisait par « les changements de fortune rendent une femme plus forte ». Son intellect politiquement agile a été aiguisé en agissant pour son père en tant que régent des Pays-Bas.
Claude de France était plus proche en âge de l’adolescente Anne et présidait une cour cultivée qui bourdonnait des nouvelles idées de réformateurs, artistes et musiciens. Elle n’était que l’une des impressionnantes femmes triumvirales entourant François Ier. Sa mère, Louise de Savoy, une « politicienne aux yeux de lynx et impitoyable à part entière », exerçait plus d’influence que nombre de ses conseillers ; et sa sœur, la brillante Marguerite d’Angoulême, célèbre pour son esprit mordant et ses connaissances en théologie, était une caisse de résonance avisée.
Comparées au cercle de couture austère et dévoué qui servait Catherine d’Aragon à la cour britannique, les matriarches françaises étaient des pistolets. « Anne s’est retrouvée dans un monde dans lequel les femmes pouvaient exercer le pouvoir de manières étonnamment différentes », écrivent Guy et Fox.
Le père d’Anne, Thomas, était un autre maestro raffiné des intrigues internationales. Stéréotypeé par convention comme un arnaqueur complice déterminé à construire la marque Boleyn, Thomas se positionne ici de manière plus intéressante comme une sorte de Zelig géopolitique. Il était l’un des diplomates les plus chevronnés d’Henri VIII, envoyé dans de multiples missions pour négocier avec les autres maîtres régnants de l’univers en Europe, le roi de France et l’empereur romain germanique Charles Quint, ainsi qu’avec le pape, qui exerçait une influence spirituelle sur l’ensemble du pays. eux. Pa Boleyn était un mercenaire, prêt à charmer, cajoler ou jouer dur avec n’importe lequel de ces partis traîtreusement intéressés. Henry estimait qu’il était dans l’intérêt de l’Angleterre de s’allier à tout moment.
Anne revint d’Europe en Angleterre en 1522, probablement au début de la vingtaine (sa date de naissance reste controversée), pour devenir demoiselle d’honneur de la reine Katherine. Ce serait le bon moment pour attirer l’attention du solide roi de 34 ans. En 1525, sa maîtresse Mary Boleyn, la sœur cadette d’Anne, était hors de combat avec une grossesse et il devenait clair que Katherine n’allait jamais lui présenter un fils.
Henry n’avait jamais rencontré auparavant une femme aussi éblouissante qu’Anne, avec son flair français et sa confiance en elle intellectuelle. Il pouvait lui parler d’égal à égal. Les lettres d’amour qu’il lui adresse sont souvent des supplications abjectes pour se rassurer ; ses propres réponses n’ont pas survécu, mais implicitement dans ses plaidoiries se trouve une Anne qui souffle le chaud et le froid, avance et recule, aiguillonne et séduit, le tout dans le pari téméraire qu’elle lui donnerait un héritier mâle.
« La chasse au faucon » montre brillamment comment le temps, les circonstances et la politique se sont combinés pour accélérer le triomphe et la tragédie d’Anne. Nous voyons comment les changements de pouvoir oscillants en Europe ont été aussi déterminants pour son destin que les complots plus familiers de la cour Tudor. Katherine, par exemple, avait un allié puissant en la personne de son neveu, l’empereur des Habsbourg Charles Quint, qui, elle le savait, la soutiendrait toujours auprès de Rome contre les demandes de divorce intimidantes d’Henri.
Cela a forcé Henry à garder à ses côtés le pouvoir toujours indigne de confiance de la France. Les missions diplomatiques de Thomas Boleyn en Europe sont devenues de vaines incursions pour trouver des points de pression pour persuader le pape de changer d’avis. Quand Anne et Henry « ont travaillé ensemble en équipe pour son divorce, ils ne faisaient qu’un », nous disent les auteurs. Mais « une fois mariés, ils ne chassaient plus la même proie ».
1536 fut l’année de la perte d’Anne Boleyn. En janvier, Catherine d’Aragon est décédée et Henri a subi un grave accident de joute qui l’a mis sur la bonne voie pour devenir le tyran belliqueux et ballon de la légende. Cinq jours plus tard, le jour où Katherine a été enterrée, Anne a fait une fausse couche de son bébé, une calamité qui a brisé le charme de sa magie invulnérable.
Cela a fourni une fenêtre critique de défaveur au conseiller avide de pouvoir d’Henry, Thomas Cromwell – et à tous les autres ennemis qu’Anne s’était fait au cours de son ascension insensible vers le sommet – pour intervenir et la renverser avec de fausses accusations d’adultère.
« Pour l’amour d’Anne », écrivent Guy et Fox, Henry « s’est aliéné sa famille, nombre de ses courtisans et de ses sujets ; pour elle, il a détruit et même tué des hommes qu’il considérait autrefois comme ses partisans et ses amis. Pour Anne, il a rompu avec Rome, « a utilisé le Parlement pour adopter des questions qui affectaient la foi des gens, mettaient fin à des siècles de tradition et risquaient la guerre en Europe ».
Le contrecoup de toute cette amertume a maintenant englouti Anne à une vitesse terrifiante, mais elle aurait pu encore être sauvée si la politique européenne ne s’était pas également alignée contre elle. Avec la mort de Katherine, Henry était libre d’abandonner son alliance militaire de plus en plus vexatoire avec la France.
Des négociations commencèrent sérieusement pour un rapprochement avec l’empereur Charles, dont l’une des exigences était de rétablir la fille de Katherine, Mary, dans la ligne de succession de la fille d’Anne, Elizabeth. Cela aurait été sur le cadavre de La Boleyn – et ce fut le cas. En mai 1536, le seul vestige de l’influence francophile d’Anne était son épée de bourreau.