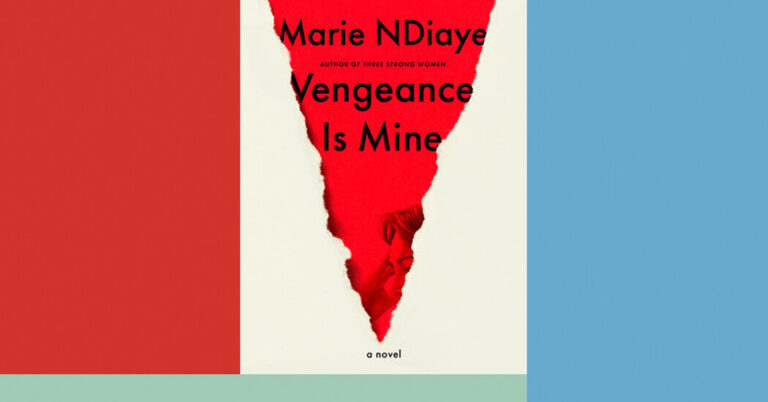Critique de livre : « August Wilson : A Life », de Patti Hartigan
En 1986, David Mamet publie son meilleur livre, un traité mince et semi-dur sur le théâtre et la vie intitulé « Writing in Restaurants ». C’était des décennies avant qu’il ne devienne « le Kanye West des lettres américaines », comme l’a dit The Forward l’année dernière. Hélas, le livre ne parlait que vaguement de restaurants.
Le titre de Mamet m’est revenu alors que je lisais la biographie de Patti Hartigan d’un autre dramaturge américain incontournable, August Wilson. Wilson, décédé en 2005, a passé tellement de temps à s’attarder dans les restaurants que «Writing in Restaurants» est un sous-titre alternatif plausible pour «August Wilson: A Life» de Hartigan.
Wilson était un grand homme barbu, souvent en tweed et coiffé d’une casquette de pageboy. Il s’asseyait à l’arrière avec une tasse de café et un cendrier débordant. (Il fumait cinq paquets par jour et ne s’arrêtait pas sous la douche.) Il écrivait sur des serviettes ou des reçus, tout ce qui était pratique.
Il a écrit une première pièce, « Jitney », dans un Fish & Chips d’Arthur Treacher. Au fur et à mesure que sa renommée grandissait, il trouvait une place dans chaque ville où ses pièces étaient mises en scène. Il appellerait ce joint « le Spot ». À New York, il aimait le charme miteux du café de l’hôtel Edison, connu des habitués sous le nom de salon de thé polonais. À Boston, c’était Ann’s Cafeteria. À Seattle, Caffe Ladro. Il apportait des journaux, et parfois un ami. Au petit-déjeuner, il tenait la cour pendant quatre ou cinq heures d’affilée. C’était sa tranche quotidienne de théâtre expérimental.
Wilson était un conteur, avec la curiosité ardente d’un autodidacte. Il est né à Pittsburgh en 1945, d’une mère noire célibataire qui l’a élevé, lui et ses frères et sœurs, en grande partie grâce à des chèques d’aide sociale. Il a extrait cette ville, en particulier son quartier historiquement afro-américain Hill, comme s’il s’agissait de charbon; il tapotait une couture. La première maison de la famille n’avait pas d’eau chaude et une dépendance dans la cour arrière. Wilson a abandonné ses études secondaires et a fait un bref passage dans l’armée. Il s’est formé dans les bibliothèques de Pittsburgh comme Ta-Nehisi Coates l’a écrit à l’Université Howard : « trois appels à la fois ».
Il pensait qu’il pourrait être un poète. Ses premiers vers étaient ornés et redevables à Dylan Thomas; cela faisait de lui une figure de douce dérision. Il découvre Bessie Smith et le blues, et tombe de travers dans le théâtre. Amiri Baraka était une influence clé; le poète, dramaturge et militant était venu à Pittsburgh en 1968, au plus fort du mouvement Black Power, et avait prononcé un discours galvanisant. Wilson avait 23 ans à l’époque.
Baraka avait fondé le Black Arts Repertory Theatre / School à Harlem en 1965. Wilson et ses amis du monde des arts ont décidé de créer leur propre théâtre, qu’ils ont appelé Black Horizons. Personne ne s’est porté volontaire pour le diriger et Wilson a été choisi par défaut. Le matériel était nécessaire et Wilson a commencé à l’écrire. Les mots étaient simplement là; les voix afro-américaines d’une ville entière s’échappaient de lui. C’était une vision auto-régénérante.
Il s’agit de la première biographie majeure de Wilson, dont le cycle du siècle en 10 pièces (également appelé le cycle de Pittsburgh) a fait de lui sans doute le dramaturge le plus important et le plus réussi de la fin du XXe siècle. Ces pièces, une pour chaque décennie des années 1900, incluent « Fences » et « The Piano Lesson », qui ont toutes deux remporté des prix Pulitzer, ainsi que « Ma Rainey’s Black Bottom » et ce qui pourrait être sa pièce la plus électrique, « Joe Turner’s Venez et repartez.
« Fences » et « Ma Rainey’s Black Bottom » sont devenus des films mettant en vedette, respectivement, Denzel Washington et Viola Davis, et Davis et Chadwick Boseman. Ses pièces ont donné des rôles stimulants à Angela Bassett, Delroy Lindo et Samuel L. Jackson, entre autres. Ils se délectaient de sa langue. Il avait un don spécial pour le dialogue lowlife et la camaraderie – les cris des personnages avides d’être compris.
Hartigan est un ancien critique de théâtre du Boston Globe. Son livre est un exploit : il est solide et bien rapporté. Mais c’est du devoir. Il manque d’exubérance et de sens critique. L’écriture est lâche et, dès la seconde moitié, les clichés tombent tellement fort qu’il faut un chapeau. Une pièce de théâtre est « un diamant brut » ou « une machine bien huilée ». Un événement est, pour ne prendre qu’un exemple, « aussi probable que la neige en juillet ».
Pourtant, l’histoire de Wilson vous entraîne. Hartigan décrit le système alors nouveau que Wilson et son réalisateur le plus important, Lloyd Richards, ont développé pour nourrir ses pièces. Avant d’arriver à New York, ils ouvriraient dans une série de théâtres régionaux à but non lucratif, à Minneapolis, Chicago, Seattle et ailleurs, permettant à Wilson de faire des coupes (ses premières ébauches avaient tendance à être difficiles à manier) et d’affiner son matériel.
Frank Rich, alors critique de théâtre pour le New York Times, a été l’un des premiers champions essentiels. Le meilleur morceau de cette biographie pourrait être la préparation d’un débat public à l’hiver 1997 à l’hôtel de ville de Manhattan, entre Wilson et un critique moins généreux, Robert Brustein de The New Republic. (Debout à l’extérieur du théâtre, Henry Louis Gates Jr. l’a appelé le « Thrilla à Manille ».) La soirée a été animée par Anna Deavere Smith. Même avant l’événement, Wilson et Brustein s’étaient emmêlés, entre autres, sur le casting daltonien, que Wilson avait déclaré « une insulte à notre intelligence ». Il pensait que développer des dramaturges noirs était plus important.
Wilson ne s’est jamais remis de certains affronts raciaux de son enfance. Dans un magasin de Pittsburgh, seuls les acheteurs blancs recevaient leurs achats dans des sacs en papier. Pour le reste de sa vie, Wilson a demandé que tout ce qu’il achetait soit placé dans un. Il avait un tempérament. Il détestait qu’un serveur dise quelque chose comme : « Qu’est-ce que vous avez, les garçons ? Il avait la peau claire. Son père absent était un homme blanc. Il n’aimait pas que ce fait soit mentionné.
Wilson s’est marié trois fois et a eu deux filles. Il n’était pas un père ou un mari attentif ; son travail est venu en premier. Sa deuxième fille a grandi en se référant à lui comme « le gars glissant ». Il était aussi, écrit Hartigan, un coureur de jupons de toute une vie, un locavore sexuel.
Les critiques ont noté le manque relatif de rôles féminins forts dans son travail. Certains autres dramaturges noirs ont estimé que son succès démesuré les avait laissés dans l’ombre – que la culture américaine n’avait de place que pour l’un d’entre eux.
Ce livre n’a pas dû être facile à écrire. Wilson avait généralement trois ou quatre projets en cours : une pièce à New York, une en développement quelque part, une troisième qu’il commençait à écrire. Hartigan est habile à garder les lignes droites.
Wilson s’est disputé avec ses réalisateurs, et souvent avec ses acteurs. Il a livré des réécritures jusqu’à la dernière minute. Il a tergiversé. Tout le monde a été forcé de vivre sur ce qu’ils appelaient «l’heure d’August Wilson». Il n’a jamais appris à conduire.
Wilson a surtout évité Hollywood. Il connaissait trop de talents qui y ont disparu. Il a refusé une offre d’écrire le film « Amistad » pour Steven Spielberg. C’était un homme compliqué et, même dans un livre imparfait, c’est un plaisir de faire sa compagnie.