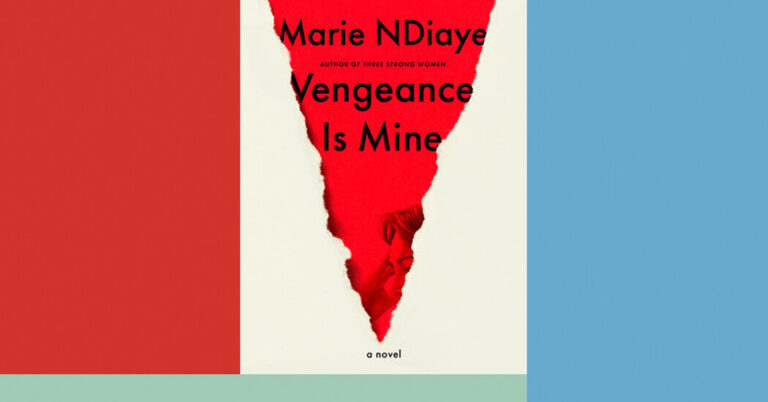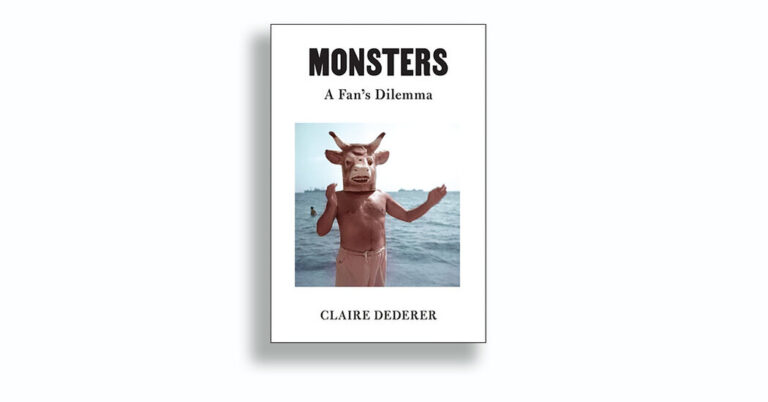Vous aimez le titre de mon livre ? Merci, je l'ai emprunté.
On le voit partout, même si on ne le reconnaît pas toujours : l'allusion littéraire. Rapide! Quels sont les deux grands romans des deux dernières années qui ont emprunté leurs titres à « Macbeth » ? Trouver la réponse – « Birnam Wood » et « Demain, et demain, et demain » – pourrait vous rendre un peu suffisant.
Peut-être le frisson de l'intelligence (Je sais d'où ça vient !), ou le revers de la médaille de l'ignorance (Je devrais savoir d'où ça vient !), suffit à vous inciter à acheter un livre, de la même manière qu'un titre optimisé pour la recherche vous oblige à cliquer sur un lien. Après tout, les titres sont un terrain particulièrement fertile pour les allusions. Le nom d’un livre devient plus mémorable lorsqu’il fait écho à quelque chose que vous avez peut-être entendu – ou pensez que vous auriez dû entendre – auparavant.
Ce type d’appropriation semble être un phénomène relativement moderne. Avant le tournant du XXe siècle, les titres étaient plus descriptifs qu’allusifs. Les livres eux-mêmes étaient peut-être remplis d'apprentissage, mais les mots sur les couvertures se contentaient en grande partie de donner au lecteur potentiel le qui (« Pamela », « Robinson Crusoé », « Frankenstein »), où (« Les Hauts de Hurlevent », « Les Mill on the Floss », « Treasure Island ») ou quoi (« The Scarlet Letter », « War and Peace », « The Way We Live Now ») du livre.
D’une manière ou d’une autre, au milieu du XXe siècle, la littérature était devenue une chambre d’écho. Regarde vers la maison, mon ange ! Ne demandez pas pour qui le bruit et la fureur se dirigent vers Bethléem dans une bataille douteuse. Lorsque Marcel Proust a été traduit pour la première fois en anglais, il a été amené à citer Shakespeare, et « À la recherche du temps perdu » (le titre français littéral et clairement descriptif) est devenu « Souvenir des choses passées », une ligne du Sonnet 30.
Les récents traducteurs de Proust ont effacé la référence shakespearienne par fidélité à l’original, mais l’habitude d’habiller les nouveaux livres avec des vêtements d’occasion persiste, aussi bien dans la fiction que dans la non-fiction. L'année dernière, en plus de « Birnam Wood », il y avait « The Best Minds » de Jonathan Rosen, avec son murmure de « Howl » d'Allen Ginsberg, « This Other Eden » (« Richard II ») de Paul Harding et « The Rigueur des anges » (Borges). Les listes de best-sellers et les catalogues des éditeurs en contiennent des multitudes (Walt Whitman). Voilà tout le monde ! (James Joyce).
Si vous devez écrire de la prose et des poèmes, les mots que vous utilisez doivent être les vôtres. Je n'ai pas dit ça : Morrissey l'a fait, dans un montage assez profond à la Smiths (« Cemetry Gates,» de 1986), qui cite de manière erronée Shakespeare et vérifie les noms de John Keats, William Butler Yeats et Oscar Wilde – probablement les écrivains recyclés les plus fiables (avec John Milton et les auteurs de la Bible King James) en langue anglaise.
Pas que cela aurait dérangé aucun d’entre eux. Lorsque Keats a écrit qu '«une chose de beauté est une joie éternelle», il espérait sûrement qu'au moins autant d'«Endymion» lui survivrait. C'est un beau sentiment ! Et il avait peut-être raison. Est-ce que quelqu'un lit son élégie en quatre parties et 4 000 vers pour Thomas Chatterton en dehors d'un cours d'anglais universitaire, ou même d'ailleurs à l'intérieur d'un cours ? Néanmoins, cette phrase d'ouverture peut vous rappeler quelque chose si vous vous en souvenez des films « Mary Poppins », « Yellow Submarine » ou « White Men Can't Jump ».
Le trait d'esprit et les bons mots de Wilde ont survécu même si certaines de ses œuvres les plus longues ont langui. S'il est vrai (comme il l'a dit) que seuls les gens superficiels ne jugent pas d'après les apparences, il s'ensuit peut-être que le glanage superficiel est le type de lecture le plus profond. Ou peut-être, pour paraphraser Yeats, que les lecteurs dévoués de poésie manquent de toute conviction, tandis que les citants imprudents sont pleins d’intensité passionnée.
Comme tout le reste, c’est la faute d’Internet, qui a cannibalisé notre temps de lecture tout en offrant une pseudo-érudition facile, souvent fallacieuse, à quiconque a l’esprit d’effectuer une recherche. Comme Mark Twain l'a dit un jour à Winston Churchill, si vous utilisez Google, vous n'avez besoin de vous souvenir de rien.
Sérieusement cependant : je ne viens pas pour enterrer la pratique de l’allusion, mais pour la louer. (« Jules César ») Et aussi de demander, en toute sincérité et avec tout le mérite d'Edwin Starr, de « Seinfeld » et de Léon Tolstoï : à quoi ça sert ?
Les centres linguistiques de notre cerveau sont des dynamos d’originalité. Un locuteur compétent de n'importe quelle langue est capable de générer des phrases intelligibles et cohérentes que personne n'a prononcées auparavant. Cette idée centrale de la linguistique moderne, avancée par Noam Chomsky dans les années 1950 et 1960, est merveilleusement démocratique. Chacun de nous est un poète dans son discours quotidien, un Milton sans gloire (Thomas Gray), un Shakespeare qui frappe de nouvelles pièces d'éloquence.
Bien sûr, les vrais poètes sont des voleurs congénitaux (comme aurait pu le dire TS Eliot ou quelqu’un comme lui), arrachant des mots et des phrases des pages de leurs pairs et de leurs précurseurs. Nous autres sommes poètes dans ce sens aussi. Si nos cerveaux sont des fonderies, ils sont aussi des entrepôts, remplis de clichés, de slogans publicitaires, de slogans de films, de paroles de chansons, de proverbes tronqués et de blagues que nous entendions dans la cour de récréation en CE2. Également de grandes œuvres littéraires.
Il y a ceux qui passent au crible cette profusion avec le soin fanatique des chasseurs de champignons, ne récoltant que les spécimens les plus savoureux et les plus succulents. D’autres s’écrasent à travers les fourrés, les mots s’accrochant à nous comme des bavures sur un pull. Si nous essayions de les enlever, le vêtement tout entier – notre conscience, dans cette métaphore indisciplinée – pourrait s’effilocher.
Cela peut aussi être vrai collectivement. Si nous parvenions d’une manière ou d’une autre à purger notre langage de ses éléments de seconde main, nous pourrions perdre le langage lui-même. Que se passe-t-il si personne ne lit plus, ou si tout le monde lit des choses différentes ? La pratique de la citation littéraire dépend-elle d’un ensemble stable de références communes ? Ou fonctionne-t-il comme une sorte de substitut à un corpus de connaissances partagé qui n’a peut-être jamais existé ?
Le vieux canon littéraire – ce club d’hommes blancs morts et d’éternuements au ventre étoilé (Dr Seuss) – a peut-être perdu un peu de son éclat au cours des dernières décennies, mais il a fait preuve d’une endurance impressionnante sous forme de corne d’abondance de citations. Pas le seul, en aucun cas (ou mèmes). La télévision, la musique populaire, la publicité et les médias sociaux fournissent tous une matière abondante, et la façon dont nous lisons actuellement (ou pas) a une manière de rendre tout cela équivalent. L'âme choisit sa propre société (Emily Dickinson).
Quand j'étais jeune, mes parents avaient une grosse anthologie de dessins animés new-yorkais du milieu du XXe siècle, un livre sur lequel je me penchais avec un zèle obsessionnel. Un dessin qui m'a suffisamment dérouté pour me rester en tête comportait une légende avec les mots suivants : « C'est des plaisanteries, des manivelles et des ruses gratuites, des hochements de tête, des signes et des sourires en couronne. » Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce n'est que lorsque j'étais aux études supérieures, en préparation pour un examen oral de littérature de la Renaissance, que j'ai trouvé la réponse dans « L'Allegro », un des premiers poèmes de Milton, plus souvent cité comme l'auteur du « Paradis perdu ».
Non pas que le fait d’avoir la citation aide nécessairement. Le dessin animé, de George Booth, représente une femme dans son salon, s'adressant aux membres d'un foyer multigénérationnel et multi-espèces. Il y a des chats, des codgers, un enfant avec un yo-yo, un oiseau en cage et un chien enchaîné au canapé. Par la fenêtre de devant, on peut voir le patriarche de la famille monter dans l'allée, un fedora sur la tête et une mallette dans la main droite. Son arrivée – « Voici Poppa » – est l'occasion du discours d'encouragement de la femme à Miltonic.
Qui est-elle? Pourquoi cite-t-elle « L'Allegro » ? Une partie du charme, je le soupçonne maintenant, réside dans l’absurdité de ces questions. Mais je me demande aussi : les lecteurs du New Yorker au début des années 1970, lorsque le dessin animé a été publié pour la première fois, étaient-ils censés comprendre l’allusion dès le départ ? Ils ne pouvaient pas le rechercher sur Google. Ou auraient-ils ri de l'éruption incongrue d'un vieux morceau de poésie qu'ils ne parvenaient pas à situer ?
Ce qui est peut-être drôle, c'est que la plupart des gens ne savent pas de quoi cette dame parlait. Et peut-être que la même vanité comique anime un dessin antérieur de James Thurber réimprimé dans le même livre. Dans celui-ci, une femme aux yeux fous fait irruption dans une pièce, portant un chapeau souple et brandissant un panier de fleurs des prés. « Je viens de repaires de foulques et de hernes ! » s'exclame-t-elle à la compagnie déconcertée, perturbant leur cocktail.
C'est ça. C'est le gag.
Les lecteurs ont-ils également été déconcertés ? Il s'avère que la prétendue déesse de la nature de Thurber cite « The Brook », d'Alfred, Lord Tennyson. (Je ne l'ai jamais lu non plus.) Est-il nécessaire d'obtenir la référence pour comprendre la blague ? Si vous riez en reconnaissance et terminez la strophe sans manquer un battement – « Je fais une sortie soudaine/Et brille parmi les fougères,/Pour me chamailler dans une vallée » – est-ce que la blague est sur vous ?
Il est possible, du point de vue du présent, d'assimiler ces images anciennes à l'histoire familière du déclin d'une civilisation fondée en partie sur un savoir culturel commun. Bien sûr. Peu importe. Les choses s'effondrent (Yeats). Cependant, dans les termes mêmes des dessins animés, jaillir des extraits de poésie est un signe indubitable d'excentricité – le passe-temps des femmes folles et des illustrateurs masculins qui les mettent sur papier. Il s’agit moins d’une civilisation que d’une congrégation de cinglés, d’une entreprise visionnaire (Hart Crane) de marginaux. Mais ne me citez pas là-dessus.