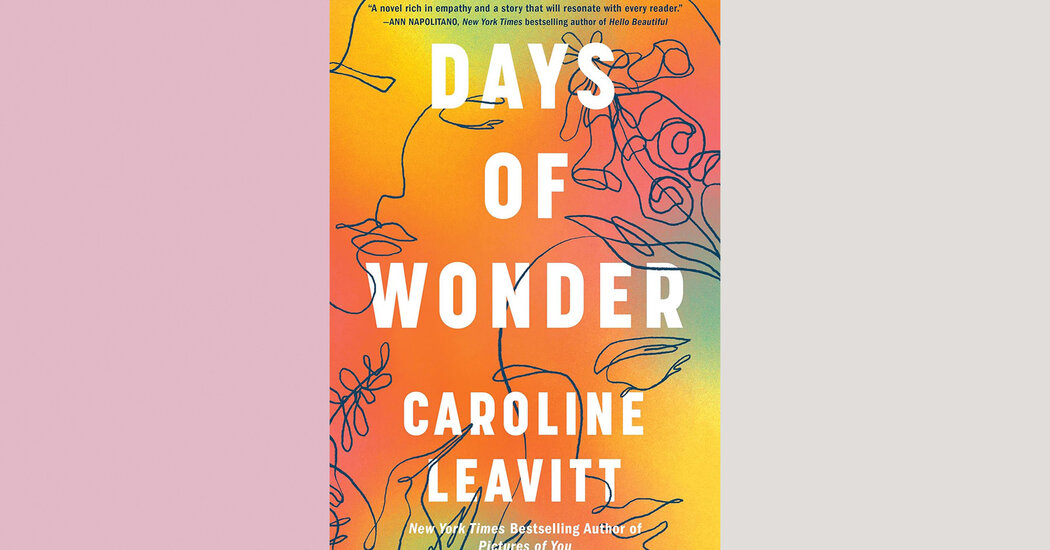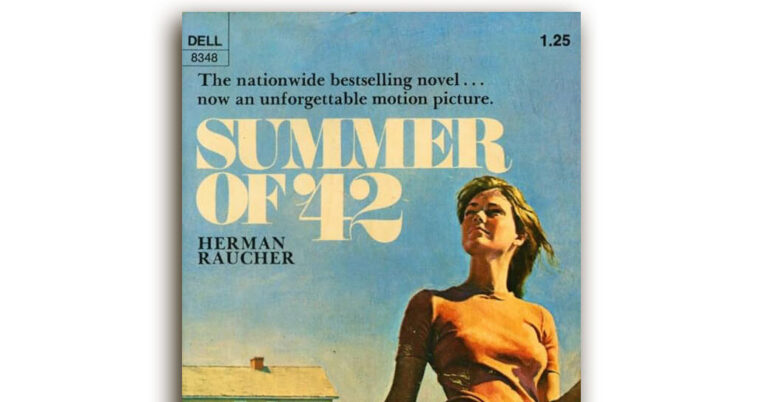Un roman de filles perdues et de vies errantes
Lorsque l’injustice de la vie vous submerge, est-ce que cela fait ressortir votre courage et votre détermination, ou vous envoie-t-il dans un terrier de griefs et de désespoir ?
Tel est le carrefour auquel sont confrontées trois personnes profondément blessées dans le 12e roman de Caroline Leavitt, « Days of Wonder » : Ella Fitchburg, nouvellement libérée de prison après avoir été reconnue coupable d'avoir tenté d'empoisonner le père de son riche petit ami ; son amour d'adolescent, Jude, victime de violence domestique qui traîne sa propre meule de culpabilité ; et la mère d'Ella, Helen, qui a été cruellement chassée de sa communauté juive hassidique alors qu'elle était adolescente enceinte.
Ella est elle aussi enceinte au début de sa peine de 25 ans de prison, mais elle est pressée de donner la petite fille en adoption. Libérée près de deux décennies plus tôt grâce à l'intervention d'un gouverneur, Ella, aujourd'hui âgée de 22 ans, retrouve l'enfant, qui a été adoptée et nommée Carla, et déménage à la hâte de Brooklyn à Ann Arbor, dans le Michigan, pour être proche d'elle – sans la révéler. véritable identité aux nouveaux parents de sa fille. Un croisement entre la sardonique Esther Greenwood de Sylvia Plath et Allison McKenzie de « Peyton Place » (l'itération de Mia Farrow), Ella convoite principalement la sécurité et une place plus grande dans le monde, s'accrochant à un rêve illusoire d'elle, Jude, Carla et d'une vie qu'ils je ne pourrai jamais avoir.
Tout au long, nous ressentons le profond désir d'Ella, sa douleur d'avoir été si spectaculairement trompée par la vie. Hélas, cela ne l'empêche pas de passer pour une harceleuse effrayante : elle se cache dans une banquette arrière du bar où travaille le nouveau père de sa fille, surgit comme un diable à ressort dérangé pour prendre des photos de Carla sur son téléphone portable. et laisse anonymement des mitaines tricotées dans la boîte aux lettres familiale.
Il nous est également demandé de maintenir une certaine suspension sérieuse de l'incrédulité. Malgré une adoption fermée, Ella découvre rapidement où se trouve sa fille lorsqu'un avocat expose négligemment un dossier avec l'adresse de la famille ; Ella rencontre Carla après que la balle errante de la petite fille ait miraculeusement roulé devant ses pieds dans une aire de jeux, un trope pour les âges. Peut-être le plus ridicule : sans aucune expérience, Ella décroche un emploi de chroniqueuse indépendante de style « Dear Abby » pour un hebdomadaire à Ann Arbor et est capable de subvenir à ses besoins. C'est digne du même regard que nous avons collectivement offert lorsque Carrie Bradshaw a pu s'offrir tous ces Cosmos et ces chaussures coûteuses.
Leavitt est clairement dans son élément ici : ses romans précédents sont une collection savonneuse de femmes éprouvant la douleur, le regret et, finalement, la rédemption. Mais la tâche consistant à démêler la myriade de secrets des personnages et le mystère brumeux qui lie Ella, Jude et Helen ensemble est pénible et conduit à des raccourcis (l'empressement d'Ella à devenir la meilleure amie de la mère adoptive de Carla semble un peu pratique). Cela aboutit également à un dénouement qui semble aussi trop soigné et sans âme qu’un exemple de maison.
Bien qu'il se déplace par intermittence entre les histoires individuelles du trio, le récit est en grande partie motivé par Ella – Jude et Helen semblent servir davantage de casting de soutien, présents pour à la fois refléter sa douleur et marquer le chemin des promesses non tenues qu'elle a tenues péniblement. L'intrigue parfois clichée est renforcée par la prose gracieuse de Leavitt : Ella voit sa mère comme « une éponge sèche et tordue qui ne pouvait plus se dilater » ; tombant amoureuse du bateau de rêve Jude du lycée, elle se retrouve dépassée dans son cercle social, ne sachant pas « comment s'habiller à la manière décontractée de l'élite adolescente » ; À sa sortie de prison, elle se faufile parmi une foule de journalistes, « leurs voix sont comme des épines ».
Le titre du roman est un peu trompeur ; le livre parle bien moins des jours merveilleux que de la ténacité nécessaire pour survivre aux mauvais jours de la vie. En fin de compte – et malgré suffisamment de mélodrame pour « General Hospital » – il annonce le pouvoir d’une persévérance constante, d’une foi solide et du pouvoir réparateur brut de l’amour.