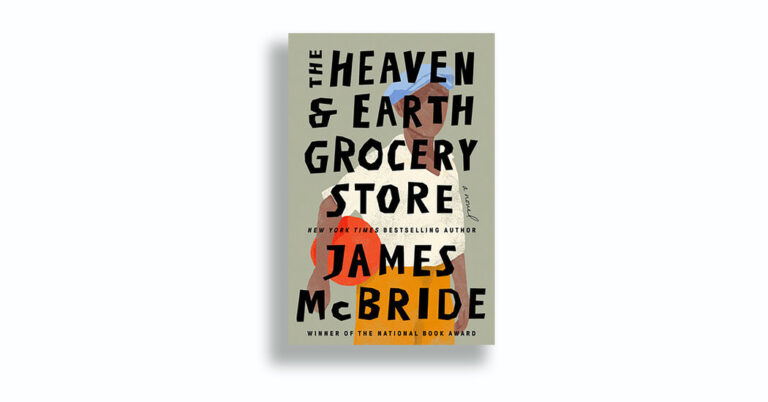Deux romans de Renegade Women
Chers lecteurs,
En général, j’aime l’agitation festive et frénétique de décembre – tous ces New-Yorkais soufflés par le vent et toujours surchargés se précipitant vers les vacances et la nouvelle année civile attendant juste au-delà avec les cloches allumées. C’est aussi le mois de mon anniversaire ; une fête à glisser entre mille autres choses brillantes et conviviales. Il y a deux ans, cependant, ma sénescence annuelle a atterri au milieu du tour du chapeau littéraire le plus sinistre : d’abord la mort de Bell Hooks le 15 décembre, suivie deux jours plus tard par Eve Babitz, et puis juste avant Noël, le coup final, Jeanne Didion.
Ce qui ne veut pas dire que leur vie a été mal engendrée ou tragiquement écourtée ; nous devrions tous avoir la chance de chevaucher deux siècles avec de telles réalisations et une sortie couverte de gloire. La douleur que j’ai ressentie à leur disparition collective était une tristesse plus ordinaire mêlée à une sorte d’envie existentielle : oubliez les Substacks nombrilistes et les querelles de théières sur les réseaux sociaux de la littérature contemporaine – y aurait-il encore un jour des écrivains comme celui-là qui vraiment vivait? Donnez-moi des tremblements de terre au Salvador et des échecs nus avec de célèbres dadaïstes français ! Laissez-moi perturber le monde universitaire, le féminisme et même la grammaire comme un patron absolu !
À la suite de toute cette perte secondaire, une conversation avec le romancier Kevin Wilson a apporté la consolation inattendue d’un nouveau béguin pour une femme moins célèbre. Pendant des années, a-t-il déclaré, il était obsédé par la collection des œuvres difficiles à trouver de Theodora Keogh, une petite-fille trois fois mariée de Teddy Roosevelt qui vivait autrefois sur un remorqueur dans le port de New York et gardait un margay pour animaux de compagnie (pensez : un petit ocelot) qui lui aurait mordu une partie de l’oreille et aurait travaillé comme danseuse en Amérique du Sud avant de se tourner vers l’écriture de délicieuses pulpes intellectuelles comme « Street Music » et « The Tattooed Heart ».
Autres faits amusants : Keogh est considérée comme la rare femme contemporaine à avoir jamais reçu les éloges critiques de sa camarade renégat et légendaire cliente coriace, Patricia Highsmith. Malgré leur penchant commun pour l’expatriation européenne et leur sexualité libre, je ne sais pas si Thea et Patty (ce sont évidemment leurs surnoms dans ma tête) se sont déjà rencontrées. Mais j’aime penser que les deux livres de la dépêche de cette semaine sont encore en conversation d’une manière ou d’une autre. Et que, quel que soit l’au-delà jazzy qui existe pour les romanciers capricieux, ils sont là-haut en train de brûler négligemment leurs martinis, et de laisser libre cours à leurs identités et à leurs chats sauvages qui ont un petit creux.
—Horrible
Marvins désordonnés du monde, je vous le demande : vous êtes-vous déjà senti plus vu par une phrase que « Meg ne savait tout simplement pas ce que c’était d’être soignée » ? Tandis que les autres élèves de son école privée pour filles de Manhattan arrivent impeccablement pressées, avec des infirmières sévères à la remorque, la muse de 12 ans des débuts minces et semblables à une comète de Keogh traîne dans « chaud et essoufflé, déchirant sur des patins ou à pied. Elle était toujours seule, ses cheveux volaient déjà de ses tresses en mèches raides, son visage fier et autonome suite à la bataille quotidienne dans les rues de New York.
Laissée presque entièrement sans surveillance par ses parents distraits et glamour, Meg fait de la ville son huître, avec tout le courage et le piquant qu’implique ce petit bivalve. Qu’elle fasse chanter négligemment une enseignante lesbienne ou affronte allègrement un futur Humbert Humbert devant un automate, Meg respecte rarement les lois naturelles au-delà de sa propre fantaisie, même si elle recherche aussi ouvertement l’amitié et l’approbation – à la fois d’une jolie camarade de classe conventionnelle et d’un bande de garçons ragamuffins qui traînent sur le front de mer. (Ce dernier mène à une rencontre sexuelle tranquillement brutale, dépeinte avec une simplicité déchirante.)
Le meurtre d’une prostituée, les réflexions d’une logeuse aveugle et la lutte acharnée psychosexuelle entre un couple marié d’âge moyen colorent les coins d’une histoire qui, avec ses 144 pages au format de poche, est déjà pleine à craquer. Mais c’est la prose de Keogh, brillante et impitoyable, qui insuffle la vie à ce livre étrange et vibrant ; pas étonnant que Highsmith se soit évanoui.
Les morceaux de Franny dans « Franny & Zooey » ; la superbe chanson des Slits « Typical Girls ».
Librairies d’occasion et coins bizarres d’eBay, pour la plupart.
« La cellule de verre » par Patricia Highsmith
Fiction, 1964
Cher lecteur, s’il vous plaît, ne jugez pas la couverture véritablement criminelle de cette réédition du début des années 2000 – même si c’est ce qui m’a presque fait la laisser dans la rue, où elle croupissait dans un tas de feuilles d’automne et d’appareils de cuisine à moitié morts. Épuisé des décennies après sa publication initiale, « The Glass Cell » est loin d’avoir atteint le sommet de Highsmith, mais il est néanmoins éminemment dévorable. L’intrigue, inspirée de sa correspondance avec un détenu, se déroule directement dans un pénitencier de l’État du Sud, où un jeune ingénieur respectable de New York se retrouve arrêté pour méfaits financiers et purgeant six années interminables.
Au début, Philip Carter croit en la bonté inhérente à toute chose : la loi et l’ordre, sa charmante épouse. Mais la prison est un lieu où l’humanité se flétrit et où l’espoir meurt ; c’est aussi là qu’un homme peut facilement égarer son âme en prenant une mauvaise habitude aux opiacés. Lorsqu’il est libéré et retourne à Manhattan pour rejoindre sa famille, un nouveau relativisme moral le suit chez lui. (Qu’est-ce qu’un petit homicide justifié quand on a déjà tant perdu ?)
Les personnages sont pour la plupart des archétypes et les dialogues sont si durs que leurs jaunes sont verts sur les bords. Mais le claquement propulsif de l’intellect calme et impitoyable de Highsmith est présent sur presque chaque page ; c’est une lecture désolante que vous pouvez terminer en une journée.
Barbituriques, mauvaises décisions, soirée noire dans n’importe quelle maison de réveil.
Principalement deux rééditions – une de Norton en 2004 et Virago en 2014 (si vous préférez une couverture beaucoup plus cool).
Pourquoi tu ne…
-
Apprenez-en un peu plus sur la vie débridée de Keogh dans cet article piquant et trop bref de la Paris Review du regretté biographe de Highsmith, Joan Schenkar ?
-
Étendez votre gratitude pour Thanksgiving via l’ode poignante et parfaite de George Saunders à ses mentors universitaires dans l’essai vintage du New Yorker « My Writing Education: A Timeline » ?
-
Faire comme l’assassin amoureux des Smiths de Michael Fassbender dans le récent thriller aux yeux secs de David Fincher « The Killer » et reprendre le nouvel hommage crémeux du guitariste Johnny Marr, « Marr’s Guitars » ? Ou donnez-le à n’importe quel tueur à gages émotionnel dans votre vie.
Plongez davantage dans les livres du New York Times ou dans nos recommandations de lecture.
Si vous appréciez ce que vous lisez, pensez à le recommander à d’autres. Ils peuvent s’inscrire ici. Parcourez toutes nos newsletters réservées aux abonnés ici.
Rappel amical : vérifiez les livres de votre bibliothèque locale ! De nombreuses bibliothèques vous permettent de réserver des exemplaires en ligne.