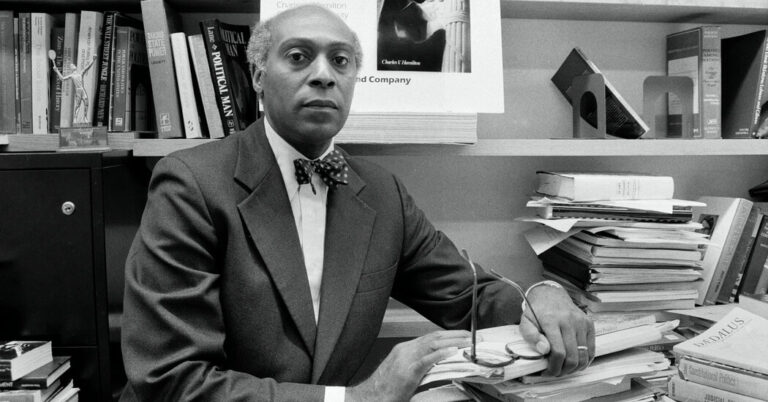Critique de livre : « Une histoire de la combustion », par Janika Oza
Plus de la moitié du remarquable premier album de Janika Oza, « A History of Burning », l’un des personnages écrit dans une lettre : « J’ai fait le choix de rester du côté de la vie. J’ai fait ce qu’il fallait faire. »
La déclaration résonne dans ce roman épique sur une famille indo-ougandaise élargie qui est déplacée, installée et déplacée à nouveau. À chaque perturbation du mouvement, l’auteur interroge habilement les grands thèmes de la survie, de l’héritage, de l’immigration, du colonialisme et du racisme. À tous points de vue, c’est une entreprise intimidante : le récit d’Oza traverse près d’un siècle de temps, quatre générations de famille, cinq continents et plusieurs langues, l’histoire se déplaçant entre les perspectives de 10 personnages (en grande partie racontée à la troisième personne avec un quelques détours à la première personne durant le dernier quart du roman). Le résultat est un conte symphonique obsédant qui parle des complexités nuancées de la classe et du traumatisme pour cette famille particulière.
« A History of Burning » s’ouvre en 1898 lorsque Pirbhai, un intrépide de 13 ans, est amené à la servitude sous contrat (sa signature sur les papiers est une empreinte digitale à l’encre noire ; il est analphabète). Sans dire au revoir, le garçon quitte sa famille à Porbandar et passe des mois dans un bateau sur la mer d’Oman. Après son arrivée sur les quais de Mombasa, Pirbhai travaille de longues heures au sein d’une équipe qui construit un chemin de fer vers le lac Victoria au Kenya. Les conditions sont brutales, avec peu de nourriture, pas de logement et de longues heures de travail sous le soleil implacable.
« La nuit, ils se maintenaient en vie avec des histoires », écrit Oza. « Assis assez près du feu que leurs cheveux ont brûlé, ils ont raconté des histoires sur leurs maisons, leurs passés, leurs futurs provisoires. »
Bientôt, Pirbhai est confronté à un choix décisif : un colonel ordonne que lui et son ami Rakesh mettent le feu à un groupe de huttes afin de dégager le chemin pour plus de pistes. « Vous vous rendez compte de ce qu’ils nous demandent de faire ? Tuez pour eux. Faites leurs actes sanglants. Nous sommes leurs chiens », dit Rakesh avant de s’enfuir. Pirbhai récite une prière de miséricorde, verse de l’essence et craque une allumette : « Le chaume sec s’est enflammé. Le feu rugissait, craquait contre l’air lourd.
Cet acte destructeur crucial hante Pirbhai et les générations de sa famille à suivre.
Pirbhai épouse finalement Sonal, la fille aînée d’un commerçant. Ils déménagent à Kampala, où il travaille dans la pharmacie d’un parent ; ils ont trois enfants, deux filles et un fils.
La saga d’Oza avance à travers les années et les événements de la vie à un rythme accéléré. Le fils de Pirbhai et Sonal, Vinod, épouse une jeune femme nommée Rajni et ils ont trois filles : Latika, Mayuri et Kiya. La majeure partie du roman est centrée sur cette génération, en mettant l’accent sur les choix faits par chaque fille et sur la façon dont chacune définit les femmes et qui elles deviennent. Latika se transforme en activiste politique; Mayuri va à l’école de médecine de Bombay ; Kiya est un joueur de cricket qualifié et plus tard un assistant de classe.
En août 1972, la vie de cette famille élargie vole en éclats : le dictateur de l’Ouganda, Idi Amin, ordonne l’exil des Asiatiques sous 90 jours. La brutalité de cette expulsion prend vie sur la page – la ruée vers les visas, les files d’attente interminables, la vente de biens afin de pouvoir s’offrir des billets d’avion.
En même temps, une tendre humanité se dégage lors de ces moments de cruauté colossale. Oza écrit du point de vue de Rajni alors que sa famille se prépare à fuir : « Autour d’elle, elle a vu des collines infinies s’élever jusqu’aux pics embrumés. Un déversement de jacaranda sur une clôture d’enceinte, les bulbes incandescents d’une vigne matunda. Un groupe de chauves-souris s’est transformé en esprits dans la lune blanche comme du lait. Le saphir du lac Victoria s’est répandu, les perles de la crête de l’eau. Un chemin de fer long de milliers de corps, sous lequel se trouvent les ruines d’autres maisons. Les cendres de leurs ancêtres unies à la terre, la terre hachurée de cicatrices. La terre — saisie, non réclamable. Devant eux, quelque part attendant comme une bouche silencieuse.
Ce roman captivant n’est interrompu que par quelques faux pas. Vers la fin, alors qu’Oza se concentre sur les membres de sa famille vivant à Toronto, le personnage de Latika perd de la dimension et de la profondeur, en particulier lorsque sa perspective passe à la voix à la première personne, ce qui crée une rupture dans le charme du livre. De plus, les tours de l’intrigue à la fin du roman semblent pratiques; l’histoire se replie trop soigneusement dans la métaphore globale du livre.
Dans son essai de 1982, « Imaginary Homelands », Salman Rushdie écrit : « Être un écrivain indien dans cette société, c’est faire face, chaque jour, à des problèmes de définition. Que signifie être « Indien » en dehors de l’Inde ? Comment préserver la culture sans s’ossifier ? Comment devrions-nous discuter du besoin de changement en nous-mêmes et dans notre communauté sans avoir l’air de faire le jeu de nos ennemis raciaux ?
Oza explore ces questions enchevêtrées dans « A History of Burning » et révèle comment les réponses se transmutent de génération en génération et de personnage en personnage. Rien n’est éternel. À travers son importante distribution de personnages, l’auteur anime les histoires intimes d’une famille, qui parlent d’une image panoramique plus large – comment les droits et les privilèges, la liberté et les restrictions, et l’action et la stase deviennent des gouvernails pour les migrations et les destins.
À la fin du même essai, Rushdie fait référence au roman de Saul Bellow « The Dean’s December », dans lequel un personnage principal imagine qu’un chien qui aboie proteste contre les limites de l’expérience. « Pour l’amour de Dieu », imagine-t-il le chien en train de dire, « ouvrez un peu plus l’univers ! »
Cette demande – et cet esprit – pour une narration plus audacieuse qui transcende les frontières et les identités se retrouve certainement dans le roman généreux d’Oza. L’auteur ouvre les choses à ses lecteurs. Plus de vie, plus de joie et plus d’amour au milieu d’un paysage changeant et stratifié de pertes indescriptibles. Tout est là – l’humanité compliquée et le chagrin de la famille de personnages d’Oza – que le lecteur doit considérer et voir.