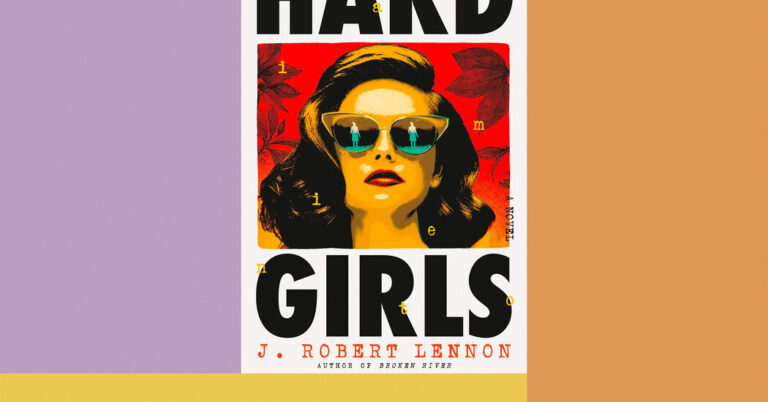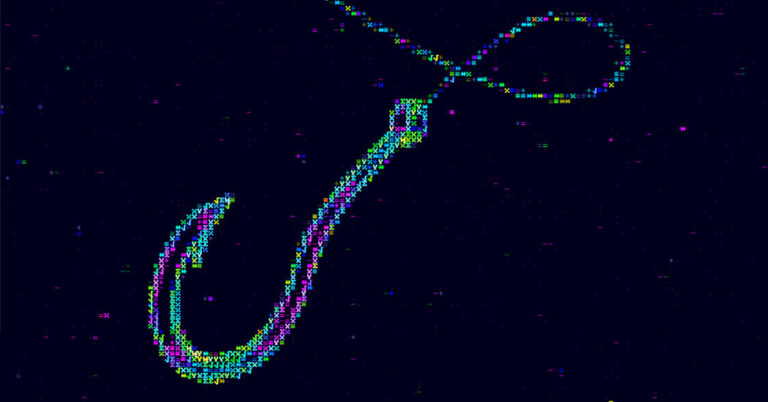Critique de livre : « Notre avenir était brillant », de David Leonhardt
David Leonhardt, rédacteur principal du New York Times, a écrit une « biographie » du rêve américain, plus précisément – comme son titre « Ours Was the Shining Future » le suggère – un récit de la façon dont le rêve s’est flétri et presque décédé.
Son argument frappant, basé sur une étude des données du recensement et de l’impôt sur le revenu réalisée par l’économiste de Harvard Raj Chetty, est que là où autrefois la grande majorité des Américains pouvaient espérer gagner plus que leurs parents, aujourd’hui, seule la moitié est susceptible de le faire. Même si le ratio précis dépend des hypothèses concernant l’inflation et est moins frappant, comme le note Chetty, lorsque l’on prend en compte la diminution de la taille des ménages, le point général est incontestable. Le progrès économique définissait l’Amérique. Aujourd’hui, Leonhardt constate « une stagnation dans presque toutes les mesures fiables du bien-être ». Il exagère sans doute ce chiffre – par exemple, le revenu médian des ménages a généralement continué d’augmenter – mais le mal qu’il identifie est réel.
Leonhardt soutient qu’au cours des 50 dernières années, les États-Unis ont déraillé en passant d’un capitalisme plus réglementé à une version plus brutale, plus individualiste et centrée sur le marché. Ce changement, affirme-t-il, a conduit à une plus grande inégalité et – une logique causale plus difficile à prouver – à un ralentissement de la croissance.
Le principal coupable selon Leonhardt est le système politique : en un mot, trop de républicains et le mauvais type de républicains. Dans les années 1950, nous avions Dwight D. Eisenhower, un général à la retraite non idéologique qui a prolongé les réformes de l’ère du New Deal et investi dans l’un des grands projets d’infrastructure du siècle, le réseau routier national. Les dirigeants d’entreprise de l’époque d’Eisenhower avaient le même esprit social. Nourris par la double crise de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, ils partageaient un objectif commun avec les travailleurs, toléraient les syndicats et acceptaient des salaires relativement modestes pour les dirigeants.
Adieu à tout ça. Avec Ronald Reagan, les Républicains ont troqué le country club contre le groupe de réflexion. Des intellectuels et des juges conservateurs comme Robert Bork (qui était tous deux) ont contribué à changer la culture et ont finalement affaibli à la fois la réglementation fédérale et l’objectif fédéral.
Les États-Unis possédaient autrefois la population la plus instruite du monde et un système de transport impressionnant. Maintenant, ce n’est pas le cas. Nous nous classons également parmi les derniers pays développés pour ce qui est de l’offre de cours de pré-maternelle. « Nous nous sommes éloignés de nos idéaux » d’« égalité, de liberté, d’opportunités et de démocratie », écrit Leonhardt, et, à partir du milieu des années 1970, « nous sommes entrés dans une nouvelle ère économique sombre ».
Même si Leonhardt est un homme aux sympathies progressistes — peut-être parce que de ces sympathies – il consacre beaucoup d’encre à fustiger les démocrates. Il les accuse d’abandonner les questions fondamentales comme les syndicats et le salaire minimum pour des causes néolibérales, comme le libre-échange et le soutien sans réserve à l’immigration. Il déplore également la profonde plongée du parti dans la politique identitaire, qui a aliéné la classe ouvrière blanche. Les Démocrates sont devenus un parti pour les étudiants.
Bien que cet argument soit familier, « Ours Was the Shining Future » n’est pas un livre au sentiment familier. Leonhardt introduit chaque section avec une vignette historique : A. Philip Randolph organisant les porteurs de train et obtenant des augmentations allant jusqu’à 30 pour cent pour son syndicat ; La secrétaire au Travail Frances Perkins, la première femme à siéger dans un cabinet présidentiel, exige que Franklin D. Roosevelt se batte pour l’assurance chômage, l’invalidité et la journée de travail de huit heures.
Leonhardt a clairement sélectionné ses anecdotes pour faire valoir son point de vue, mais les histoires animent ce qui aurait pu être une polémique aride ou riche en données. Ils font également progresser sa vision du monde : les politiques et les personnalités ont un grand effet sur le progrès économique.
Si vous considérez l’économie comme un écosystème dans lequel des millions d’agents intéressés interagissent par le biais des prix, ce livre n’est pas fait pour vous. « Ours Was the Shining Future » offre une vision descendante de l’économie. C’est un livre sur le capitalisme dans lequel le gros du travail est fait par les présidents, les progressistes et les dirigeants syndicaux – et non par les capitalistes. Dans une sorte de version bleue de MAGA, Leonhardt est nostalgique de l’époque où les PDG, les syndicats et les représentants du gouvernement dirigeaient le spectacle.. Il a des paroles aimables non seulement à l’égard des programmes d’emploi et de protection sociale nécessaires de Roosevelt, mais également à l’égard du National Industrial Recovery Act du New Deal, qui impose des codes industriels pour fixer les prix, les salaires et les quotas de production – une vaste expérience de planification que la Cour suprême a miséricordieusement abandonnée.
Leonhardt ne se rend compte qu’en passant que les investisseurs, les hommes d’affaires, les journalistes, les vendeurs, les agents de change et d’autres parmi les 85 pour cent des travailleurs du secteur privé du pays pourraient contribuer à sa prospérité, d’où cette concession remarquablement modeste : « Un programme progressiste, de la gauche politique, n’est pas le seul moyen plausible d’améliorer le niveau de vie de la plupart des membres d’une société.» Eh bien, merci pour ça.
Leonhardt se concentre à la mode sur les inégalités, au détriment presque total des taux de croissance (où l’Amérique occupe généralement une place élevée). « Le niveau de vie ici, note-t-il, est bien plus élevé que dans la plupart des autres pays du monde. » Cela devrait compter pour quelque chose, mais il évalue à plusieurs reprises les présidents, ou leurs époques, à l’aune des inégalités économiques.
Ce qui manque, c’est le sentiment que les politiques de péréquation, telles que les barrières commerciales, impliquent souvent un compromis – des avantages mais aussi des coûts sous la forme d’une perte d’efficacité. Il fustige le président Clinton pour être une version démocrate de Reagan, notamment pour avoir signé un accord de libre-échange. Il note que les revenus des couches supérieures ont augmenté plus rapidement sous Clinton que les salaires des couches inférieures. Pourtant, les salaires des cols bleus se sont considérablement redressés, l’emploi a explosé et le pays a prospéré. Les ouvriers auraient-ils renoncé à la prospérité pour voir les investisseurs souffrir ?
L’autre péché de Clinton, selon Leonhardt, est qu’« il n’a pas fait grand-chose pour renforcer les syndicats ». Leonhardt considère les syndicats comme une bénédiction sans réserve, rejetant d’emblée, ou se contentant de l’admettre du bout des lèvres, la possibilité que les syndicats aient augmenté les salaires et les avantages sociaux – dans l’industrie automobile, par exemple – au point où leurs secteurs sont devenus non compétitifs. Et il affirme comme une vérité reçue que le déclin des syndicats a freiné les salaires. Il est également possible (ce que Leonhardt reconnaît) qu’à mesure que d’autres nations se reconstruisaient ou émergeaient après la Seconde Guerre mondiale, la position concurrentielle de l’Amérique diminuait naturellement. Ainsi, la baisse du taux de syndicalisation pourrait avoir été plus un effet qu’une cause.
Leonhardt sait que les Américains ont des « sentiments mitigés » à l’égard des syndicats ; il avait des sentiments mitigés en tant que membre d’un syndicat au Times. Ses représentants syndicaux « semblaient plus intéressés à toucher leur propre salaire et à atteindre la retraite qu’à aider leurs membres », écrit-il. Lorsqu’il a quitté le syndicat pour rejoindre la direction, il s’est senti frustré par la « résistance au changement » du syndicat dans une entreprise « qui avait besoin d’évoluer ». Peut-être lui est-il venu à l’esprit que d’autres entreprises doivent également évoluer.
Malgré les implications du récit stylisé de Leonhardt, les tendances économiques telles que les salaires ne correspondent pas toujours parfaitement aux époques politiques. Les salaires réels, tout comme le taux de syndicalisation, avaient commencé à décliner au début des années 1970 – bien avant le triomphe culturel de la droite dans les années Reagan. Le rebond économique sous Reagan n’est pas pratique pour Leonhardt, qui maintient que les politiques conservatrices sont de mauvais augure pour la croissance. Il qualifie les performances économiques de Reagan de moins spectaculaires que celles de Roosevelt, John F. Kennedy ou Lyndon B. Johnson. Une comparaison plus pertinente et plus juste aurait peut-être été faite avec les prédécesseurs immédiats (et plus faibles) de Reagan : Nixon, Ford et Carter.
« Ours Was the Shining Future » est un livre intéressant, avec de nombreux points provocateurs, mais je l’ai trouvé trop tendancieux pour dire le dernier mot sur le sort du rêve américain. Leonhardt nous dit que son livre s’adresse « à quiconque essaie de comprendre comment notre économie – et, avec elle, notre société – a été entravée ». Il conclut par une discussion sur la manière dont les progressistes pourraient remporter les élections à l’avenir. Son discours partisan pourrait rebuter certaines des personnes qu’il vise à atteindre.