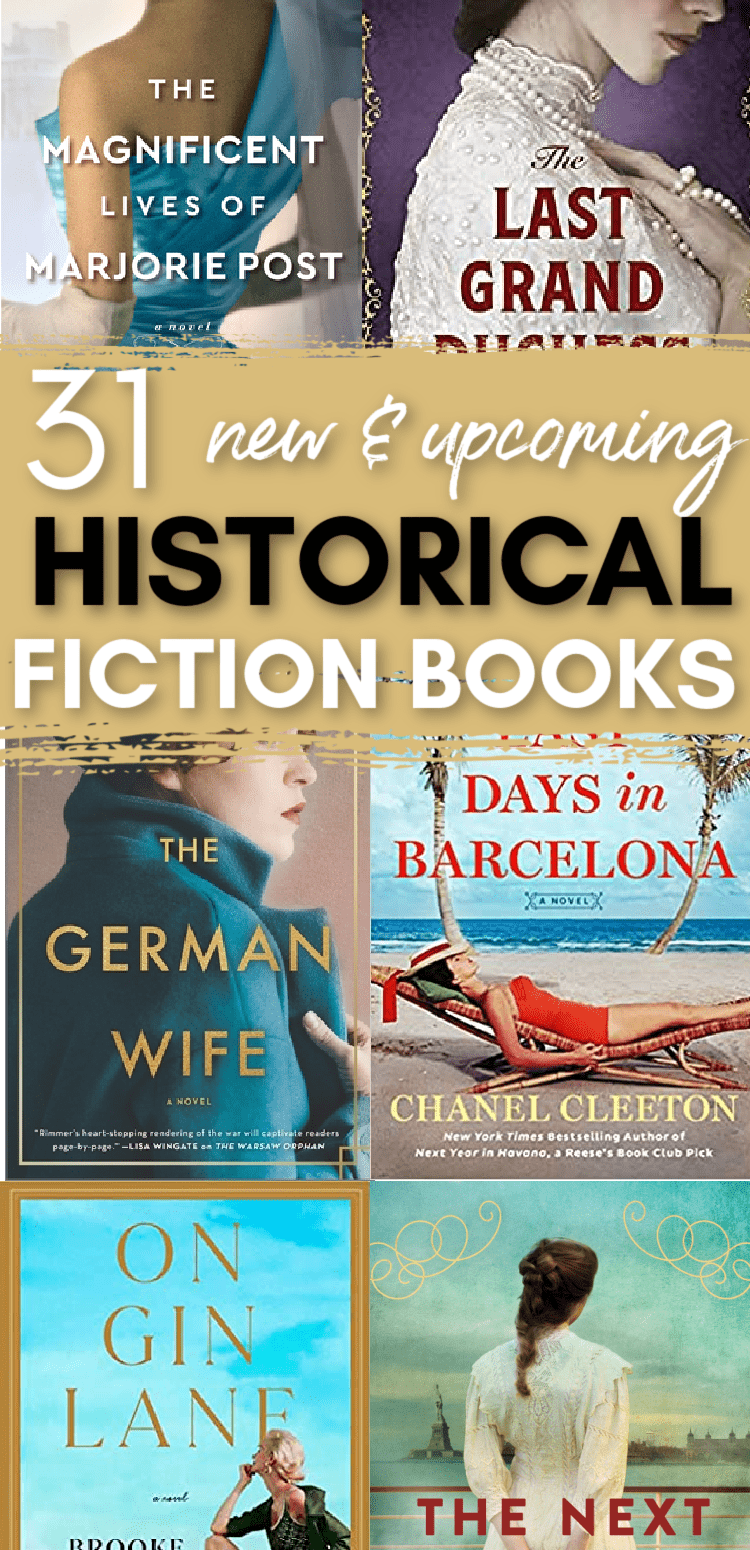Critique de livre : « Lucky Girl », par Irene Muchemi-Ndiritu ; « La peau et sa fille », de Sarah Cypher ; et « Ghost Girl, Banana » de Wiz Wharton
Le premier roman d’Irene Muchemi-Ndiritu est une histoire de passage à l’âge adulte sur une adolescente privilégiée mais protégée au Kenya, Soila, qui a soif d’évasion. Elle veut quitter les bidonvilles et la misère de Nairobi pour les États-Unis, un pays qu’elle croit naïvement sans souffrance humaine, mais surtout elle veut s’éloigner de sa mère. Son seul parent vivant, son « yeyo » est une femme d’affaires prospère qui est profondément religieuse et inflexible, parfois jusqu’à la cruauté.
L’histoire se déroule en grande partie dans le New York des années 1990, alors que Soila raconte son exploration prudente de la liberté à Barnard et au-delà. Pourtant, même à des milliers de kilomètres de là, sa mère exerce une influence, orientant Soila vers une carrière qu’elle ne veut pas (la banque d’investissement au lieu de la photographie), l’interrogeant sur sa virginité (secrètement disparue) et jugeant les petits amis de Soila inappropriés, y compris un artsy dreamboat dreadlocké qui est presque invraisemblablement parfait.
Soila a nos sympathies, mais c’est une narratrice erratique, relatant ses activités les plus ennuyeuses avec une minutie consciencieuse, comme si elle tenait un journal, tout en retenant les informations dont le lecteur a besoin. Lorsqu’elle renoue avec son premier petit ami, un étudiant en médecine nommé Alex, qui est également kenyan mais biracial, il n’y a aucune mention de l’endroit où ils s’assoient, sexuellement, jusqu’à ce qu’ils se connaissent depuis près d’un an. Compte tenu de l’histoire de Soila – elle a été agressée sexuellement et a partagé son anxiété autour du sexe – le lecteur peut se sentir exclu ou déconcerté par l’omission. La prose de Muchemi-Ndiritu peut être raide, renforçant ce sentiment de distance.
« Lucky Girl » est à son apogée lorsque Muchemi-Ndiritu aborde le sujet du racisme américain. Soila est depuis longtemps prête à l’ignorer même lorsqu’elle en fait l’expérience directe ; son point de vue est que tout vaut mieux que la pauvreté au Kenya. Elle et ses amis et amants ont des arguments passionnés sur la race qui se déroulent dans le genre de longs échanges conversationnels que l’on pourrait voir dans un roman de Rachel Cusk. Alex la presse de changer de code, de se conformer un peu, comme il l’a fait. Soila trouve son identité « difficile à se débarrasser. Ce n’était pas une paire de bottes que je pouvais laisser à la porte et en choisir une autre. Son honnêteté à propos de sa «marque différente de Blackness» et, finalement, sa capacité à abandonner l’idée qu’il s’agit d’une marque, en font certains des passages les plus convaincants du livre.
Née dans le nord-ouest du Pacifique au printemps 2002, Elspeth « Betty » Noura Rummani est bleue de la tête aux pieds. Cette évolution spectaculaire dans les premières pages de Sarah Cypher maintient finalement Betty dans sa famille d’origine. Sa mère malade mentalement, Tashi, avait prévu de donner son bébé à l’adoption, mais les futurs parents adoptifs s’enfuient lorsqu’ils voient la peau de Betty. Betty grandit à la place avec sa mère, son père blanc et une famille élargie de Palestiniens américains charmants et excentriques.
La peau de Betty est magnifique et a – par coïncidence ou non – la même teinte que le savon fabriqué par des générations de Rummanis dans leur usine de la ville cisjordanienne de Naplouse, dont les restes sont détruits par des F-16 israéliens juste au moment où Betty est sur le point naître. OK, ça ne peut pas être une coïncidence, non ?
Mais déchiffrer le bleu de Betty ne semble pas être le but de Cypher, et cela ne joue pas non plus un rôle important dans l’intrigue, qui comprend d’autres éléments familiers du réalisme magique. Il y a des séquences de contes folkloriques élaborées et des images magnifiques et évocatrices. (La peau de Betty est « le bleu électrique pur d’une famille éclairée par la télévision ».) Toutes les descriptions n’atterrissent pas avec autant de succès ; à un moment donné, on dit que le soupir d’une femme dialogue avec la colère d’une autre femme, « le retournant comme un boulon de cachemire orange vif », et ce lecteur se sentait plongé dans le monde des pulls, pas des émotions.
Peut-être que Cypher a l’intention que la peau de Betty remplace l’altérité des immigrants comme Saeeda, sa grand-mère, et plus précisément sa grand-tante Nuha. Nuha, qui est venue en Amérique de Naplouse en tant que jeune adulte, cligne à peine des yeux à la peau bleue et sert de nounou et de féroce protectrice dans la petite enfance de Betty. Pendant des années, la famille garde Betty emmaillotée et cachée, évitant les transports en commun, comme si elle était ET et que le gouvernement pourrait l’emmener.
Nuha est un personnage merveilleux, comme une Mary Poppins qui fume à la chaîne. Une grande partie de ce roman ambitieux est racontée du point de vue de la jeune adulte Betty, gay et envisageant de quitter l’Amérique pour être avec son amant, parcourant l’histoire de la vie de sa tante enfermée, la racontant à Nuha, maintenant décédée, à la deuxième personne. Mais la nature pointilleuse et multicouche de tout le «vous» dans la narration gêne; personne ne pourrait être mieux équipé pour raconter sa propre histoire que Nuha Rummani.
Lily Miller, le personnage central de Wiz Wharton, a perdu sa mère, Sook-Yin, alors qu’elle était si jeune qu’elle n’a que deux souvenirs d’elle : que Sook-Yin sentait la pastèque et que leur famille, qui comprend une sœur aînée, Maya était heureuse. Alors que cette histoire de secrets de famille s’ouvre, Lily a 25 ans et est une décrocheuse déprimée et piquante de Cambridge qui ne s’est pas encore entièrement remise d’une tentative de suicide. Sa mère décédée s’accroupit dans son cerveau « comme un robinet qui goutte ou une facture impayée ».
La référence de la facture impayée est appropriée ; l’un des principaux thèmes narratifs de Wharton est l’argent et les dommages qu’il peut causer, soit par son manque, soit par son désir, ainsi que les corruptions et les compromis qui en découlent.
Lily, à peine employée, reçoit une lettre d’un avocat à Hong Kong, l’informant qu’il lui reste un demi-million de livres dans le testament d’un puissant banquier. Elle ne sait pas qui il est, il n’y a aucune explication de pourquoi, et il y a une provision pour l’argent : Lily doit venir à Hong Kong et signer avant la fin de la période de deuil de 49 jours de sa famille. Nous sommes en 1997, juste au moment où le transfert historique du pouvoir de la Grande-Bretagne à la Chine doit avoir lieu.
Le roman rebondit entre trois chronologies différentes, et Wharton navigue habilement entre chacune. Nous rencontrons l’intrépide Sook-Yin en 1966 alors qu’elle est expédiée en Angleterre pour l’école d’infirmières, puis se retrouve coincée avec un proche inconnu, Julian Miller, un bon à rien qui aime les pubs et qui l’imprègne. Dans la troisième chronologie, Sook-Yin, maintenant mère de deux enfants qui a fait des sacrifices répétés pour maintenir l’unité de sa famille, s’avance involontairement vers la mort en 1977. Nous savons que cela arrive mais pas comment, et Wharton en fait un vrai mordeur d’ongles; nous sommes fortement investis dans Sook-Yin et souhaitons une fin heureuse pour elle.
Adult Lily interroge cette histoire familiale à Hong Kong et se confronte à sa propre identité métisse. Elle ressemble à sa mère (Maya, blonde aux yeux verts, passe pour blanche) mais n’est pas assez chinoise pour son oncle, qui la surnomme « Ghost Girl ». (Sook-Yin était qualifiée de « banane » pour avoir choisi d’épouser un Anglais blanc, d’où le titre du livre composé de péjoratifs jumeaux.) Être marginalisée, ne jamais s’intégrer, même avec tous ses efforts, est le destin de Sook-Yin. Mais le voyage de découverte de soi de Lily, si bien raconté par Wharton, promet un meilleur sort à la fille cadette de Sook-Yin.