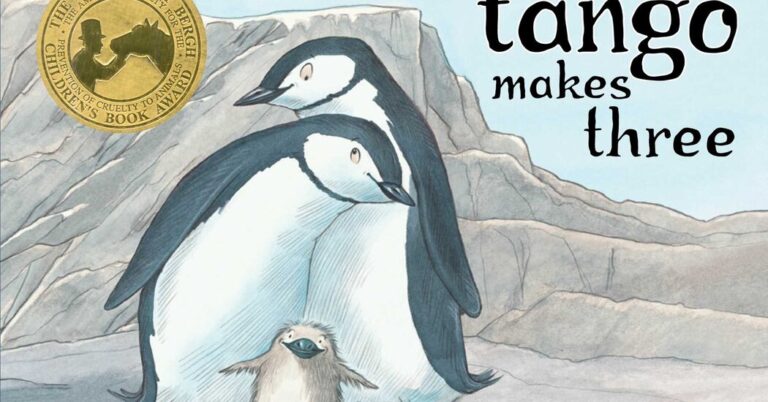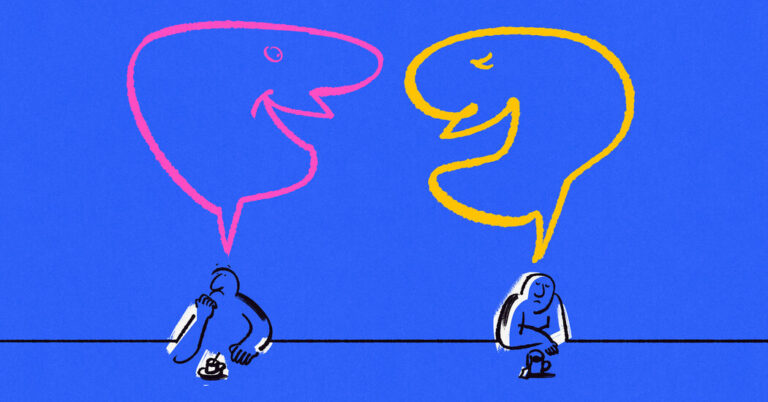Critique de livre : « L'extinction d'Irena Rey », de Jennifer Croft
En résumé : Oh mes champignons, « L’extinction d’Irena Rey » est incroyablement étrange, astucieux, sournois et difficile à classer. Je ne pouvais pas non plus le lâcher.
Enfin : c'est agréable de commencer un premier roman sans savoir qui est son auteur ni pourquoi son pedigree devrait lui correspondre si explicitement au livre qu'elle a écrit. Mais lorsque l'auteur est Jennifer Croft, la traductrice lauréate du prix Booker de la lauréate polonaise du prix Nobel Olga Tokarczuk, et que le roman parle de traducteurs, je pense qu'on ne peut pas éviter d'avoir certaines attentes. J'avais certainement le mien.
Ce roman mettra par exemple au premier plan le travail vital de la traduction et les différentes polémiques qui y sont associées. Vérifier. Ce roman sera riche en blagues de traducteurs, dont certaines que je comprendrai, dont d'autres que je – en tant que lecteur profane – ne suis pas censé comprendre. Vérifier. Peut-être aussi que ce roman ridiculisera le processus de traduction aux côtés des traducteurs eux-mêmes. Vérifier.
Ce que j'ai fait pas On s'attendait à ce que les débuts de Croft gambadent si joyeusement, si rigoureusement, dans l'absurde, l'insensé, et y restent du début à la fin. Ou que je finirais par batifoler avec elle. Lecteur, si vous cherchez à vous faire battre le cœur, ce roman n'est peut-être pas fait pour vous. Mais si vous avez envie de vous aventurer dans un désert d'idées, d'insinuations et d'intrigues écologiques (qui aurait cru qu'une telle chose existait ?), restez avec moi.
Quelqu'un a lu « Sartor Resartus » dernièrement? Le roman extrêmement étrange de Thomas Carlyle (le titre signifie en latin « The Tailor Retailored ») est raconté par un éditeur qui tente de réviser – mais en réalité de démanteler ou, au contraire, d'habiter – un livre encore plus étrange d'un écrivain qu'il connaît et se sent fortement concerné. « L'extinction d'Irena Rey » m'a immédiatement rappelé « Sartor », en partie à cause de ses récursions. Nous avons ici un traducteur (Croft), qui a écrit un roman narré par un traducteur (Emi), un roman lui-même en traduction et annoté par un autre traducteur (Alexis). Malheur au vrai traducteur qui devra relever ce défi, par exemple en pendjabi.
Il s'agit d'une configuration complexe – le traducteur retraduit – qui crée pour ce roman de multiples opportunités d'opposer le traducteur à l'auteur d'une manière tour à tour drôle et convaincante, mais qui met également à nu les tensions entre l'œuvre originale et ce qu'un traducteur y apporte. Après tout, la traduction est un exercice tellement lourd d’interprétation, de transformation, de fidélité et de rapprochement culturel qu’elle pourrait être le projet littéraire le plus délicat qui soit.
Le roman commence avec une célèbre auteure polonaise réunissant ses huit traducteurs chez elle, à la lisière de Bialowieza, une forêt vierge qui a été le site d'une exploitation forestière controversée par le gouvernement polonais. L'auteur, Irena, convoque le sommet pour commencer à traduire sa dernière épopée, « Grey Eminence ». Identifiés d'abord uniquement par leurs langues (drôle) — anglais, français, allemand, serbe, slovène, espagnol, suédois et ukrainien —, les traducteurs connaissent bien le rituel. L’entourage est animé par une sorte de convoitise pour « Notre Auteur » et une fidélité qui confine à la pathologie. Bientôt, cependant, le précédent s’effondre : cette fois, notre auteur est erratique, déroutant et, en fin de compte, manquant. Elle disparaît, faisant basculer le roman dans un mystère qui se déroule à travers une série de révélations, toutes plus invraisemblables les unes que les autres.
Est-ce que quelqu'un appelle la police ? Non. Personne ne fait ce qu’une personne raisonnable pourrait faire. Ce sont des traducteurs ! Des humains impuissants, malheureux et maladroits qui courent à travers la forêt en transportant des mythologies et des champignons, clôturant avec des épées en plastique, criant et criant, et essayant périodiquement d'avoir des relations sexuelles entre eux. Tout cela est très drôle et de plus en plus bizarre à mesure que le roman avance.
Mais ne vous y trompez pas : aucune de ces folies ne semble frivole. Au contraire, le roman s'appuie sur les angoisses du changement climatique, de l'extinction et du déséquilibre de la nature grâce à l'art. C’est-à-dire l’art au sens d’artifice – tout ce que nous, les humains, créons, se fait toujours et nécessairement au détriment de quelque chose d’autre. L’artiste est un vampire, un cannibale, un consommateur de tout et de tous, surtout d’elle-même. Il en va de même pour les traducteurs, compromis, impliqués et avides de sang – moins une alliance de fidèles qu’une foule en délire. Le tout dans le contexte d'une forêt sauvage et ancienne., dont le réseau de concessions mutuelles, de violence et de renouveau est attaqué.
Il n’est pas étonnant que tout le monde soit dérégulé dans ce climat. Ou que ce qui pourrait être lu comme une farce ou une parodie (des genres de l’horreur et du thriller, du caractère sacré de la traduction) semble ici émouvant, urgent, ringard.
« L'extinction d'Irena Rey » est fou d'intrigue, de langage et de prose magnifique, et le résultat est vraiment une bacchanale, qui est à l'opposé de l'extinction. Telle est l’ironie de l’art. Pour citer l'épigraphe du roman, on ne peut plus appropriée : « Et ainsi, ils ont forgé leur dualité en une seule, créant ainsi une forêt. » Ce roman est une forêt. Allez explorer.