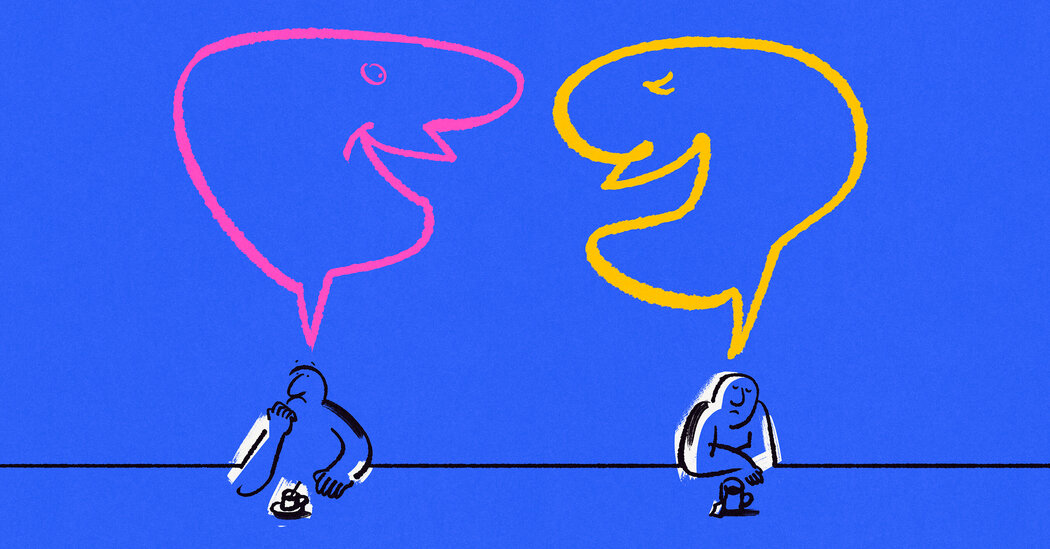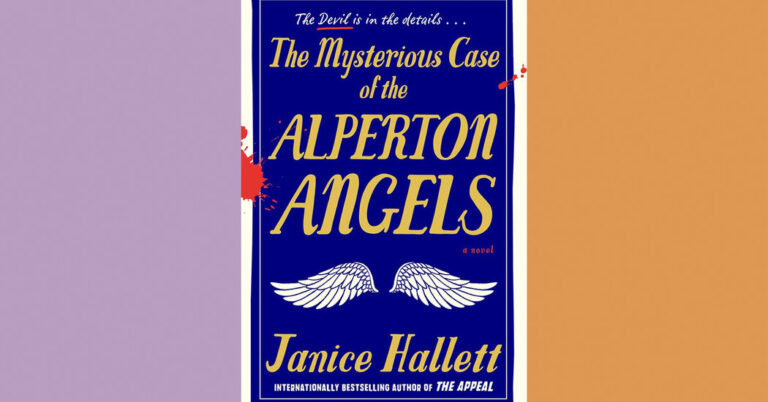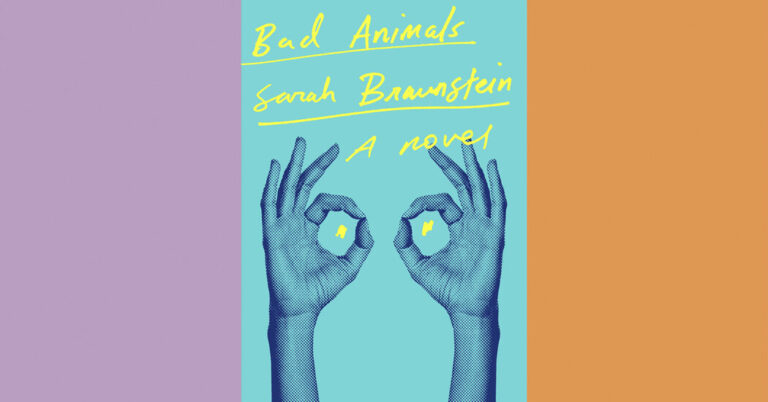Critique de livre : « Encounterism », par Andy Field
Il a été incroyablement facile, n’est-ce pas, de perdre l’habitude d’être avec d’autres humains. Tout ce qu’il a fallu, c’est une pandémie mondiale qui a exigé que nous gardions nos distances les uns des autres et nous a appris à utiliser la technologie pour maintenir cette séparation pendant des mois.
À la maison avec nos écrans, nous n’avons pas encore rebondi après cette perturbation, mais nous n’avons pas encore réadopté de vieilles habitudes comme se rendre au bureau ou regarder des films au multiplex. Si les tendances récentes en matière de mauvais comportement sont une indication, nous n’avons peut-être pas encore réappris l’ensemble des compétences de la coexistence – comme comment ne pas jeter d’objets durs sur les musiciens pendant leurs spectacles en direct, même si cela crée une vidéo accrocheuse.
Dans cet état de choses précaire, « Encounterism : The Neglected Joys of Being in Person », un argument de l’artiste britannique Andy Field pour s’aventurer parmi la population. Pour lui, nos interactions les plus ordinaires sur les trottoirs peuvent être empreintes de « friction et possibilité… anxiété et joie ». Ce sont de petites poches d’opportunités où la compassion pourrait grandir.
« Que perdons-nous lorsque nous cessons d’habiter les rues de nos villes et villages ? il demande. « De quelle compréhension du monde, et de l’autre, nous privons-nous alors que nous passons de moins en moins de temps à proximité de tous ces inconnus et de leurs vies si différentes de la nôtre ?
Dans une note d’auteur, Field dit d’emblée que l’idée de «rencontre» est venue avant la pandémie de coronavirus, pas en réponse à celle-ci, et qu’il a écrit une grande partie du livre pendant «la césure qu’il a créée».
Cela explique en partie pourquoi ses chapitres – des essais, essentiellement – se sentent si souvent piégés dans l’ambre, décrivant des réalités d’un autre temps, comme si aucun paradigme n’avait changé. Cela pourrait également expliquer pourquoi le livre s’appuie si souvent sur des recherches qu’une personne pourrait faire à domicile, bien que sa prémisse suggère à quel point cela peut être un portail limité pour comprendre. (Certes, je suis journaliste et je couvre le théâtre. Je crois qu’il faut se montrer.)
L’écriture la plus vive et la plus puissante de Field canalise les sensations d’immersion physique dans des activités qu’il chérit clairement – comme la danse dans les clubs, qui, selon lui, nourrit l’empathie parmi les étrangers trouvant un rythme collectif dans le noir, ou assis dans une salle de cinéma bondée, naviguant une expérience partagée avec un public qui rit, chut, pleure et hurle : « Nous nous tenons fermement les uns les autres jusqu’au moment où les lumières s’allument, puis nous nous séparons.
Mais le premier chapitre de Field – un hommage voulu aux soins tactiles fournis par les coiffeurs et un clin d’œil à son absence lorsque les salons étaient fermés – se lit comme une performance d’appréciation plutôt que comme l’article authentique. Et un chapitre sur les repas partagés s’efforce de transmettre l’importance des dîners de tous les jours, sans se soucier du désir sacré que ces simples rituels sociaux ont pris au début de la pandémie, lorsque les gens ne pouvaient pas manger ensemble.
C’est la dissonance qui nous traîne à travers le livre, lancinante tout le long. Field fait du théâtre et de l’art de la performance, et il raconte des histoires amusantes sur sa carrière décalée. (L’un implique un étranger, qu’il tentait de nourrir dans le cadre d’une pièce expérimentale, le mordant assez fort pour laisser une ecchymose.) Mais il mentionne à peine ce que cela signifiait pour son travail créatif – si dépendant de près, d’in- la présence d’une personne, et impliquant souvent des déplacements – pour aller à distance.
Ce n’est pas que les souvenirs n’appartiennent pas; c’est que les changements le font aussi, tout comme les idées qu’ils ont apportées. La meilleure partie du chapitre de Field sur les parcs de la ville concerne la communauté qu’il a trouvée dans l’espace vert de Londres où il promène son chien, et à quel point cet endroit est devenu vital pour lui en 2020 et 2021, alors qu’il était souvent interdit aux gens de se rencontrer à l’intérieur.
Même ainsi, Field n’atteint jamais vraiment la valeur fondamentale et tangible d’être présent, corporellement, avec nos semblables. Ce n’est que dans le charmant dernier chapitre, sur le plaisir de se tenir la main, qu’il mentionne très brièvement l’une des privations les plus atroces du début de la pandémie : l’incapacité des gens à être avec leurs proches, se tenant la main sur un lit de mort.
Mais le livre ne rend pas compte du désespoir que tant de gens ressentaient pour le contact en personne : se prendre dans les bras et se toucher ; renifler la tête d’un nouveau bébé; pour évaluer le bien-être de quelqu’un à 360 degrés et en trois dimensions, sans contrainte par le cadre d’un écran vidéo.
Nous avons retrouvé ces joies multisensorielles – mais des formes d’art en personne entières (bonjour, théâtre) sont embourbées dans la crise financière parce que le public qui est revenu est tout simplement trop petit. Un moment aussi fragile réclame un argument férocement persuasif pour s’engager avec le monde en personne, et non à travers nos écrans.
L’épigraphe de « Encounterism », une citation du romancier et essayiste français Georges Perec, concerne la remise en question de « l’habituel ». Mais nos habitudes ne sont plus ce qu’elles étaient il y a seulement quelques années. Il vaut mieux enregistrer ce qui est habituel maintenant et l’examiner.
Laura Collins-Hughes, journaliste indépendante, écrit sur le théâtre pour The Times.