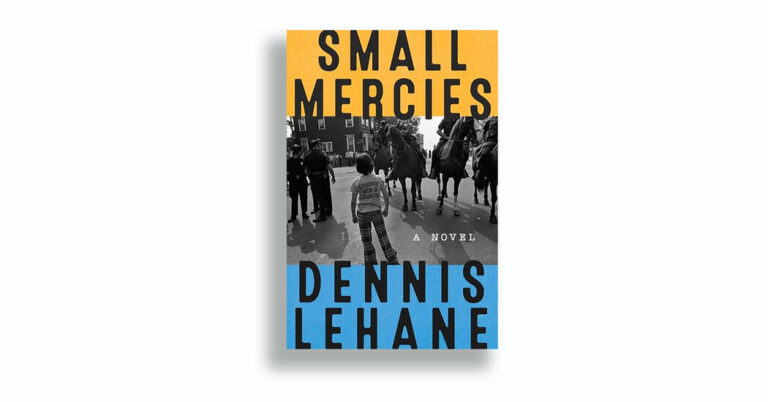Critique de livre : « Le manguier », d'Annabelle Tometich
Lorsque sa mère de 64 ans a été arrêtée en 2015 pour avoir tiré avec un pistolet BB sur le camion de quelqu'un qui, selon elle, avait volé des fruits sur le manguier de sa propriété en Floride, une des collègues d'Annabelle Tometich a appelé pour s'enregistrer.
Parce que Tometich travaillait au News-Press, un quotidien de sa ville natale, Fort Myers, cette collègue avait plus que son bien-être en tête. « Toi avoir écrire quelque chose, hein ? » a-t-elle demandé en s'arrêtant pour répondre à l'appel devant le palais de justice où sa mère, Josefina, venait de comparaître. Mais Tometich connaissait la réponse : une histoire est une histoire, et celle-ci avait une maturité floridienne qu'aucun journaliste local ne pouvait nier.
La loyauté d'un écrivain, Tometich l'a également compris, existe en tension avec sa soif d'histoire, c'est-à-dire son besoin de cohérence, de moyen de contrôle. Le premier non-fiction de Tometich, « The Mango Tree : A Memoir of Fruit, Florida, and Felony », confirme cette tension. En récupérant Josefina des gros titres des photos d'identité judiciaire et des pièges à clics qui ont suivi son arrestation, l'auteur ouvre la porte à quelque chose d'encore plus durable, et peut-être de plus grave : le regard inébranlable d'une fille.
Pour la majeure partie de « Le Manguier », ce regard appartient à Tometich comme à une enfant timide et récessive, une fille dont le désir de « normalité » – un désir dévorant d’appartenance – est engendré par sa famille excentrique et tumultueuse, mais vient à s'étend bien au-delà.
Ce souhait est dans une large mesure le produit de l'identité biraciale de Tometich : Josefina, qui a quitté sa famille aux Philippines pour travailler comme infirmière aux États-Unis, a épousé un Américain blanc privilégié.
Même si tous deux cherchaient à échapper à leur famille d’origine, ils étaient liés à celle-ci de manière opposée : « Papa a vécu la majeure partie de sa vie aux dépens de ses parents », observe Tometich. « Maman a soutenu les siens jusqu'à leur mort. »
Les premiers chapitres sont hantés par la présence de la belle-mère de Josefina, Joséphine, une femme maladive et de plus en plus horrible qui fait référence à Josefina comme, entre autres insultes, à « cette Mongoloïde ».
Utilisant le présent pour transmettre ses perspectives de préadolescente et d'adolescente, Tometich adopte un ton acidulé, un mélange d'intrigues complices et aux yeux écarquillés. Il s’agit d’un narrateur qui remarque que même si sa mère est forte et capable alors que Joséphine est fragile et faible, « Grand-mère est blanche » – et la blancheur implique une plus grande proximité avec le pouvoir, sinon avec la chose elle-même.
En nous gardant proches de la vue d'enfant de sa formidable mère et des tragédies qui frappent leur famille – y compris la mort soudaine et mystérieuse de son père alors que Tometich avait 9 ans – nous obtenons des moments d'humour inattendu et de vérité cinglante.
Elle écrit des scènes et des dialogues avec la précision métronomique d'un journaliste chevronné, ses ledes et ses kickers ayant souvent une orientation sournoise et précoce. « Les funérailles de Tito Gary se situent quelque part entre celles de papa et de grand-mère en termes de fréquentation », commence-t-elle dans un chapitre, après le suicide de son oncle chez eux. Pour le narrateur de 10 ans, cette dernière mort a encore moins de sens que les autres : « Pourquoi voudrait-on quitter l’Amérique ? Nous avons la liberté et la justice pour tous.
Plus tard, lorsque Josefina emmène ses enfants pour leur premier voyage à Manille, l'éloignement initial de Tometich de sa famille élargie – et de leur pauvreté – cède la place à une admiration rampante pour sa mère, qui semble posée et sûre d'elle dans son élément natal, capable de « faites honte à ses frères et sœurs pour qu'ils exécutent ses ordres en inclinant simplement la tête. Contrairement à sa fille, Josefina semble avoir « un endroit où elle est normale. Une maison à laquelle elle appartient.
Parfois, Tometich sort du point de vue de son enfant pour nous faire savoir, par exemple, ce qu'elle pense maintenant des circonstances non résolues entourant la mort de son père. Ces moments sont brefs et deviennent de plus en plus visibles à mesure que l'histoire progresse. Peu de scènes représentent Josefina et sa fille adulte ensemble : nous apprenons d'un seul coup que Tometich n'a pas vu sa mère pendant les six mois entre la fusillade, qui a brisé la lunette arrière du camion du plaignant, et l'audience de détermination de la peine de Josefina.
De plus en plus étrange dans ses habitudes et ses comportements (à un moment donné, Tometich qualifie sa mère de « maniaco-dépressive »), Josefina reste une figure fidèle mais insaisissable, impitoyable face à l'accusation de crime pour laquelle elle a purgé cinq ans de probation.
La revendication par Tometich de la mère dont elle rêvait d'être emprisonnée lorsqu'elle était enfant repose sur un sentiment naissant de sa propre honte intériorisée. « Le système judiciaire ne la considère pas comme une personne à part entière, digne de clémence et de rédemption », écrit Tometich, à la fin du livre, à propos de la dureté de la punition infligée à Josefina. « Et jusqu'à présent, moi non plus. »
Le lecteur réclame à grands cris ce qui a découlé de ce jugement, une histoire encore inédite.