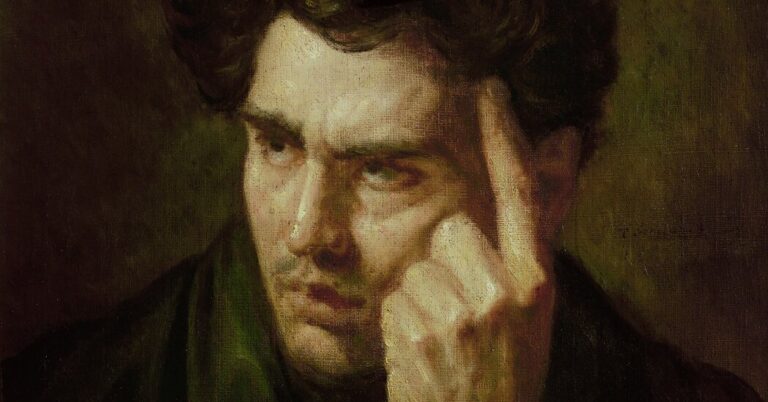Critique de livre : « Dialogue avec un somnambule », de Chloé Aridjis ; « Dearborn », de Ghassan Zeineddine ; « Chaque goutte est le cauchemar d’un homme », de Megan Kamalei Kakimoto
Il y a des moments où les gens ont besoin de guides, de règles, d’un système d’être qui aboutit à des résultats prévisibles, nous laissant satisfaits et indifférents. Le quatrième livre de Chloé Aridjis, , ne s’intéresse pas à un système d’être aussi confortable.
Dès le début, sa classification comme recueil de nouvelles est rendue inutile. Ce travail fabuliste va au-delà de l’expérimental ; c’est simplement une expérience – troublante, monstrueuse et charmante. Le tout est si sauvage et irrévérencieux envers les conventions formelles que ne pas savoir ce qui se passe semble parfaitement normal.
« Faits Divers » est un inventaire des catastrophes, depuis un garçon hospitalisé après s’être envolé d’un carrousel défectueux jusqu’à « une forme agressive de végétation violette frisée » qui, selon les voisins, était responsable de l’étouffement de deux historiens à la retraite. Chaque vignette est indépendante et est presque drôle, comme toute surprise est drôle, même si quelqu’un meurt à la fin. Mais pris ensemble, ils deviennent des pixels dans une image plus large de la vie ordinaire, profonde et ridicule.
Plusieurs ancêtres fabulistes se font entendre tout au long de ces pages (Borges, Calvino), mais un seul apparaît explicitement, dans « La Société Kafka », sorte de lettre d’amour au surréaliste du XXe siècle qui penche vers l’onirisme.
Aussi rassurante que soit cette conscience de la lignée formelle de l’œuvre, dès que le livre établit un sentiment de confort, toutes les règles sont brisées. « Notes sur la Conférence internationale des survivants de la foudre » reprend la forme et l’attitude familières de la fiction flash contemporaine, racontant les histoires de six de ces survivants ; jusqu’à ce qu’il commence à défier toute attente narrative. Un musicien norvégien regarde une foule « dispersée sur la colline » par la foudre, avant que le paragraphe suivant ne divulgue le détail apparemment sans rapport selon lequel il est « sujet à des crises de panique et à des accès de confusion accablants » et « ne va jamais nulle part sans sa mère ». Ces histoires rampent dans des espaces dépourvus de carte, de portes, de voies d’entrée ou de sortie claires, refusant farouchement de s’ancrer dans une quelconque tradition.
Les histoires du premier album de Ghassan Zeineddine, , sont paisibles et domestiques, drôles et sincères. Ils sont également honnêtes quant à la tristesse et à l’épuisement d’essayer de s’assimiler à une culture qui vous rejette perpétuellement. Dans « The Actors of Dearborn », un recenseur et aspirant acteur du quartier majoritairement arabe d’East Dearborn, dans le Michigan, va « hors scénario » et demande aux membres de sa communauté des choses comme : « Êtes-vous heureux dans la vie ? et « Êtes-vous devenu ce que vous avez toujours voulu être? » Pour lui, l’aliénation est étroitement liée à son rêve d’Hollywood ; de tels fantasmes de réussite américaine sont un thème tout au long de la collection.
L’hilarant « Speedoman » met en scène un inconnu à peine vêtu qui rejoint un groupe d’hommes « justes musulmans » se détendant dans un bain à remous. Est-il la star du porno des années 1970 que les hommes pensent (« il était le premier Arabe… que nous avions vu porter un Speedo ») ? Est-il comme un bébé, nouveau dans le monde, indéfini et intact ? Est-il le symbole d’une culture et d’une jeunesse d’outre-océan, perdues dans les mémoires américaines ? Zeineddine oscille (pas toujours de manière fluide) entre les points de vue des hommes et de leurs femmes, témoignant de la « douleur collective » du désir d’une vitalité qui n’est plus accessible.
Suivant certains individus et familles au fil de leur vie, la collection reste préoccupée par le manque de confiance dans les institutions américaines. Dans « Money Chickens », un père fourre des sacs Ziploc de billets dans des poulets dans les années 1980, rendant palpable l’impermanence et même la futilité des devises fortes. « Marseille » est raconté du point de vue d’un fumeur invétéré de 99 ans, né dans un village de montagne au Liban et qui a survécu au voyage du Titanic. Les histoires sont liées par l’histoire, par l’ambition, par le mythe d’une nation qui ne se manifeste jamais mais qui renaît encore et encore sous le regard des immigrants. Les personnages de « Dearborn » sont divisés sur la question de savoir quelle partie de l’Amérique mérite d’être acquise, quelle partie il faut résister et jusqu’où chacun est autorisé à rêver.
L’Hawaï contemporain du premier film de Megan Kamalei Kakimoto, , n’est ni un décor idyllique ni une fable tragique ; les histoires évoquent la terre et ses cultures mélangées dans toute leur anxiété, leur claustrophobie et leur agitation.
Suivant les femmes autochtones et japonaises, ces histoires sont fluides, féminines, tourmentées, hantées et incroyablement excitantes. « Un catalogue de superstitions kanaka, telles que racontées par votre mère » est une liste d’avertissements de trois pages : « Ne dormez pas la tête sous la fenêtre ouverte ! Lorsque le démon vous rendra visite, il passera son couteau dans la fente et vous ouvrira le cou. Et : « N’écrasez pas le mo’o avec votre rubba slippa ! C’est notre ‘aumakua. Tous les proches morts qui ne sont pas morts, confinés dans les membres élastiques et mouillés du gecko domestique. Ça pourrait être le cousin Jerry. En tissant des mots hawaïens avec des mots anglais, Kakimoto positionne la langue comme un lien avec notre moi le plus ancien et le plus éternel.
Dans « Temporary Dwellers », une histoire d’amour entre deux jeunes femmes est à la fois douce et amère – et atteint une fin dramatique. « Je la regarde comme si j’étais capable de la maintenir en place », dit le narrateur, « comme si le silence rendrait notre couplage permanent. »
Kakimoto explore également l’éthique de l’écriture pour un public extérieur à sa communauté natale : elle est japonaise et Kanaka Maoli (native hawaïenne) de Honolulu. Dans « Aiko, l’écrivaine », la protagoniste est une nouvelliste autochtone qui assiste à des panels intitulés comme « L’art du lieu » et qui est « heureuse » d’avoir satisfait aux exhortations de son agent blanc : « Finalement, elle s’est pliée au lecteur. attentes d’un écrivain autochtone. L’histoire se lit comme une autofiction, comme si Kakimoto exprimait toute l’insécurité qui accompagne l’excavation et la marchandisation d’une culture. Qu’est-ce qui est à vendre exactement ici ? Dans quelle mesure cette profession doit-elle vider la psyché pour satisfaire les exigences d’un lecteur blanc ? Combien l’écrivain perdra-t-il pour survivre, pour ne pas être hanté par la communauté même qui l’a fait naître, la communauté qui l’a d’abord connue comme belle ?
Il n’est pas question de ce qui est sacré pour l’auteur. «Every Drop Is a Man’s Nightmare» est riche et sage, fredonnant avec confiance dans la connaissance des manières belles et misérables d’une communauté particulière.