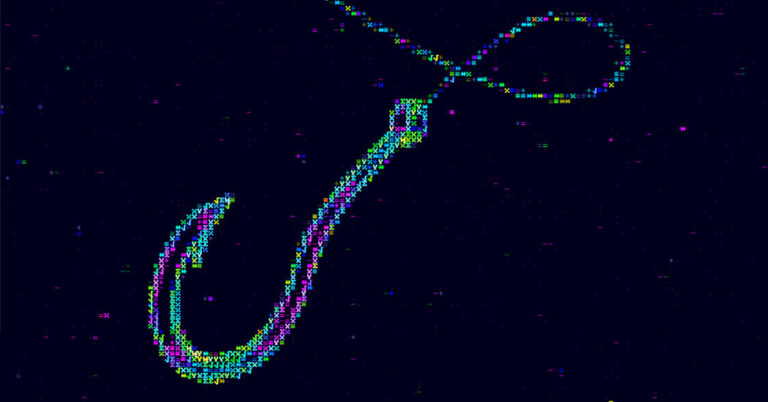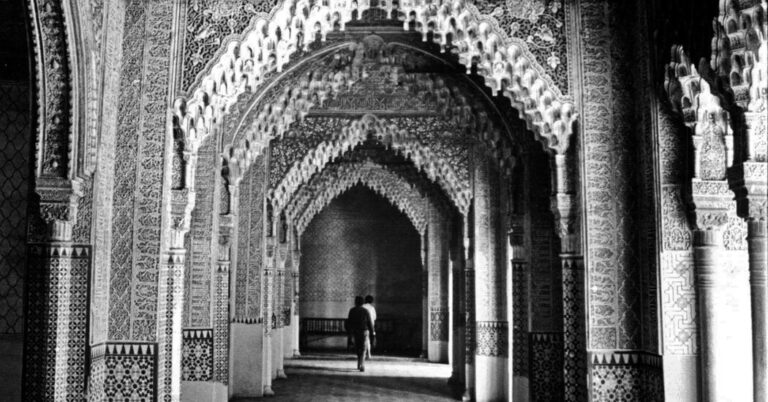Critique de livre : « Côté nuit de la rivière », par Jeanette Winterson ; « La ruche et le miel », de Paul Yoon ; « La fin du monde est un cul de sac », de Louise Kennedy
Pour Jeanette Winterson, les histoires de fantômes ne sont pas démodées ou anachroniques dans le monde moderne, mais à la fois avant-gardistes et primitives. Dans l’introduction de sa nouvelle collection, elle évoque certaines de ses propres expériences inexplicables avec l’étrangeté, du fantôme d’un ami écrivain se matérialisant sur son écran d’ordinateur à la prémonition de son enfance concernant le décès de sa grand-mère. La religion, et plus particulièrement la foi en une vie après la mort, « peut être considérée comme la première start-up perturbatrice de l’humanité », écrit-elle. « Ce qui est perturbé, c’est la mort. »
Toutes les histoires du livre ne sont pas censées faire peur ; certains se réjouissent de la juxtaposition intelligente des tropes fantômes et de la technologie. Dans « Ghost in the Machine », des avatars astucieux d’IA représentent une conscience sans corps, tentant les humains avec la promesse de l’immortalité en échange de crypto-monnaie. Dans l’histoire la plus tendre et la plus lyrique de la collection, « Le pays inconnu », le narrateur décédé tente de joindre son partenaire masculin en deuil via les prévisions de navigation à la radio.
Mais les histoires les plus fortes de Winterson suivent des personnages hantés non seulement par des apparitions, mais aussi par le sectarisme humain et les rôles de genre traditionnels et toxiques. « The Door » se déroule dans un château écossais du XIVe siècle transformé en salle de mariage, habité par les esprits d’un couple queer médiéval qui a été tué par des villageois transphobes. Dans deux histoires liées, « A Fur Coat » et « Boots », un jeune couple d’escrocs escroque un comte pour qu’il les laisse vivre sur son domaine rural pour l’hiver, sans loyer – mais leur « vie simple » romantique est interrompue par le jardinier maussade de la propriété, qui apprend au petit ami à l’intérieur comment chasser le faisan et « garder un œil sur votre femme ». Le jardinier, qui peut ou non être un fantôme, aiguise la haine de Jonny (« C’est une pute », pense-t-il. « Edwin a raison. Edwin est avec lui, sifflant doucement ») jusqu’à un moment culminant de violence. Les fantômes n’ont pratiquement pas besoin d’apparaître, Winterson le sait ; la terreur est déjà présente dans la misogynie des vivants.
À première vue, les sept histoires de la collection mince mais exquise de Paul Yoon semblent sans rapport : un Américain d’origine coréenne du Queens est libéré de prison et se rend dans la ville rurale natale de son ancien compagnon de cellule à la recherche de travail ; une femme qui a fui la Corée du Nord il y a plusieurs décennies a la possibilité d’envoyer un message au fils qu’elle a laissé derrière elle ; un couple d’immigrants coréens qui possède un magasin du coin à Londres planifie des vacances à la mer. Mais chaque récit est une pièce d’un puzzle plus vaste qui, ensemble, forme un portrait de l’histoire coréenne et de sa diaspora d’une ampleur à couper le souffle, détaillant la persistance de l’impérialisme, de la guerre, de la pauvreté et de la dislocation à travers les générations.
Tout au long, Yoon décrit les petits choix qui se répercutent sur la vie de ses personnages – une bagarre dans une cour de prison, un refus d’aider un mystérieux fugitif – avant de tourner son objectif vers l’histoire. Dans l’histoire épistolaire principale, qui se déroule en 1881, un officier de police cosaque en poste dans une colonie coréenne à la frontière russe est témoin de la vengeance brutale d’un homme local contre la femme de son frère, qui a tué son mari après l’avoir violée et battue nuit après nuit. Mais son action n’est pas sans conséquences : un mois plus tard, le narrateur écrit à son oncle : « Presque tous les membres de la colonie ont reçu la visite de ce qu’ils appellent l’apparition. Ce n’est jamais le mari, toujours la femme. Ils la décrivent exactement de la même manière. Une luminosité émouvante. Colère. De la même taille et de la même forme que la pendue.
Dans « À la poste », des soldats japonais du XVIIe siècle au service d’un daimyo de la période Edo finissent par élever un enfant coréen que leur seigneur leur avait demandé de kidnapper au combat alors qu’il était bébé 10 ans plus tôt, « victime de l’invasion de Corée. » L’histoire finale, « Vallée de la Lune », est un chef-d’œuvre de retenue émotionnelle dans laquelle un réfugié de la guerre de Corée retourne dans son village natal du Sud pour démarrer une ferme et accueille deux orphelins qui ignorent son passé meurtrier.
Sillonnant le monde et les siècles, Yoon télescope habilement entre la vue lointaine et le gros plan.
L’injustice et le préjudice, qu’ils soient financiers, interpersonnels ou les deux, menacent la vie des femmes irlandaises de la classe ouvrière dans le dernier film accompli de Louise Kennedy, .
« In Silhouette » passe de la narration à la deuxième personne à la première personne alors qu’une manucure réfléchit à la torture et au meurtre de son frère aîné pendant les troubles 40 ans plus tôt ; dans « Belladonna », une écolière de Belfast apprécie son travail chez un herboriste irlandais jusqu’à ce que le comportement erratique de sa femme et une mystérieuse ecchymose laissent présager des problèmes à venir.
Kennedy sait comment faire monter la tension en révélant des détails. Dans l’histoire principale, une femme abandonnée par son mari, un promoteur immobilier louche, vit de la diminution des réserves d’argent qu’elle a trouvées dans sa commode. Lorsqu’un jeune homme s’intéresse à elle (« Vous êtes la molle du gangster du bas de la colline », dit-il), elle ne parvient pas à savoir où elle l’a déjà vu auparavant, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Lors d’un rendez-vous avec lui, elle se souvient soudain de la fois où son mari a lu quelque chose sur le jeune homme dans un tabloïd local : « Un caïd, rien de moins, avait-il dit en repliant le journal. Le petit équarrisseur est une cheville ouvrière.
Parfois, le poids des fardeaux des personnages menace de submerger une histoire, la faisant sombrer dans le désespoir. « Brittle Things », qui raconte l’histoire d’un couple avec un jeune fils neurodivergent, semble étouffant dans sa description de la honte et du déni des parents. Dans un restaurant, la mère s’inquiète constamment alors qu’elle nourrit son enfant avec des gressins pour le calmer, sentant « les yeux des spectateurs sur elle », écrit Kennedy. « On aurait dit qu’elle dressait un chiot. » Lorsqu’elle cherche en ligne des réponses sur les raisons pour lesquelles son fils n’a pas commencé à parler à 5 ans, son mari grogne : « De nos jours, tout porte une étiquette… ».
Mais le plus souvent, l’esprit drôle et les dialogues précis de Kennedy éclairent avec brio les difficultés de ses personnages. Les amis d’âge moyen de « Au-delà de Carthage » économisent pour des vacances « exotiques » en Tunisie et arrivent, sous des pluies torrentielles, dans « un complexe en béton construit spécialement autour d’une nouvelle marina, aussi propre et sans air qu’un modèle d’architecte ». Incapables de se rendre aux ruines classiques de leurs rêves, ils réservent une visite à ce qu’ils pensent être un spa local, mais qui s’avère être « un bordel glorifié, avec une clientèle de femmes désespérées… qui se sont retrouvées célibataires à un âge où rien que ça les rendait ridicules », pense Thérèse. « Elle et Noreen s’intégraient parfaitement. »