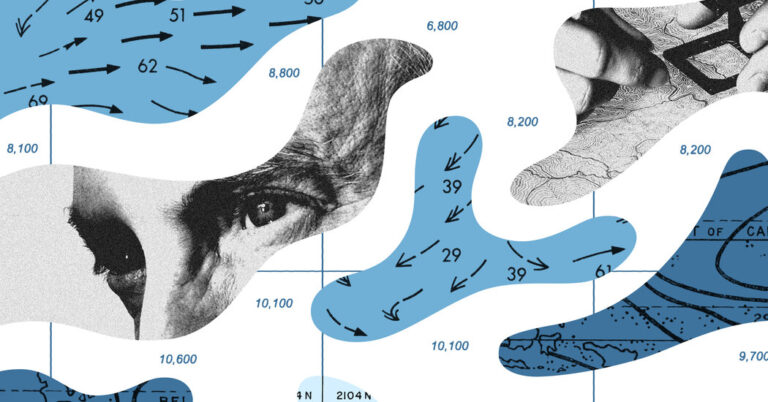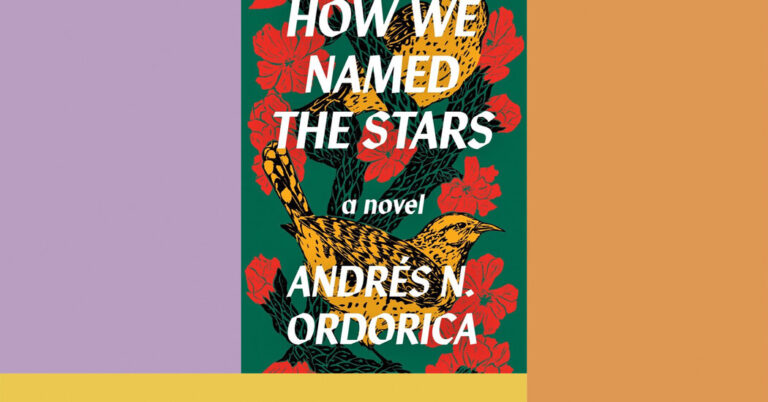Critique de livre : « Apprivoiser la rue », de Diana B. Henriques, et « Le problème des Douze », de John Coates
« Les dirigeants de l’échange des biens de l’humanité ont échoué, à cause de leur propre entêtement et de leur propre incompétence », a déclaré le président Franklin D. Roosevelt lors de sa première investiture en 1933, alors qu’il lançait son New Deal. « Les changeurs de monnaie ont fui leurs sièges élevés dans le temple de notre civilisation. Nous pouvons maintenant restaurer ce temple aux vérités anciennes.
La référence directe à Matthieu 21 et à l’implication de FDR selon laquelle il allait faire l’œuvre du Seigneur en nettoyant le temple de l’impiété était délibérée. Les États-Unis traversaient la phase la plus virulente de la Grande Dépression. La clé du New Deal était la réglementation visant à faire en sorte que la finance américaine travaille pour le peuple et l’économie, plutôt que pour les ploutocrates. Une majorité écrasante à la Chambre et au Sénat a soutenu Roosevelt dans cette croisade. Ce que lui et son équipe proposaient, le Congrès l’adopterait.
Cela ne veut pas dire que c’était facile. Dans « Taming the Street », la journaliste financière chevronnée Diana B. Henriques raconte l’histoire extraordinaire de la manière dont la régulation financière du New Deal a été mise en œuvre. Il s’agissait en effet d’un exploit de nettoyer les temples en chassant les changeurs de monnaie. La loi Glass-Steagall de 1933 séparait les banquiers d’investissement des institutions détenant des dépôts bancaires ; la loi bancaire de 1935 a renforcé l’indépendance de la Réserve fédérale en retirant le secrétaire au Trésor du siège de la présidence.
Le système créé par le New Deal était censé être impersonnel dans le sens où aucun pouce levé ou baissé d’un seul individu ne pouvait faire ou défaire votre entreprise. En théorie, vous auriez toujours une gamme de contreparties, et si une offre ne vous plaisait pas, vous pourriez descendre à Wall Street ou remonter Park Avenue et trouver quelqu’un d’autre disposé à vous offrir des conditions presque aussi bonnes, voire meilleures.
L’idée était que personne ne devrait se retrouver dans la situation où le magnat des affaires de Chicago Samuel Insull et son réseau de services publics, certes surendetté, se sont retrouvés au début des années 1930, lorsque JP Morgan Jr. avait offert à Insull un prêt d’extorsion pour sauver son réseau stressé par la dépression. s’effondrer et a fait clairement comprendre aux autres financiers qu’il considérerait cela comme extrêmement hostile s’ils proposaient à Insull une autre issue.
Le récit d’Henriques regorge d’instruments et d’institutions financières complexes. Elle a transpiré des litres de sang pour le rendre lisible et a réussi à donner vie à ses personnages.
Nous entendons parler de Ferdinand Pecora, l’avocat d’origine sicilienne avec « un pompadour noir frisé distinctif » qui a dénoncé la corruption et la fraude de l’ancien système lors d’une série d’audiences dramatiques au Sénat. Ses conclusions ont inspiré les réformes mises en place par l’administration Roosevelt. Grâce à un interrogatoire rigoureux et à l’utilisation judicieuse de son pouvoir d’assignation à comparaître, Pecora a découvert la manière dont Morgan et ses amis de la finance invitaient les banquiers et les politiciens à acheter des titres à des prix réduits avec la promesse de les trouver, comme l’a dit un responsable du Parti démocrate dans une lettre que Pecora a déterrée. , «des opportunités pour moi de rendre la pareille».
Le New Deal serait un système impersonnel et équitable. Personne ne découvrirait que sa vie était contrôlée par la décision d’un financier situé à 800 milles de là. Au lieu de cela, il n’y aurait que des prix de marché transmettant les pénuries de ressources et des estimations de la demande et de la rentabilité futures que tous pourraient voir et que tous pourraient décider d’investir ou de ne pas investir.
Ces réformes ont globalement fonctionné. Les cours des actions ont une fois de plus servi d’indicateurs, même s’ils ne sont pas parfaits, des entreprises qui seraient rentables et qui, espérons-le, serviraient donc le bien public.
Pourtant, dans les années 1970, les gens ont commencé à considérer l’économie américaine comme dominée par les grandes entreprises qui avaient le plus d’expérience dans l’utilisation des leviers réglementaires. Les législateurs ont cherché à utiliser la destruction créatrice du marché pour rendre les choses à nouveau plus mobiles. Pour beaucoup – moi y compris – les risques liés à un assouplissement du système semblaient faibles : la Réserve fédérale se sentait suffisamment puissante pour construire un pare-feu pour maintenir le chaos financier à distance.
Petit à petit, les intérêts financiers se concentrent à nouveau. Au XXIe siècle, les anciennes fiducies semblent être de retour, mais sous un aspect différent. C’est une histoire bien plus compliquée et moins sexy à raconter. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à ce que l’économiste de Harvard, John Coates, appelle « le problème des douze ». Le livre de Coates, une extension d’un article scientifique de 2018, n’identifie que huit problèmes : les quatre géants des fonds indiciels – Vanguard, Fidelity, State Street, BlackRock ; et les quatre géants du capital-investissement – Apollo, Blackstone, Carlyle, KKR Alors pourquoi 12 ? Ce n’est pas clair. Peut-être devrions-nous ajouter les quatre banques qui pèsent des milliards de dollars : JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Cela fait 12.
Il y a une vingtaine d’années, les financiers de Vanguard et Fidelity ont convaincu toute une génération de professionnels de la classe moyenne que les fonds indiciels – dans lesquels des millions de petits investisseurs particuliers placent effectivement leur argent dans de minuscules centaines d’actions – constituaient une solution sûre et conviviale. moyen de gagner de l’argent grâce à la bonne fortune de l’économie dans son ensemble. Ils avaient globalement raison.
Puis les fonds ont augmenté. Comme le note Coates, les actions que les quatre géants des fonds détiennent pour leurs investisseurs représentent aujourd’hui environ un cinquième des actions des entreprises américaines. Cela les rend très puissants, d’autant plus que peu de clients de fonds indiciels réfléchissent aux conséquences sur l’entreprise des décisions prises par les gestionnaires de fonds. Sans sensibilisation du public, les politiciens sont peu incités à agir. Selon Coates, le pouvoir sans responsabilité est toujours dangereux. Et il a raison.
« Nous n’avons plus une économie contrôlée par des milliers de dirigeants de milliers d’entreprises publiques, tenues sous contrôle par un ensemble d’institutions de gouvernance dispersées », écrit Coates. Au lieu de cela, nous avons une règle par fonds indiciel. En 2021, lorsque Larry Fink, PDG de BlackRock, un fonds de 10 000 milliards de dollars, a laissé entendre qu’il s’attendait à ce que les entreprises dans lesquelles son entreprise avait investi passent au vert dans un avenir proche, cela a aidé trois dirigeants respectueux de l’environnement à remporter des sièges au conseil d’administration d’Exxon. Mobil. Personnellement, j’approuve cette utilisation du pouvoir de Fink ; nous sommes en retard d’une génération pour faire face au réchauffement climatique. Pourtant, contrôler l’influence individuelle illimitée des grandes institutions financières telles que BlackRock était au cœur du New Deal de FDR.
Les économistes craignent également que l’influence écrasante des fonds indiciels n’étouffe la concurrence sur les prix. Il n’est pas nécessaire que les membres du conseil d’administration d’un fonds siègent à de nombreux conseils d’administration dans un secteur où il est le plus grand actionnaire des PDG de, par exemple, United Airlines et Delta, pour se mettre en tête que la concurrence sur les routes pourrait faire baisser les prix. et donc la valeur des actions et que cela pourrait provoquer une instabilité indésirable pour le fonds dans son ensemble.
Il ne faut pas exagérer : aucun des 12, même dans leur domaine particulier, même pris ensemble, n’a la portée et le pouvoir que la maison Morgan détenait sur l’économie américaine il y a un siècle ou plus. Et pourtant, il est indéniable qu’il existe désormais un nombre inconfortablement restreint d’acteurs d’une taille inconfortable dans les branches de la gestion de fonds et du capital-investissement de la finance américaine, en plus de nos très grandes banques trop grandes pour faire faillite.
J’ai été déçu à la fin du livre de Coates, lorsque j’ai commencé à penser que j’allais comprendre le message « ce que je pense que nous devrions faire ». Les idées sur les codes de gestion et les solutions antitrust ne sont pas complètement élaborées – et elles ne peuvent d’ailleurs pas l’être dans un petit livre. Je comprends que Coates estime qu’il se situe au début d’un processus de réforme, que son rôle est d’entamer un dialogue. Mon reproche ne concerne donc pas vraiment Coates, mais le monde : nous comprenons beaucoup moins que nous ne le devrions les changeurs d’argent d’aujourd’hui, qui font leurs affaires dans la cour du temple.