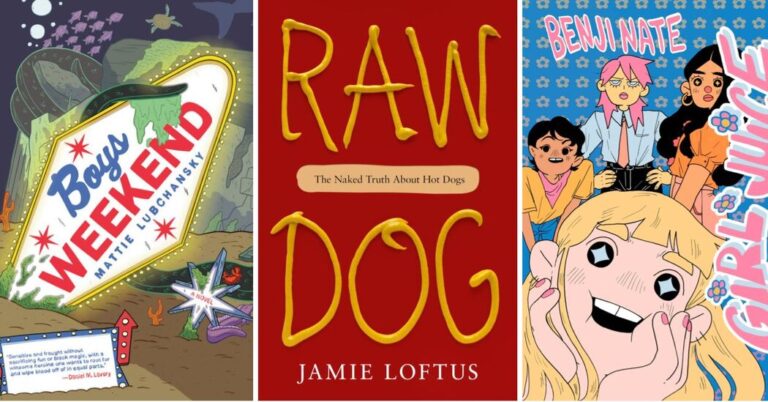Critique de livre : 4 nouveaux premiers romans
Et si tu n'étais qu'un désir monstrueux ? Hanna Johansson considère cette question avec charnalité et ruse. Le narrateur anonyme est un journaliste d'une trentaine d'années qui revient sur ses vacances d'été torrides sur l'île grecque de Syros. Helena, une riche artiste âgée, a invité le narrateur à rester indéfiniment avec elle et sa fille adolescente tranquille, Olga. Le trio établit rapidement une idylle domestique de natation, de cuisine et de vin. Le narrateur braque les projecteurs de son obsession sur Helena, qui, nous le savons, est habituée au culte des héros. Les projecteurs finiront par se tourner vers Olga.
Notre narratrice considère l’affection comme une somme nulle et sa propre identité comme minime, voire absente. Elle préfère traverser la vie plutôt que d'en faire l'expérience. La voici sur une relation passée : « Je voulais immédiatement, le plus tôt possible, arriver au point où nous aurions l'impression que nous nous connaissons depuis toujours, comme si les frontières entre nous étaient floues, idéalement effacées, de sorte qu’il serait impossible de la représenter sans me représenter en même temps. Les invocations répétées de l'horizon laissent entrevoir les lignes qu'elle franchira avec Olga. Pour Johansson, ardeur et déni se renforcent mutuellement. Le temps produit de la nostalgie, pas de la sagesse.
L'éditeur vérifie consciencieusement le nom de « Lolita » dans le matériel promotionnel du livre. Si Johansson est aussi mordante et hypnotique que Nabokov, elle préfère la retenue à la pyrotechnie. (Le mérite revient également à l'habile traduction du suédois de Kira Josefsson.) C'est un roman à savourer et avec lequel discuter. Le narrateur est-il un parasite ? Un prédateur? Simplement quelqu'un dont la portée émotionnelle dépassait sa portée ? J'en suis venu à considérer « l'Antiquité » comme un polaroïd de l'océan la nuit, un abîme profond, une menace intime.
Un morceau d'histoire fascinant alimente l'ouvrage de Julia Malye. En France, au début du XVIIIe siècle, l'Église catholique a envoyé des centaines de jeunes femmes marginalisées sur le territoire de la Louisiane pour épouser des colons célibataires et engendrer une nouvelle génération. Celles qui ne parvenaient pas à trouver de mari ou qui étaient veuves jeunes rejoignaient le couvent pour prêcher aux peuples autochtones, avec lesquels les colons partageaient une fragile détente.
Geneviève, Pétronille et Charlotte survivent de justesse au voyage transatlantique, rencontrant pirates, maladies et viols ; cette brutalité continue dans le Nouveau Monde. Le roman consacre également des chapitres à une religieuse parisienne et à un jeune de 17 ans membre de la tribu Natchez, et s'étend sur un peu plus d'une douzaine d'années.
Malye ne s'intéresse pas aux stations d'un bildungsroman. Elle se concentre plutôt sur des moments fugitifs de solitude. Les personnages regardent fréquemment par la fenêtre, revisitant des souvenirs d'excitation et d'action dans leur existence autrement circonscrite.
L’auteure a déjà publié trois romans en français – le premier à 16 ans – et ses pages regorgent de recherches. La flore, la faune, la météo et les rituels sont méticuleusement catalogués. Mais cette assiduité, outre la mise à distance du regard à la troisième personne, réduit les personnages. Le casting occupé se confond ; les changements cruciaux se produisent principalement hors écran. Pire encore, les attitudes anachroniques et progressistes des personnages centraux – envers l’avortement, l’esclavage et le colonialisme – mettent à rude épreuve la crédulité, puis la brisent. Hilary Mantel a déclaré que la valeur de la fiction historique réside dans « ses contradictions et sa maladresse. … Et permettre au lecteur de vivre avec les ambiguïtés. « Pelican Girls » ne nous accorde pas ce respect. Ses angoisses engloutissent son objectif.
Scott Alexander Howard propose une vision hallucinante du voyage dans le temps. Dans un paisible village francophone lié par la tradition et la bureaucratie, l'adolescente Odile Ozanne suit une formation pour devenir conseillère, membre d'un groupe restreint qui approuve les visites surveillées dans les vallées environnantes. Leurs frontières sont fortement surveillées, et on comprend vite pourquoi. À l'ouest se trouve une réplique du village vivant il y a 20 ans ; à l'est, dans 20 ans. Les parents en deuil peuvent voyager vers l'ouest pour apercevoir un enfant décédé dans leur présent, mais ils doivent porter des déguisements pour ne pas altérer le temps (et la vie à l'est). Un jour, Odile croit reconnaître deux visiteurs de sa propre vallée. Ce moment aura des conséquences durables.
Alors que les premiers chapitres sont trop proches de « The Giver » de Lois Lowry, le ton passe à un thriller philosophique lent lorsqu'Odile atteint l'âge adulte. Elle est confrontée à un évadé de l'Est, ce qui perturbe le passé et l'avenir d'Odile.
La fin fait un clin d'œil au film « La Jetée » de Chris Marker et, comme tant d'histoires de voyage dans le temps, la vanité exerce une lourde gravité. Ce lecteur a failli briser le tableau blanc : N'y aurait-il pas des migrations plus clandestines, compte tenu de la vénalité caricaturale de certaines patrouilles frontalières ? Oubliez l'intrigue. L'impression durable du roman ne réside pas dans ses idées, mais dans la richesse du paysage. Howard a un don de naturaliste pour la pastorale.
Le titre de Scott Guild's fait référence à la composition physique des figurines qui peuplent son monde – appelez-la George Saunders Barbie – ainsi qu'à une approche souple de la narration. Cela dit la vérité de manière très, très biaisée. Nous avons Erin, une jeune femme dont la sœur radicalisée a disparu, et Jacob, un adolescent aveugle qui passe une grande partie de son temps dans l'espace VR. Ils se rencontrent, pour ainsi dire, au magasin de vente au détail d'Erin, au milieu d'une fusillade de masse perpétrée par un groupe éco-terroriste.
Ce récit est entrelacé d’épisodes de « Nuclear Family », une sitcom mettant en vedette des robots parlants, un Jésus-Christ de la taille d’un jouet et des gaufres anthropomorphisées à taille humaine. Son nom, dans un roman plein de jeux de mots, fait allusion à une détonation atomique sur le sol américain il y a une génération. Comme si cela ne suffisait pas, les scènes d'Erin sont décrites à travers des plans de caméra, des monologues et même des numéros musicaux. Le dialogue est contracté à un anglais pidgin. (« Pas besoin de s'excuser. C'est une journée horrible. ») La guilde s'engage.
Ce cadre élaboré présente quelques fissures. Des marques inventées comme Tablet Town coexistent avec des références à Stephen Sondheim, Prada et Brad Pitt. (À quoi ressemblerait « Sweeney Todd » dans ce monde ?) Le dernier tiers s'appuie sur un genre hollywoodien trop facile pour les talents de Guild, même si nous terminons dans une merveilleuse incrédulité.
L’audace WTF soutenue du roman mérite des applaudissements. Si sa dette envers David Foster Wallace est évidente – et peut-être trop pour certains – « Plastic » mérite également des comparaisons avec les œuvres de Tom McCarthy, Kazuo Ishiguro et même Bertolt Brecht. Son monde rigoureusement superficiel parvient à soulever avec une grande intelligence des questions urgentes sur le changement climatique, la violence politique et la spiritualité.