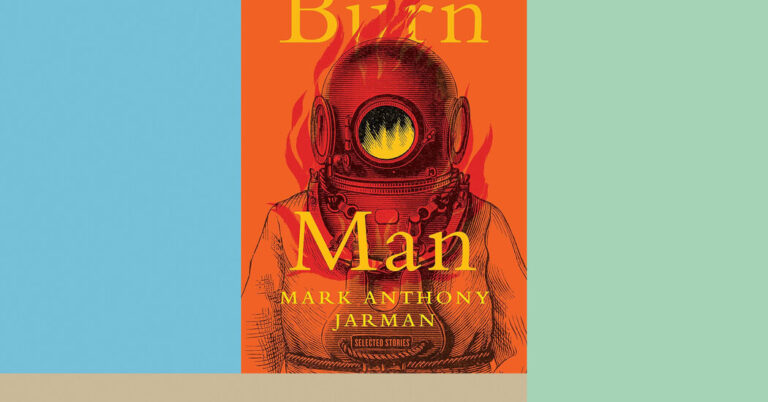Critique de livre : « 1974 », de Francine Prose
Francine Prose s'est mariée jeune, lors de son dernier semestre à Radcliffe. Le mariage était imparfait et elle et son mari en ont tous deux souffert. Le vent culturel soufflait contre eux. La bonne musique sortant de l’autoradio n’a été d’aucune aide. « La musique que nous aimions était devenue un reproche, un rappel : quelqu'un est amoureux, mais ce n'est pas vous, et vous ne ressentirez plus jamais cela », écrit Prose dans ses nouveaux mémoires, « 1974 : A Personal ». Histoire. »
La monogamie, ajoute-t-elle, « semblait embarrassante, désespérément carrée et démodée. La culture encourageait, attendait et insistait pratiquement sur l’agitation érotique. Le sexe était gratuit ; le sexe était partout, une source d’émerveillement, de plaisir et de chaleur sans l’effet effrayant de la familiarité et de la répétition.
Au bout de trois ans, elle divorça. En 1974, alors qu’elle avait 26 ans, elle passait plus de temps à San Francisco et moins de temps à Cambridge, où elle avait fait ses études supérieures. Dans l’ouest, elle se sentait libre et vivante (elle était une fan de Joni Mitchell). Elle vivait avec un couple bohème de personnes âgées. Ils existaient tous avec du bon café et des « sandwichs à l'avocat sur du pain au levain de San Francisco avec de la mayonnaise, du poivre noir et des pousses de luzerne ».
Cette année-là, lors d'une partie de poker dans l'appartement, elle rencontre Tony Russo. Avec Daniel Ellsberg, Russo a divulgué les Pentagon Papers, qui ont mis à nu la perfidie américaine au Vietnam. Publiés dans le New York Times en 1971, les journaux, dans le résumé de Prose, « confirmèrent ce que le mouvement anti-guerre n'avait jamais pu prouver : notre présence au Vietnam n'était pas souhaitée. Nous avions commis des crimes de guerre.
Russo était un héros de la contre-culture et de la liberté d'expression. Il avait passé 47 jours en prison pour avoir refusé de témoigner contre Ellsberg. Il a travaillé pour la NASA et plus tard pour la RAND Corporation, où il a participé à une étude sur la manière dont les prisonniers vietcongs étaient interrogés, et certaines de leurs histoires l'ont profondément ému. Au moment où Prose l'a rencontré, il était paranoïaque et au chômage. « Une aura de malaise l'entourait », écrit Prose, « le léger bourdonnement pénible d'un panneau électrique avec un fusible grillé et des fils débranchés. »
Russo était cependant charismatique, un charmeur né en Virginie avec un accent du Sud. La prose avait un faible pour les mauvais garçons. Voici la royauté anti-guerre. Il avait 10 ans de plus. Peu de temps après, ils se promenaient dans sa vieille Buick couleur mastic et discutaient toute la nuit, pendant qu'il fumait des Camels à la chaîne.
Était-ce une histoire d'amour ? Pas assez. Le sexe était minime et gênant. Mais il y avait quelque chose entre eux, ne serait-ce que brièvement, et ce quelque chose fait partie des principaux sujets de ce mémoire, qui, malgré ses éclairs de perspicacité et ses nombreux éclairs de bonne écriture, reste tiède et distant. Ils ne se connaissaient pas très bien. Prose consacre néanmoins une grande partie de ses mémoires à Russo et ressasse les problèmes bien connus entourant les Pentagon Papers eux-mêmes. Russo explique son passé dans de longs monologues.
Il y a plus ici. Prose est en train de découvrir qui elle était en 1974, avant de rentrer chez elle à New York l'année suivante. Elle écrit avec perspicacité : « L’un des dangers d’écrire sur soi-même est que vous pourriez apprendre des choses sur vous-même que vous ne voulez pas savoir. »
D'un côté, Prose fuyait une dépression nerveuse qu'elle avait eue à Cambridge. Elle était devenue agoraphobe, incapable de quitter son appartement. Elle était fragile. Même les orages menaçaient sa santé mentale. Elle passait beaucoup de temps à consulter le I Ching. « Je n'avais absolument aucune idée de ma place dans l'univers ni de ce que j'allais faire », écrit-elle. Dans sa fuite vers l'ouest, elle ressemblait à une Charlotte Perkins Gilman des derniers jours, qui a quitté la Nouvelle-Angleterre pour s'installer à Pasadena pour se remettre de la dépression post-partum qu'elle a décrite dans « Le papier peint jaune » (1892).
D’un autre côté, Prose semble avoir été l’une des plus grandes surperformantes de son époque. Elle a eu une éducation choyée. Ses deux parents étaient médecins. En 1974, elle avait publié deux des romans bien reçus et travaillait sur son troisième. Elle avait beaucoup voyagé à l'étranger et avait passé du temps à écrire dans un appartement à Bombay avec vue sur la mer d'Oman. Elle avait de nombreux amis éloignés chez qui elle pouvait rendre visite.
La prose a catastrophisé la bonne nouvelle. Voici sa réaction lorsqu'un éditeur l'a appelé pour lui dire qu'il souhaitait publier son premier roman :
D'abord, je n'ai pas compris ce qu'il disait ; alors je n'y croyais pas. Je m'appuyai contre un mur et attrapai le dossier d'une chaise. Je me voyais tomber. J'ai vu des membres cassés. J'ai vu des béquilles, j'ai vu une punition pour la bonne fortune au-delà de tout ce que je méritais.
Je me demande comment elle a réagi lorsque son roman « Blue Angel » (2000) a été nommé finaliste du National Book Award.
Si ce mémoire de crise d'un quart de vie était un tabouret, la troisième étape – après l'histoire de Russo et celle de Prose – serait la tentative de l'auteur de dresser un portrait de groupe de sa génération, non pas des baby-boomers au sens large, mais d'un sous-ensemble sophistiqué d'entre eux. Ce matériau est le moins réussi. Une bonne partie de l’histoire culturelle et politique fatiguée est diffusée à nouveau, à la manière des cases à cocher de « We Didn’t Start the Fire » de Billy Joel. Il existe de nombreuses phrases de l’ordre de « nous étions très jeunes et très excités » et « nous croyions que l’amour était l’émotion la plus forte ».
Il y a juste assez de décors mémorables pour garder le lecteur en haleine. Dans l'un d'eux, Prose rencontre les Cockettes, la troupe de théâtre qui s'écarte du genre, dans une épicerie de San Francisco. Il y avait là « une demi-douzaine de drag queens, avec une barbe épaisse, des boas de plumes, des poils sur la poitrine et des robes de satin », écrit-elle. « Ils sautaient comme des papillons, mais plus fort, maximisant le drame de mettre des sacs de bonbons au maïs de taille familiale dans leurs paniers. »
Elle poursuit : « Quelles que soient ces créatures merveilleuses, elles ne ressemblaient à personne dans le département d’anglais de Harvard. Je me suis sentie éblouie, comme Dorothy quittant le Kansas en noir et blanc pour un monde redécoré dans les pastels arc-en-ciel des céréales du petit-déjeuner des enfants.
La ville grise et fraîche de l’amour pourrait toujours, en un instant, s’éclairer.