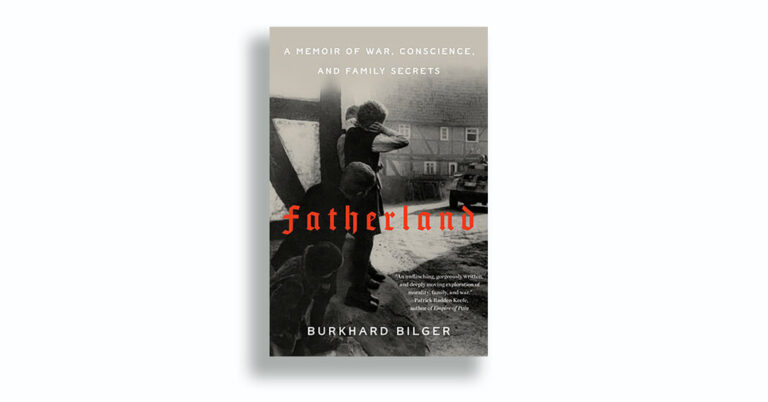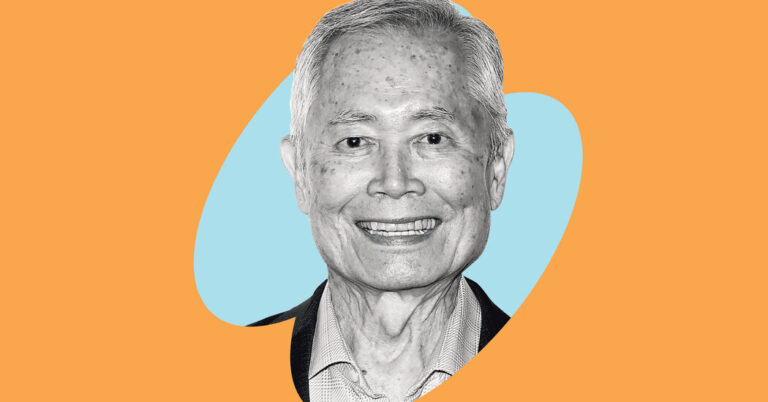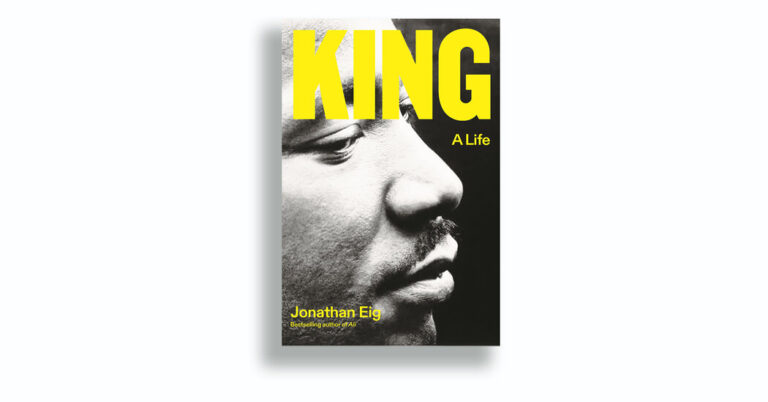Nouveaux romans graphiques – The New York Times
Dans quatre nouveaux romans graphiques, le monde change et nos héros opèrent leurs propres changements.
Vers le début de « Wally’s Gang », l’histoire dont la majeure partie est éditée par Keith Mayerson et Chris Byrne, un personnage, George, se fait prendre en flagrant délit par un homme qu’il dessine en caricature. Heureusement, le sujet de cette photo peu flatteuse s’avère être un rédacteur en chef de journal ravi de découvrir un nouveau talent aussi prometteur. Dans le contexte de l’histoire, c’est un moment amusant. Dans le contexte de la publication du livre, c’est étrangement dévastateur.
Johnson, à plusieurs reprises commis à l’expédition, musicien itinérant et alcoolique à plein temps, n’a jamais publié de bande dessinée de sa vie, du moins à notre connaissance. Mais il travaillait déjà dur sur le tome 91 de la saga « Wally’s Gang » en 1928, alors qu’il avait 16 ans, soit sept ans avant la première bande dessinée moderne.
Johnson a déjà été salué comme un excellent artiste. Parmi ses œuvres survivantes, 25 cahiers de composition ont été exposés à l’Outsider Art Fair 2017, où la critique du New York Times, Roberta Smith, a noté « le crayonnage robuste et un air cumulatif d’obsession ». Cette obsession a fait de lui un chroniqueur fascinant et dévoué de la vie du milieu du XXe siècle ; dans ce gros omnibus, les bribes d’un mode de vie révolu s’accumulent en quelque chose de triste, d’étrange et d’énorme.
La grammaire visuelle et la comédie situationnelle de « Wally’s Gang » sont typiques des vieilles bandes dessinées « Bringing Up Father » et « Blondie », tandis que les ivrognes déprimés de « The Bowser Boys » évoquent l’humour d’observation sinistre et le journal astucieux. tropes comiques de héros underground ultérieurs comme R. Crumb et S. Clay Wilson. Et au moins aussi intéressantes sont les introductions de Byrne et Mayerson, relatant la création de l’œuvre et son voyage hors de l’obscurité.
Le dessinateur allemand Nino Bulling, étonnamment assuré, est leur première œuvre de fiction, mais il parvient à insérer tellement de choses si adroitement dans si peu de pages que cela semble difficilement possible. Dans un magnifique travail au pinceau noir, blanc et rouge, Bulling raconte l’histoire d’Ingken, un jeune Berlinois ambivalent qui ne sait pas s’il doit entamer chirurgicalement la transition d’un corps de femme à celui d’un homme.
Tout autour d’eux, la Terre semble vivre une agonie similaire – une sorte de dysphorie planétaire qui semble également insoutenable et tout aussi difficile à remédier. Le partenaire d’Ingken aime le monde naturel, et les dessins de fleurs et d’insectes de Bulling dégagent une tristesse palpable : la présence de la beauté, d’une manière ou d’une autre, ne fait qu’empirer les choses. L’ironie est soulignée par la facilité de Bulling avec l’encre ; leurs dessins au trait représentant de belles personnes lors de raves et de fêtes ont une sorte de simplicité picassoid exagérée.
Tout ce qui se passe dans la vie d’Ingken semble commenter ces états de détresse simultanés et faire comprendre le coût de la transition. Certaines choses sont trop difficiles, d’autres sont nécessaires, et parfois ce sont les mêmes choses.
Nate Powell commence comme une ode nostalgique à la vie en tournée d’un groupe punk sans le sou des années 1990 – Powell a joué dans Soophie Nun Squad, entre autres – et atterrit dans un territoire bien plus étrange. C’est peut-être une histoire de fantômes, peut-être une histoire fantastique, mais c’est rafraîchissant et oblique. « Combien de fois es-tu venu ici ? » notre héros, Jody, demande à la mystérieuse chanteuse de son groupe, Diana. «Je… je… ne sais même pas comment répondre à ça», répond-elle. « C’est comme si nous avions toujours été ici. »
Powell donne vie à l’esthétique punk de manière subtile et manifeste : les légendes sont griffonnées sur les frettes de guitare et dans des nuages de fumée ; les gribouillages étranges deviennent des logos irréguliers, voire des mots. Il n’y a littéralement aucune couleur dans la vie de Jody, jusqu’à ce qu’elle commence à rencontrer ses futurs camarades du groupe, mais la chanson emblématique du groupe s’avère avoir un effet étrange, peut-être même surnaturel, sur le public. Et lorsque Powell dessine leurs performances, les images sont rehaussées et stylisées, pour mieux transmettre ce frisson si essentiel à l’art punk, rock ou autre.
Miss Truesdale, de , est l’une des créations les plus charmantes à remplir la vaste bibliothèque d’histoires pulp spirituellement sérieuses de Mike Mignola. Avec l’artiste Jesse Lonergan, Mignola (dont il dessine habituellement lui-même la création principale, Hellboy) tisse un fil qui partage son temps entre le Londres victorien caché et sexiste de Truesdale et Hyperborée, la terre du mythe grec antique où son alter ego brandissant une hache se débat. avec l’oppression plus directement.
Mignola aime généralement mélanger des faits étranges et des fictions étranges – ses histoires de Hellboy intègrent souvent les malheurs de saints obscurs et la cosmologie de HP Lovecraft – et ici, son héroïne est en partie Conan le barbare, en partie un théosophe fervent.
Mais si le mélange de spécificité historique et de fantaisie pulpeuse semble un peu lourd, son exécution est tout sauf. Les plumes épaisses et les couleurs agréablement marbrées de Lonergan se déplacent facilement entre les paramètres contrastés du livre. Même après s’être attardé sur des pages muettes de combat de gladiateurs ou d’une barge funéraire flottant sur une rivière, toute l’affaire se termine trop tôt.