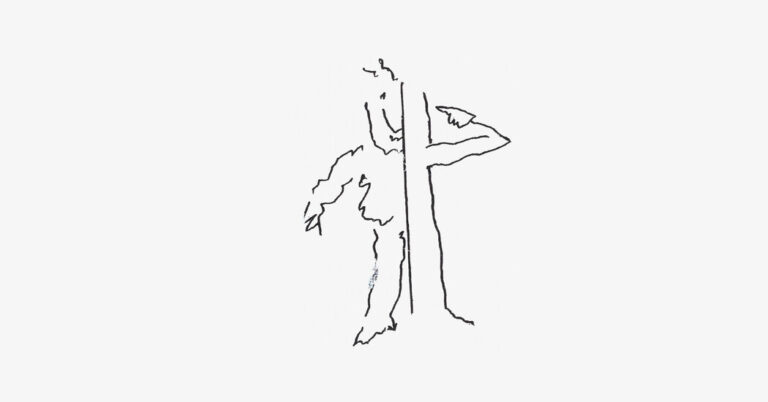L'héritage de Keith Haring est au centre commercial, pas au musée
Vers la fin de « Radiant : The Life and Line of Keith Haring », la nouvelle biographie exhaustive de Brad Gooch, il cite un article de journal rédigé par Haring après avoir visité le Museum of Modern Art en 1988, exprimant son « sentiment d'injustice » que ses contemporains » étaient représentés à l'étage dans les galeries, alors qu'il était confiné dans la boutique de cadeaux du hall : « Ils n'ont même pas encore montré une de mes pièces. À leurs yeux, je n’existe pas.
La frustration de Haring est sûrement surprenante pour quiconque connaît son travail, c'est-à-dire pour la plupart tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être capable de nommer une photo de Keith Haring pour la reconnaître ; sa ligne vibrante et sa palette électrique s'annoncent aussi efficacement qu'une enseigne au néon. C'était vrai en 1988, époque à laquelle Haring avait réalisé plus de 50 peintures murales à travers le monde, en grande partie pour des hôpitaux et des œuvres caritatives pour enfants, et concevait des montres Swatch et des publicités pour la vodka Absolut et Run DMC. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui, 34 ans après sa mort, en 1990 à l’âge de 31 ans, alors que son œuvre continue d’imprégner l’art contemporain.
Au cours de sa carrière courte mais intense, les figures palpitantes de Haring sont devenues une partie inextricable de la vie new-yorkaise, à l'image d'anciens hiéroglyphes qui n'étaient pas autant dessinés que déterrés. Les vestiges de ses travaux publics, comme sa peinture murale cramoisie sur le terrain de handball « Crack is Wack » à East Harlem de 1986 et la frise enveloppante de 700 pieds du centre médical Woodhull réalisée la même année, restent très visibles. À la fois moderne et classique, gnomique mais instantanément clair, le travail de Haring distille le Pop Art des décennies précédentes et le néo-expressionnisme des années 1980, enveloppant les mouvements de graffiti des quartiers chics dans une utopie sans genre et sans race – une vision fondamentale mais expansive de l'égalité humaine. Et pourtant, l'endroit le plus probable où vous le rencontrerez maintenant n'est toujours pas le musée, mais le centre commercial, qui a été son œuvre.
Le point de vue de Haring était que l'art devait être accessible au plus grand nombre, et il a correctement identifié que la plupart des gens n'y étaient pas exposés dans les galeries mais dans la rue et dans les magasins.
Aujourd’hui, l’étendue des produits de marque d’artistes – les bibelots et les T-shirts qui fonctionnent comme une contrepartie accessible à la machine milliardaire du marché de l’art – est banale. Mais les convulsions provoquées par l'ouverture, en 1986, du Haring's Pop Shop, une boutique de SoHo qui vendait des souvenirs bon marché estampillés de son vocabulaire énergique – épingles, autocollants, affiches avec des pénis souriants encourageant les relations sexuelles sans risque – étaient enragées. Les critiques y voient une violation du caractère sacré de l'art. On le traitait de prostituée et de « décorateur de discothèque ». Le culot d'un artiste apparu à la Biennale de Whitney en 1983 en vendant ses propres reproductions à bas prix était suffisamment radical pour choquer.
Et ils étaient bon marché. Les affiches coûtaient un dollar et les boutons Radiant Baby – une carte de visite Haring, auparavant offerte gratuitement – coûtaient seulement 50 cents.
Haring avait 27 ans et était mécontent du complexe galerie-industriel qui cherchait à le marchandiser, alors il a fait lui-même cette marchandisation. «Je voulais que ce soit un endroit où, oui, non seulement les collectionneurs pourraient venir, mais aussi les enfants du Bronx», avait-il déclaré à l'époque. « Après tout, je pensais que le but de la création artistique était de communiquer et de contribuer à la culture. »
Une lecture généreuse pourrait faire du projet de Haring une critique institutionnelle ; un point de vue plus cynique ressemblerait à celui du critique anonyme qui a écrit « CAPITALISTE » sur la façade du Pop Shop quelques heures après l'ouverture de ses portes.
Les critiques et les conservateurs ont encore du mal à gérer l'héritage de Haring. Le MoMA, dont le Design Store propose plus de quatre douzaines de styles de produits Haring, possède le dessin à l'encre sans titre de Haring, long de 15 mètres, datant de 1982, mais le expose rarement. La dernière exposition muséale complète de l'œuvre de Haring à New York a eu lieu au Whitney en 1997. Apparemment, le commercialisme continue de mettre les gens mal à l'aise. « Radiant » laisse place à une multiplicité de motivations : Haring était un humaniste sincère, conscient du pouvoir libérateur de l'art ; ou un observateur attentif de la télévision et des dessins animés américains dont il reflétait le brillant saturé dans son art ; ou un des premiers maîtres de l'auto-promotion.
À l’heure actuelle, un jugement n’est plus pertinent. Être considéré comme un vendu, comme on appelait souvent Haring, était autrefois l'insulte la plus blessante. C'est désormais l'objectif. L’artiste moderne, en plus de devoir dire quelque chose de vrai sur la vie, est censé être un entrepreneur. Vu aujourd'hui dans le contexte actuel de la cohue des licences artistiques et des mélanges de l'industrie de la mode, le Pop Shop, qui a fermé ses portes en 2005, semble pittoresque. Au moins, il fallait se présenter pour acheter.
Comme tant d'artistes des années 80, Haring idolâtrait Warhol, « le parent culturel de chacun », comme l'écrivait René Ricard en 1981. Là où Warhol observait froidement le virage du pays vers la culture de masse, Haring le dévorait. Son père, un dessinateur amateur, lui a fait dessiner Mickey Mouse avant l'âge de 6 ans. Warhol a été particulièrement impressionné par les boutons de Haring ; Lorsqu’il qualifiait Haring d’« agence de publicité à part entière », c’était la plus grande approbation à laquelle il pouvait penser.
Haring n'est pas responsable du mode hypercapitaliste de l'art ; il est probable qu'il s'y dirigeait déjà, accéléré par la ruée vers l'argent du marché des années 80 et la confusion entre le marché d'une œuvre d'art et sa valeur culturelle. Mais sa carrière offre une autre voie, celle du street art. Dans les années 70 et au début des années 80 à New York, les écrivains et les graffeurs du métro travaillaient en grande partie à la périphérie de la ville, en dehors du centre gravitationnel du système de galeries, jusqu'à ce que la gravité les attire à eux aussi.
Le style de Haring – les bonhommes de boogie et la palette fluorescente – est alternativement décrit comme Pop et graffiti. Et tandis que sa ligne sinueuse évoque une partie de l'art graphique et bulbeux du train dont Haring est devenu amoureux, une grande partie du label graffiti s'applique parce qu'il a côtoyé des artistes comme Futura, Lee Quiñones et Haze. Mais en plus d'être produits dans un style de guérilla sur des propriétés publiques, les premiers dessins au trait simples que Haring a collés sur les lampadaires et sur les quais du métro ont peu de choses en commun avec les inventions alphabétiques propulsives des graffeurs.
Ce que Haring a le plus retenu du graffiti, c'est l'objectif d'une exposition maximale, qu'il a reconnu comme un engagement social. (Gooch cite Tony Shafrazi, le marchand de Haring, qui a rappelé l'habitude de Haring de donner de petits dessins comme « une partie naturelle de sa façon de travailler. ») Dans un essai pour Documenta 7, en 1982, dans lequel son travail figurait aux côtés de celui de ses contemporains. comme Donald Judd, Richard Serra et Cy Twombly, Haring écrit : « Ma contribution au monde réside dans ma capacité à dessiner. Je dessinerai autant que possible pour autant de personnes et aussi longtemps que possible. »
Les humanoïdes rythmés et les sourires à trois yeux de Haring étaient aussi reconnaissables à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. Mais son génie fut de saturer sa ligne nerveuse dans la conscience publique de telle sorte que les artistes qui ne pensent pas du tout à lui deviennent des imitateurs du style tardif. (Les New-Yorkais qui ont vu les camions de collecte du Département de l'Assainissement recouverts d'épaisses lignes noires pourraient être surpris d'apprendre qu'il ne s'agit pas d'une licence Haring, mais de l'œuvre de Timothy Goodman.)
L'héritier le plus visible de Haring est Brian Donnelly, qui, sous le nom de KAWS, crée des peintures et des sculptures très abouties mettant en scène une écurie de personnages moroses, aussi éloignés du ton gestuel et optimiste de Haring qu'on puisse l'imaginer. Pourtant, Donnelly, un ancien tagueur, a visiblement beaucoup pensé à Haring. « Sans titre (Haring) », datant de 1997, une photographie en noir et blanc de Haring dessinant sur une publicité dans le métro, surpeinte d'une amibe néon regardant par-dessus son épaule, comme s'il prenait des notes, fonctionne comme un manifeste. Il y a quelques chevauchements stylistiques : les personnages de Donnelly, dérivés de dessins animés célèbres, sont également immédiatement reconnaissables. Mais c'est dans une perspective plus large, dans laquelle sa production artistique est complétée par des sorties constantes de jouets de collection et des collaborations avec la mode de luxe, que la pratique de Donnelly peut être considérée comme celle de Haring ajustée à l'inflation.
En termes de croisement de marchés, Donnelly est l'artiste post-graffiti le plus performant, même si d'autres s'en rapprochent. Futura, par exemple, a collaboré avec Comme Des Garçons, le Dr Martens ainsi qu'avec les Yankees et les Mets. Dans sa vie après la mort, Haring a remboursé sa dette envers les écrivains de style, en ayant, comme il l’a noté, « remplacé le réseau d’information dans le métro par un réseau international de distribution ». À leurs yeux du moins, il a atteint la sainteté : une fresque murale un peu déroutante du street artiste Kobra installe Haring, avec Warhol et Basquiat dans un mont Rushmore surplombant les galeries de Chelsea.
L'art de Haring reflétait les turbulences de l'époque – la menace de guerre nucléaire et le conservatisme de l'ère Reagan se traduisant par des files d'attente anxieuses et des gens irradiés par des soucoupes volantes – mais aussi la libération sexuelle, les indulgences et l'exubérance de la scène club de l'époque, transmises via des boombox et des cœurs gonflés. .
Vers la fin de sa vie, alors qu'il luttait contre le SIDA, ses glyphes flottants se sont tournés vers l'activisme : des affiches politiques prônant le désarmement nucléaire et la lutte contre l'apartheid et humanisant l'épidémie de SIDA par l'éducation et des appels au nom d'ACT UP, toutes rendues dans le même positivité indéfectible. Pour la plupart des téléspectateurs, ces signifiants ont disparu. Ce qui persiste est une simple universalité. Comme l’art religieux ou les peintures rupestres, ils traitaient d’idées élémentaires : la naissance, la vie, la peur, la mort, le sexe. L'art de Haring pouvait être compris parce qu'il parlait dans les grandes lignes de la vie humaine.
Plus que toute autre chose, c'est l'octroi de licences qui étend le concept d'art public de Haring. Gooch cite David Stark, le fondateur d'Artestar, l'agence responsable de la montagne de produits de consommation sous licence avec l'œuvre de Haring, ainsi que Basquiat et d'autres artistes de l'époque. Stark a travaillé pour Shafrazi puis pour le domaine Haring, et considère son objectif avec une clarté missionnaire. «Je me suis basé sur le modèle de Keith», dit-il catégoriquement. « Keith Haring a le sentiment d'être du bon côté de l'histoire. » C'est bien sûr celui de la boutique de cadeaux.
La relation du monde de l'art avec ses réalités commerciales peut être curieusement difficile, désireuse d'étouffer le bruit des affaires qui bourdonne doucement en arrière-plan (qu'est-ce qu'une galerie sinon un magasin ?). L'absence de Haring dans les musées suggère que le penchant commercial vers sa vision populiste rend cette vision moins profonde. En fait, son triomphe total prouve le contraire. Il est impossible de savoir si Haring a vu venir l'expression moderne du marché de l'art, mais il a compris l'attrait d'une alternative et le désir de pouvoir conserver une œuvre d'art, aussi petite soit-elle.