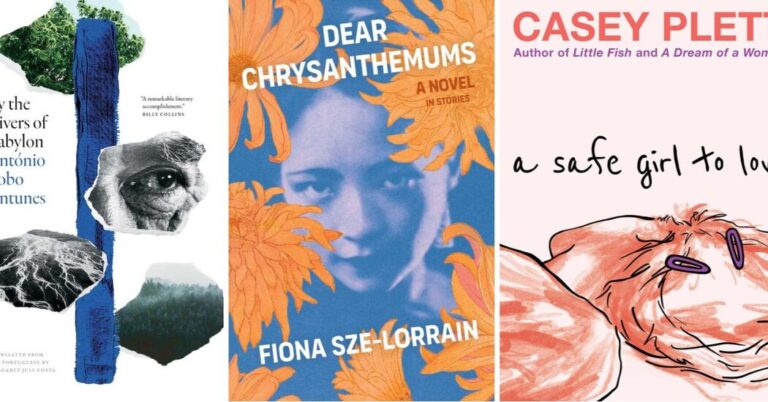Critique de livre : « The Art Thief », de Michael Finkel
Au début, Stéphane Breitwieser, le sujet de « The Art Thief » de Michael Finkel, semble s’amuser enviable. Âgé de vingt-cinq ans et vivant avec sa petite amie, Anne-Catherine Kleinklaus, dans un petit ensemble de pièces à l’étage de la maison de sa mère dans une banlieue industrielle « en dur » dans l’est de la France, Breitwieser est déchargé de préoccupations quotidiennes telles qu’un travail, faire louer ou planifier pour l’avenir. Il s’imagine lui-même une sorte d’âme plus pure, si dévouée à la beauté qu’il doit, selon les mots de Finkel, « s’en gaver ». Au cours de 200 pages vertigineuses qui sont aussi une publicité efficace pour les couteaux suisses (le seul outil de Breitwieser), il enlève oeuvre après oeuvre des musées – alias « prisons pour l’art » – et devient « peut-être le voleur d’art le plus réussi et le plus prolifique ». qui a jamais vécu. Il a entassé tous les artefacts d’une valeur de 2 milliards de dollars qu’il a amassés pendant huit ans dans le même grenier de la maison en stuc « indéfinissable » de sa mère Mireille Stengel.
Finkel inclut des preuves satisfaisantes de ce butin étonnant dans un insert en couleur qui montre un fouillis de sculptures en ivoire «éthérées», de gobelets en argent brillant, de peintures à l’huile onctueuses et plus encore. Tout ce que Breitwieser a caché dans l’antre du couple n’est pas destiné à être enfermé pour de l’argent, mais pour que le couple apprécie seul de se réveiller le matin : comme la sculpture de 1627 de George Petel « Adam et Eve » sur la table de chevet, à côté d’un 19th- vase en verre soufflé du siècle et une boîte à tabac bleu et or « commandée par Napoléon lui-même ».
Le récit de Finkel, basé en grande partie sur des entretiens avec Breitwieser, est celui d’un héros romantique qui dédaigne autant les détails pratiques que ceux de sécurité, et qui est « écrasé » lorsque Stengel daigne acheter des meubles Ikea. « Je suis comme le contraire de tout le monde », déclare-t-il, trouvant « son problème… incurablement existentiel : il est né au mauvais siècle ». Que Finkel aligne les sympathies du lecteur avec le point de vue du criminel provoque une ruée vertigineuse de freudenfreude.
Le portrait romancé d’un sujet masculin compliqué est une formule avec laquelle Finkel a déjà trouvé le succès : son précédent livre à succès, « The Stranger in the Woods », sur l’ermite du Maine Christopher Thomas Knight, a été développé de la même manière à partir d’un article dans GQ. Pourtant, malgré la taille mince de ce livre, les efforts de Finkel pour remplir ses pages finissent par fatiguer, les remplissant de réflexions génériques sur les raisons pour lesquelles les gens font de l’art et des lignes qui grattent la tête comme « Le jaune est la teinte la moins harmonieuse pour une banane ». Sa dépendance aux tropes donne au livre une impression de peinture par numéros : le mauvais garçon ; la petite amie ingénue prudente qui aspire à une vie plus normale; la mère qui a trop « choyé » son fils et prétend qu’elle n’a jamais monté les escaliers pour affronter ce qu’il faisait réellement.
À la fin, il nous reste des signes indiquant que ce qui nous a été proposé n’est qu’une ébauche, pas la vérité la plus compliquée. Finkel dépeint Breitwieser comme un pur esthète motivé uniquement par la passion esthétique, mais plus tard, il est également arrêté pour un simple vol à l’étalage. Finkel écrit que « la beauté du monde, pour Breitwieser, culmine avec Anne-Catherine et leur collection d’art », mais dans un tournant choquant, l’auteur effleure le passé, Kleinklaus dit sous serment que Breitwieser l’a frappée après avoir appris qu’elle avait caché un avortement. «Il m’a fait peur», dit-elle dans une salle d’audience; à un détective, dit-elle, « je n’étais qu’un objet pour lui. »
Enfin, Stengel n’a-t-elle vraiment jamais soupçonné ce que son fils faisait chez elle ? Sa « purge du grenier » frénétique – au cours de laquelle elle a jeté des pièces d’argent dans un canal et brûlé des peintures dans une forêt – était-elle vraiment « l’expression ultime de l’amour maternel », selon Breitwieser ? (Elle dit elle-même à la police : « Je voulais blesser mon fils, le punir. ») C’est de loin l’acte le plus choquant du livre, mais – comme pour les personnages de Stengel et Kleinklaus – Finkel le laisse d’une opacité frustrante. Il rend chaque complication et contradiction à grands traits, se précipitant vers une conclusion rapide et insatisfaisante, comme s’il était trop absorbé par son propre récit romantique pour le perturber.
Du grand art, Breitwieser le sait, des surprises. « The Art Thief » – un film pop-corn d’un livre qui gardera néanmoins les lecteurs rivés – ne le fait pas.