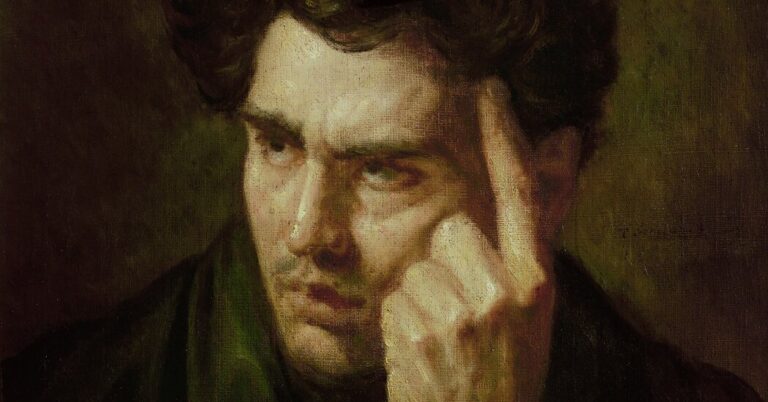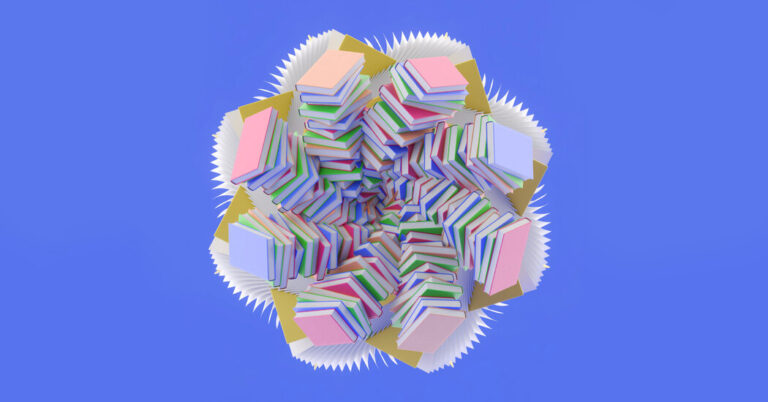Critique de livre : « Orphan Bachelors », par Fae Myenne Ng ; « Rencontrez-moi ce soir à Atlantic City », par Jane Wong
Mon premier souvenir de communauté est de me promener dans ma ville natale dans le nord de la Chine avec ma mère et mes grands-parents, recevant des salutations du type « Avez-vous mangé? » d’amis et de connaissances et assurant à chacun : « Nous avons.” Des décennies plus tard, lorsque mon grand-père est décédé de manière inattendue pendant la pandémie de Covid avant que la Chine ne rouvre ses frontières, ma mère s’est réfugiée dans sa cuisine du New Jersey, cuisinant tous les soirs jusqu’à l’aube. Un flot de sautés, de soupes et de sucreries est apparu à ma porte à quelques kilomètres de là; sur mon téléphone, un texto: « As-tu mangé? »
Dans de nombreux ménages américains d’origine asiatique, l’amour est mêlé à la nourriture. Plutôt que de nous dire qu’ils nous aiment, nos parents nous nourrissent, nous protégeant contre la faim physique pendant qu’une faim émotionnelle fait rage. Deux mémoires, « Orphan Bachelors » de Fae Myenne Ng et « Meet Me Tonight in Atlantic City » de Jane Wong, explorent les nombreuses formes de faim qui accompagnent le fait d’être asiatique en Amérique.
Honorer toute la profondeur des deux mémoires dans une seule revue est aussi impossible que de célébrer toute la richesse de l’héritage asiatique américain et insulaire du Pacifique en un seul mois. Ng et Wong sont tous deux des Américains de deuxième génération avec des racines ancestrales à Toishan, dans la province méridionale chinoise du Guangdong. Mais ils ont grandi à près de trois décennies d’intervalle, sur les côtes américaines opposées – Ng dans les années 1950 et 1960 à San Francisco, où sa famille exploitait une épicerie, et Wong dans les années 1980 et 1990 dans le New Jersey, où ses parents tenaient une Restaurant chinois. Chaque auteure peint son histoire avec panache ; mais alors que le récit de la romancière Ng pourrait être assimilé à une œuvre figurative à l’huile, avec des lignes structurées construisant des couches de l’histoire de sa famille, le livre du poète Wong rappelle une aquarelle abstraite, fluide, non linéaire, sans frontières claires.
Cette aptitude linguistique provoque des tensions chez les deux auteurs, qui n’apprécient pas que leur éducation américaine les ait confinés à l’anglais – ce que Ng appelle la « langue du barbare » et Wong « la langue du colonisateur ». En 1940, le père de Ng est arrivé en Amérique en tant que «fils de papier», se faisant passer pour l’enfant d’un Américain d’origine chinoise non apparenté pour entrer aux États-Unis malgré la loi d’exclusion. « Quand mon père a dit bort du jour, prononçant le mot « déporter » en le divisant en syllabes qui grinçaient comme une porte qui s’ouvre et se ferme », écrit-elle, « j’ai senti son décret ». Elle ajoute : « ‘Deport’ est le premier mot anglais que j’ai entendu parler de mon père, donc c’est mon premier mot anglais. » Lorsque la mère de Wong était enceinte d’elle, puis de son frère, Steven, elle a demandé à des clients aléatoires du restaurant familial de nommer ses enfants à naître – de leur donner des noms anglais afin qu’ils puissent « s’intégrer ». Wong a soif de se familiariser avec son nom chinois, dont le souvenir est devenu si faible qu’elle demande à sa mère de le lui répéter. En l’entendant, elle réfléchit : « Mon nom chinois s’ouvre comme un vieux pot d’ail fermenté. ‘Pouvez-vous le répéter?’ Je lui demande encore et encore, jusqu’à ce que je sois étourdi par son piquant méconnaissable.
Coincés dans la langue qui a subjugué leurs parents respectifs, Wong et Ng recherchent dans la littérature des Américains d’origine asiatique un semblant de communauté artistique. « Dictee » de Theresa Hak Kyung Cha a aidé Wong à voir que « la narration n’était pas un acte linéaire quand vous venez d’une histoire de traumatisme, de guerre et de migration. La lecture de ‘Dictée’ m’a permis de créer des constellations de mémoire spéculative. Ng a découvert que « Eat a Bowl of Tea », de Louis Chu, « a donné vie à mon Toishanese », une langue « intrépide » et « décomplexée » qui est « criée, pas parlée ». Ces textes ont également offert aux auteurs de nouvelles façons de démêler leur féminité américaine d’origine asiatique du racisme, de l’impérialisme et de la misogynie. Ng appelle le protagoniste de « Eat a Bowl of Tea », Mei Oi, « notre vengeur érotique contre l’exclusion ». Elle exige des relations sexuelles en guise de représailles pour les femmes sans enfant laissées dans les lits conjugaux vides de la Chine et aussi pour les célibataires orphelins vivant des vies asexuées en Amérique. Et Wong examine la violence vécue aujourd’hui par les femmes américaines d’origine asiatique – « hypersexualisées, objectivées et vilipendées » – à travers le prisme du viol brutal et du meurtre de Cha juste après la publication de « Dictee » en 1982 : « Avons-nous jamais connu la sécurité ? »
Les corps de Ng et de Wong ont tous deux connu des faims de toutes sortes, héritant des appétits «insatiables» de leurs ancêtres – pour la nourriture et l’eau, mais aussi pour la connexion. Leurs corps ont enduré les agressions masculines et les douleurs reproductives : le « souvenir de Wong de l’homme qui lui a mordu le mamelon si fort qu’il a fait couler du sang ; le souvenir d’un autre homme qui tenait son cou avec ses mains, mijotant dans le suif du pouvoir et de la violence », et les règles de Ng, qui « étaient des marathons de crampes musculaires, débilitantes, spastiques fœtales et déchirantes ». À propos de sa décision de ne pas avoir d’enfants, Ng écrit : « L’exclusion a tué mon désir de progéniture, d’entrée dans cette communauté d’immortalité délirante.
Il y a aussi la faim du chagrin : pour la mère, le frère et le père de Ng, qui meurent coup sur coup ; pour le père séparé qui a quitté Wong à l’adolescence; pour la série d’ex qui ont emboîté le pas à l’âge adulte de Wong ; et, surtout, pour les liens à la maison qui s’estompent avec la perte de chaque être cher.
Toute sa vie, le père de Ng lui a dit : « L’Amérique n’a pas eu à tuer de Chinois ; sa loi assurait qu’aucun ne naîtrait. Dans un tel monde, quoi de plus provocant que le fait de manger, de continuer à vivre ? Dans un restaurant du quartier chinois de New York, Ng a senti que la nourriture « m’avait ramenée à la maison », une plaisanterie chaleureuse lui rappelant la « nourriture pour bébé faite maison » de sa mère. Et, avec un bol de jook que Wong a appris à faire elle-même, « J’ai pensé à la façon dont je pourrais enfin nourrir ceux que j’aime », comment « tout ce que je mange est un rappel que je suis en vie ».