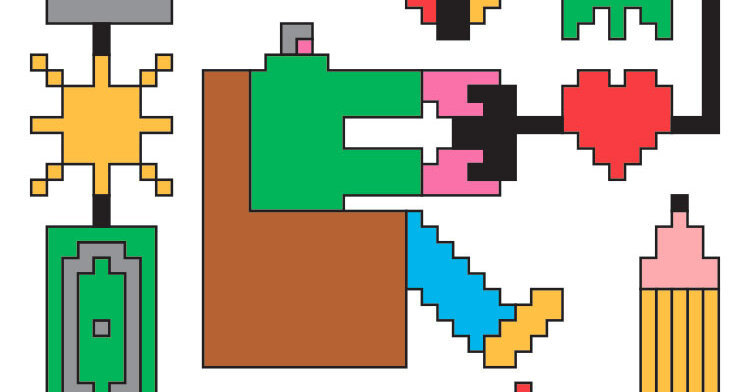Critique de livre : « L'art de la diplomatie », par Stuart E. Eizenstat
Lorsque j’ai grandi dans l’Irlande catholique, les livres sur des questions morales et théologiques portaient, près de leur page de titre, la marque d’approbation d’un évêque local et l’expression « nihil obstat » – une façon latine sophistiquée de dire « tout est clair ». Le livre de Stuart E. Eizenstat sur les épisodes majeurs de la diplomatie américaine au cours du dernier demi-siècle – de l’ouverture de la Chine à l’invasion de Gaza – est accompagné de nihil obstats émanant de l’équivalent laïc de tout un conclave de cardinaux.
Il contient un avant-propos posthume d'un ancien secrétaire d'État, Henry Kissinger, et une préface d'un autre, James A. Baker III. Il contient des textes de présentation jaillissants d'un ancien président américain (Bill Clinton), de trois anciens premiers ministres (Tony Blair du Royaume-Uni, Bertie Ahern d'Irlande et Ehud Olmert d'Israël), d'une galaxie de sommités internationales et de deux autres sommités de la diplomatie américaine, Hillary Clinton et John Bolton. Tous ont également été interviewés pour leurs idées.
La conjonction improbable de ces deux derniers noms – Bolton a servi dans l’administration de Donald Trump, qui était, entre autres, l’ennemi juré de Clinton – est typique de « l’art de la diplomatie ». Kissinger et Baker étaient républicains ; Eizenstat lui-même a occupé des postes élevés dans les administrations démocrates de Jimmy Carter et Bill Clinton.
Le livre renvoie donc à un idéal de diplomatie américaine en tant qu’arène non partisane, une entreprise essentiellement technocratique. Eizenstat est mécontent « quand la diplomatie est politisée » et il espère promouvoir une « vision d’un leadership américain bipartite ». Pourtant, s’il fut un temps où il était possible d’imaginer une diplomatie non politisée, il est sûrement révolu depuis longtemps. Eizenstat reconnaît, par exemple, que la lutte contre le changement climatique « sera un test suprême » pour le leadership mondial de l'Amérique. La satisfaction de ce critère dépend entièrement du parti au pouvoir.
La folie d’essayer d’éviter la partisanerie est évidente même dans l’avant-propos de Kissinger. Il résume brutalement sa propre position intellectuelle de longue date : En politique étrangère, les actions n’expriment pas « une notion de justice » mais sont « fondées sur une conception d’intérêts ». C'est une fausse dichotomie. Toute politique étrangère sensée doit découler de la compréhension du fait que, dans un monde radicalement interdépendant, la justice mondiale est également un intérêt national vital. La régulation équitable du commerce, le respect des lois internationales contre les agressions et les violations des droits de l’homme, la gestion rationnelle des migrations et le sauvetage des vies humaines sur la planète ne sont pas étrangers au bien-être immédiat des Américains.
Ces impératifs découlent de valeurs collectives, c’est-à-dire du politique. Il est particulièrement étrange qu'Eizenstat, qui en plus de servir sous Carter est l'auteur de « President Carter : The White House Years », élude pour l'essentiel le conflit évident entre la vision du monde exposée par Kissinger dans l'avant-propos et celle de son ancien patron, qui a insisté en tant que président sur le fait que la politique étrangère américaine « est enracinée dans nos valeurs morales », sauf pour dire que la victoire électorale de Carter « a signalé un abandon de la realpolitik de Kissinger ».
Dans un premier chapitre hagiographique sur Kissinger lui-même, Eizenstat écrit qu’il « a présidé à certains des plus grands triomphes de la politique étrangère américaine, ainsi qu’à certains de ses échecs tragiques ». Les triomphes – en particulier l’ouverture des relations diplomatiques avec la Chine et l’établissement de la paix entre l’Égypte et Israël – sont racontés avec des détails saisissants et captivants. Les tragédies sont balayées sous le mince tapis d'une note de fin de texte : « Par exemple, le soutien de Kissinger aux dictateurs latino-américains ayant des politiques flagrantes en matière de droits de l'homme ; le bombardement massif, meurtrier et déstabilisateur du Cambodge ; la poursuite de la guerre du Vietnam » et le « soutien à l’invasion du Timor oriental par le dictateur indonésien Suharto ».
Des millions de vies sont englobées dans cette note de fin, et c’est ce qui fait de « L’Art de la Diplomatie » un livre si frustrant. Il se présente, selon les mots de Kissinger, comme « un cadre pour mener la diplomatie ». Il s’agit en réalité de quelque chose de beaucoup plus restreint : un ensemble d’études de cas sur la conduite de négociations internationales spécifiques qui se lisent comme un programme étendu pour les aspirants ambassadeurs. Nous entendons parler du démantèlement prudent de l’Union soviétique vers 1990 (il était important de ne jamais amener Mikhaïl Gorbatchev « au point où il devait dire non ») et du démantèlement moins prudent des talibans en Afghanistan après le 11 septembre. (Les gestes militaires, comme une invasion, n’ont de sens que s’ils sont accompagnés de « véritables objectifs de sécurité nationale ».)
Ces études sont souvent fascinantes et, basées sur des entretiens approfondis avec des participants comme l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice et l’ancien directeur de la CIA Leon Panetta, elles contiennent de nombreux matériaux de recherche utiles.
Le plus intéressant d'entre eux est de loin le récit direct d'Eizenstat sur ses négociations avec les autorités et les institutions commerciales suisses, allemandes et autrichiennes pour obtenir des réparations et une restitution pour les survivants de l'Holocauste. Dans les années 1990, Eizenstat a emprunté la voie du compromis entre « un groupe indiscipliné et agité d’avocats spécialisés dans les recours collectifs », un « gouvernement suisse récalcitrant, impénitent et peu coopératif » et les besoins des victimes. Son récit de ces entretiens est animé par une passion morale et suffisamment captivant pour donner envie d’écrire un livre plus personnel – et même plus politique.
Parmi les études de cas d'Eizenstat, celle que je connais le mieux est la négociation de l'accord du Vendredi Saint de 1998, qui a mis fin à la longue période de violence sectaire en Irlande du Nord connue sous le nom de Troubles. Même si sa description de la conclusion d’un accord est globalement exacte, sa compréhension du contexte politique est faible. La discrimination contre les catholiques d’Irlande du Nord, bien que systématique, n’était absolument pas « une forme d’apartheid, sauf le nom ». Il est également positivement insultant de suggérer que le Parti social-démocrate et travailliste, implacablement pacifique, de John Hume avait une « frange violente ». (Eizenstat semble confondre le SDLP avec l'ancienne aile politique de l'IRA, le Sinn Fein.)
Bizarrement, il affirme en outre que des hommes politiques irlandais-américains, dont le sénateur Edward Kennedy, « se sont opposés à l’implication des États-Unis » dans le processus de paix. Comme semble le reconnaître l’une de ses propres notes de fin, c’est exactement le contraire qui s’est produit. Peut-être qu’en essayant de couvrir une telle gamme de situations, du Vietnam et de l’ex-Yougoslavie à l’Angola et à l’Afghanistan, Eizenstat s’est tout simplement trop dispersé.
Il essaie même de mettre le livre à jour en ajoutant des réflexions rapides (et perspicaces) sur la crise de Gaza. Il joint certains d'entre eux à un chapitre dans lequel il salue le succès de la négociation par l'administration Trump d'un ensemble d'accords entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Cet accord (connu sous le nom d'Accords d'Abraham) a, écrit-il, « transformé la position d'Israël au Moyen-Orient et l'avenir du processus de paix, intégrant Israël dans la région pour la première fois ». Immédiatement après, dans une courte section sur les atrocités du Hamas du 7 octobre, il écrit que « la réponse d'Israël a empêché sa plus grande intégration dans la région ». Ces événements terribles rendent moins convaincantes ses conclusions trop optimistes sur l’efficacité des accords restreints.
Être pointu sur les mécanismes des négociations mais flou sur les environnements politiques plus larges est peut-être un risque professionnel de la recherche d'Eizenstat d'une notion de diplomatie dépolitisée. Les mécanismes sont importants mais, comme nous le rappellent les horribles événements survenus en Israël et à Gaza, la conclusion d’un accord n’est pas un art qui peut être pratiqué avec succès indépendamment d’impératifs politiques et moraux beaucoup plus vastes. Autant les États-Unis se sont engagés à désamorcer les bombes avec habileté et courage, autant ils ont également participé à leur largage. Une description plus réfléchie et plus souple de la diplomatie américaine accorderait beaucoup plus d’attention à la relation complexe et parfois tragiquement contradictoire entre ces deux activités.