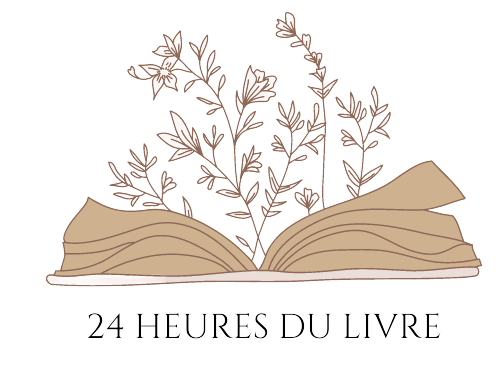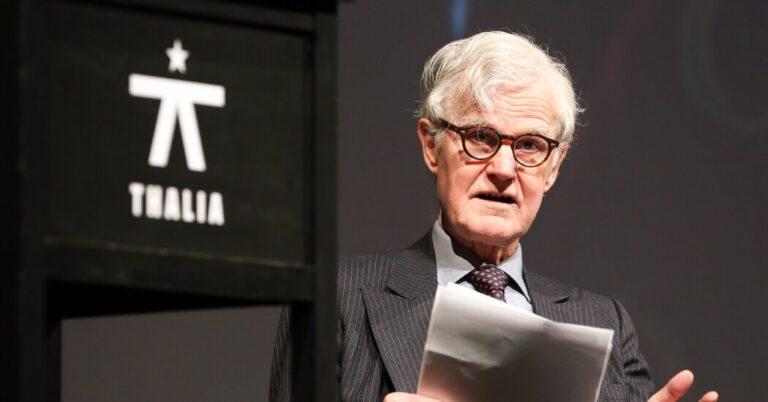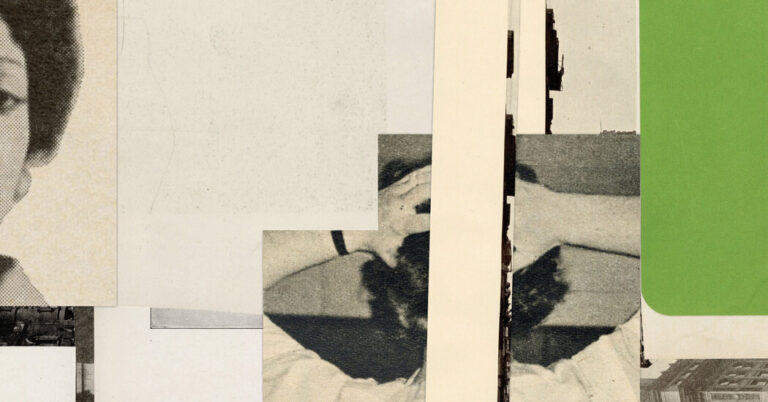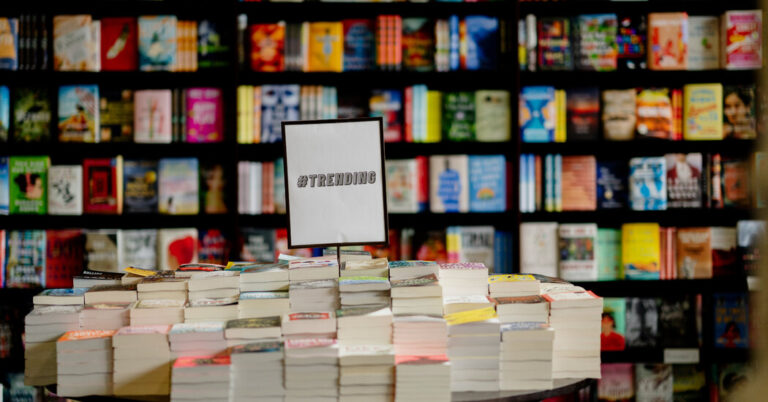100 ans après la mort de Kafka, les peuples et les nations se battent toujours pour son héritage
Dans sa nouvelle « L'Orgie de Prague », Philip Roth fait dire à un écrivain tchèque : « Lorsque j'étudiais Kafka, le sort de ses livres entre les mains des kafkologues me semblait plus grotesque que celui de Josef K. » Tout comme la prose de Franz Kafka exige et échappe à l'interprétation, quelque chose dans son héritage a à la fois sollicité et résisté aux revendications de propriété.
Malgré son étonnante clairvoyance sur la cruauté impersonnelle de l'État bureaucratique et la profonde aliénation de la vie contemporaine, Kafka n'aurait pas pu prévoir combien d'admirateurs liraient et mal interpréteraient ses fictions énigmatiques après sa mort, ni combien d'héritiers potentiels chercheraient à s'approprier lui comme le leur au cours du siècle qui a suivi.
Des affirmations concurrentes ont commencé à tourbillonner presque aussitôt que Kafka est mort de tuberculose, il y a 100 ans en juin dernier, un mois avant son 41e anniversaire. Max Brod – ami proche, traître à la dernière instruction de Kafka de brûler ses manuscrits, rédacteur autoritaire de ses journaux intimes et de ses romans inachevés, et auteur de la première biographie de Kafka – l'a dépeint comme un « saint » des temps modernes dont les histoires et les paraboles « sont parmi les documents les plus typiquement juifs de notre époque.
Parmi les autres lecteurs religieux des romans publiés par Brod (« Le Procès » en 1925, « Le Château » en 1926 et « Amerika » en 1927), les premiers traducteurs anglais de Kafka, Edwin et Willa Muir, le présentèrent comme un allégoriste de la grâce chrétienne. (En allemand, « Die Verwandlung », le titre du récit de Kafka sur la métamorphose de Gregor Samsa en insecte, évoque également « transfiguration ».)
Dès 1947, Edmund Wilson prévenait que toute cette déification risquait de « sursaturer et de stupéfier » les lecteurs de Kafka. Pourtant, l’engouement pour Kafka a continué de croître. Dans les années 1960, les existentialistes interprétaient Kafka comme un précurseur angoissé qui regardait l’abîme de l’absurdité et demandait – comme le fait Josef K. dans l’avant-dernier paragraphe de « Le procès » – « Où était le juge qu’il n’avait jamais vu ? Simone de Beauvoir disait que Kafka « nous a révélé nos propres problèmes, confrontés à un monde sans Dieu et où pourtant notre salut était en jeu ».
Les psychanalystes ont présenté l'auteur d'histoires comme « Dans la colonie pénale » et « Un artiste de la faim » comme un héraut névrotique de l'étrangeté ou un « poète de la honte et de la culpabilité » auto-torturé (comme le dit le sous-titre de la biographie de Saul Friedländer). Les modernistes ont adopté Kafka non pas comme un patient à diagnostiquer, mais comme l’écrivain qui a perçu avec le plus d’acuité l’effondrement ahurissant des idées reçues dans notre société. « S'il fallait nommer l'artiste qui se rapproche le plus du genre de relation avec notre époque que Dante, Shakespeare et Goethe entretenaient avec la leur », a déclaré WH Auden, « Kafka est le premier auquel on penserait. »
D’autres ont entraîné Kafka dans telle ou telle cause politique, le plus bizarrement lorsqu’il a été transformé en une arme de la guerre froide. Dans un discours prononcé à Moscou en 1962, Jean-Paul Sartre mettait en garde contre la « militarisation » de la culture, comparant Kafka à une « grenade dans la bibliothèque » ou à un chariot de dynamite transporté entre l’Est et l’Ouest. « Une véritable compétition culturelle, disait Sartre, soulève le défi pacifiste suivant : à qui, à nous ou à vous, appartient Kafka ; c’est-à-dire qui le comprend le mieux ?
Les critiques soviétiques ont enrôlé Kafka comme un allié de l’individu digne qui affronte courageusement le système capitaliste, tandis que les dissidents anticommunistes ont fait de lui un adversaire de la terreur bureaucratique pratiquée par les régimes autoritaires. En 1954, bien avant que le nom de l'écrivain ne devienne un adjectival cliché omniprésent, Arthur Koestler a dénigré les procès-spectacles de Moscou en les qualifiant de « kafka-esques ». Deux ans plus tard, alors que les chars soviétiques écrasaient le soulèvement hongrois, le critique littéraire marxiste György Lukács était arrêté à Budapest, détenu dans un château roumain et privé du droit de connaître les accusations, et encore moins de les réfuter. « Donc Kafka était réaliste après tout ! » a-t-il déclaré.
Un chapitre plus récent de l'histoire de la vie après la mort controversée de Kafka implique ceux qui ont tenté de relier un « nous » national à son nom. À partir de 2007, une bataille de neuf ans pour la garde des manuscrits de Kafka que Brod avait sauvés de justesse de l’occupation nazie de Prague a été menée devant les tribunaux israéliens. L’affaire pourrait être lue comme un commentaire sur une seule question : cet écrivain – membre d’une minorité juive au sein d’une minorité germanophone au sein d’une minorité tchèque au sein d’un empire austro-hongrois hétérogène – appartient-il à la littérature allemande ou à l’État qui se considère comme le représentant des Juifs partout dans le monde ?
D’un côté, la Bibliothèque nationale d’Israël, qui a recruté Kafka comme écrivain juif, malgré son ambivalence à l’égard du sionisme. Israël se considérait comme le foyer légitime des produits culturels de la diaspora, le lieu approprié pour terminer une histoire commencée ailleurs. De l'autre côté, les avocats des Archives littéraires allemandes de Marbach ont soutenu que les manuscrits de Kafka appartenaient à l'Allemagne parce que sa langue était l'allemand – « la prose allemande la plus pure du siècle », a déclaré Hannah Arendt.
Lorsque j’ai assisté à l’audience de la Cour suprême israélienne sur cette affaire à l’été 2016, une chose semblait hors de doute : les revendications de l’Allemagne sur un écrivain dont la famille a été décimée lors de la Shoah étaient mêlées à la tentative du pays de surmonter sa honte. Peut-être que certains Allemands espéraient que le fait de revendiquer Kafka – en tant que gardien juif de la prose allemande et en tant que Juif assez chanceux pour mourir avant de devenir victime des nazis – contribuerait à ce dépassement. Il y a là une puissante ironie : l’écrivain qui élève l’auto-condamnation au rang d’art serait utilisé comme un instrument d’auto-disculpation, pour effacer le passé plutôt que d’y faire face. (La Cour suprême s'est prononcée en faveur de la Bibliothèque nationale.)
Les étudiants palestiniens avec lesquels j’ai étudié Kafka n’étaient pas préoccupés par les questions d’appropriation culturelle. Lorsque nous lisions « Le Procès » dans un cours que j’enseignais dans un programme du Bard College à Jérusalem-Est, les étudiants étaient fascinés dès la première ligne : « Quelqu’un a dû calomnier Josef K., pendant une matinée, sans avoir rien fait de mal, il a été arrêté. »
Un étudiant a comparé le livre à « The Shell » de Mustafa Khalifa, un roman (publié ici en 2023) basé sur les 13 ans d'emprisonnement sans procès de l'auteur en Syrie. Une autre a trouvé dans la vaine quête de justice de Josef K. un nouveau vocabulaire pour exprimer les efforts juridiques déployés par sa famille depuis des décennies pour éviter l'expulsion de la maison dans laquelle ils vivaient depuis le début des années 1950, un appartement de deux chambres dans le quartier musulman. Quartier de la vieille ville de Jérusalem. Étant donné que la propriété appartenait à une association caritative juive avant la création d'Israël en 1948, l'État a fait valoir que la propriété devait revenir aux administrateurs de l'association.
Comme pour le procès concernant les manuscrits de Kafka, les appels de la famille seraient finalement entendus par la Cour suprême. « Dans « Le Procès », dit mon élève, « on ne peut jamais obtenir un acquittement. Il en va de même pour nous : nous ne pouvons qu’espérer reporter l’expulsion, reporter, reporter, reporter.» Pour ces jeunes lecteurs, Kafka évoque un monde non pas surréaliste mais surréaliste.
J'ai alors été frappé par le fait que les lecteurs qui se rapprochent le plus de l'essence de la vision singulière de Kafka sont ceux qui reconnaissent l'ironie d'adopter une attitude exclusive à l'égard d'un écrivain si fidèle à sa propre non-appartenance et si attentif à opposer ses personnages, antagonistes. autorités divines, politiques et paternelles — en aucun temps ni lieu particulier. Dans une lettre à sa fiancée Felice Bauer, Kafka parle de son « aspiration infinie à l’indépendance et à la liberté en toutes choses ». Malgré son profond sentiment pour le théâtre yiddish et pour la langue hébraïque, ce désir l’a détaché de toute forme d’appartenance collective et a libéré son imagination pour naviguer au-delà de tout canon national, « obéissant », selon ses propres termes, « à ses propres lois du mouvement ». »
On ne peut que se demander si le spectacle d'un siècle de guerre pour son héritage artistique aurait amusé cet écrivain le moins possessif. « Tout ce que je possède est dirigé contre moi », a avoué Kafka à Brod, « et ce qui est dirigé contre moi n'est plus en ma possession. »