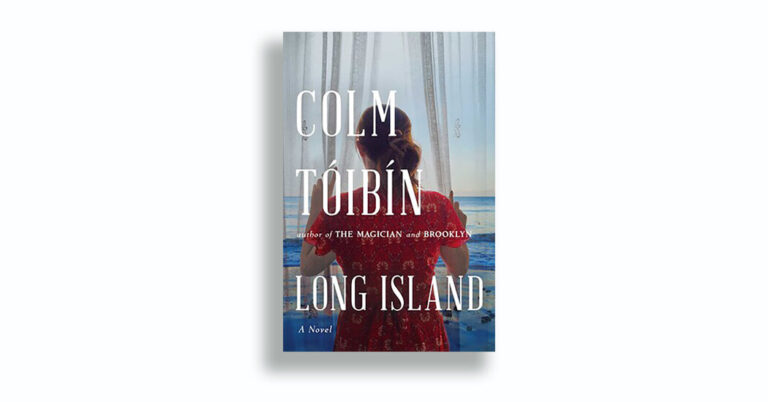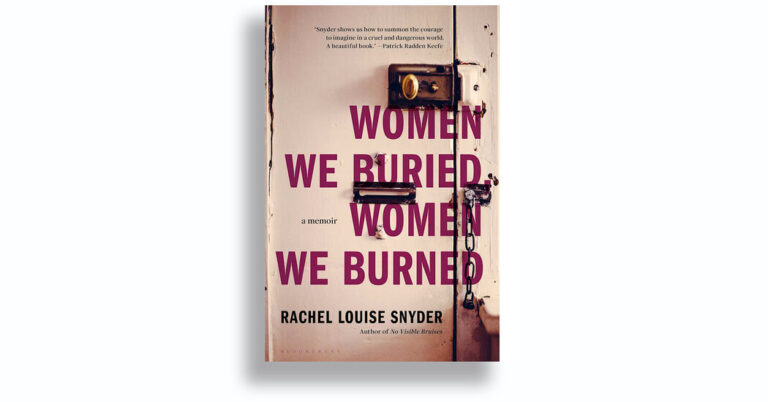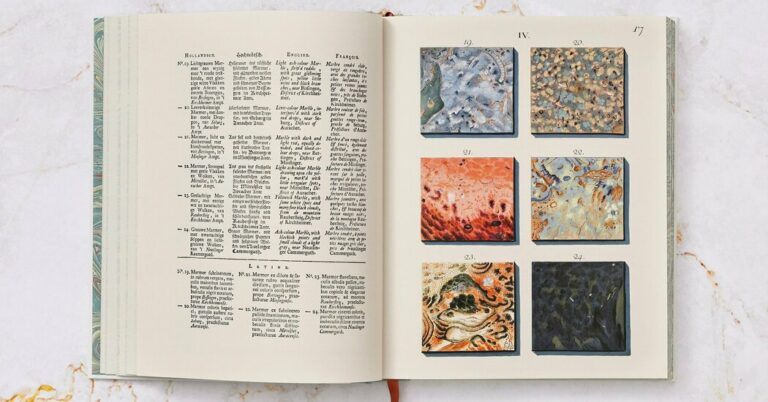Nouveaux mémoires qui abordent la solitude, l’héritage familial et bien plus encore
Dans , la famille de Meg Kissinger, composée de huit frères et sœurs et de deux parents épuisés, ressemble, à première vue, à une maison robuste et pleine d’amour dans le quartier de North Shore à Chicago. Mais dès l’âge de 5 ans, Kissinger se souvient que sa mère bien-aimée disparaissait plusieurs jours d’affilée. À la quarantaine, Kissinger a perdu deux frères et sœurs par suicide et sa mère alcoolique a survécu à plusieurs tentatives. Le silence était le vaisseau dans lequel étaient contenus tous les hululements désespérés de sa famille.
Chaque suicide engendre un vide, la famille et les amis doivent le remplir d’histoires, des efforts pour rationaliser l’insondable. Certains, comme Kissinger, tentent d’avancer en ignorant complètement le vide, comme si le simple fait de le dire à voix haute pouvait déclencher une autre bombe, dont la mèche est baignée de secret et dont le carburant brûle de honte.
Finaliste du prix Pulitzer et ancien journaliste du Milwaukee Journal Sentinel, Kissinger a passé des décennies à dénoncer les insuffisances dévastatrices du système de santé mentale des États-Unis. Ici, elle tourne son regard enquêteur vers sa propre famille, sondant la force corrosive de la répression. Pour divers Kissingers, la honte ne fait qu’amplifier l’angoisse de naviguer dans les bois sombres d’un esprit retourné contre lui-même.
L’histoire de cette famille fait partie d’un mouvement plus vaste au pays visant à déstigmatiser la maladie mentale. Le suicide est « une forme de deuil particulièrement solitaire », écrit-elle. L’intimité brute de sa prose illustre l’empathie dont notre société a si désespérément besoin.
Dans , Athena Dixon réfléchit à la façon dont le sombre pincement de l’isolement peut devenir si familier qu’il devient un réconfort. Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.
Écrivant pendant la pandémie de Covid, seule dans son appartement de Philadelphie, Dixon examine son penchant de toujours pour la solitude dans une prose qui se transforme souvent en koans douloureux de solitude. Qu’est-ce qu’être vu, être vraiment connu ? Elle ne trouve pas de bonnes réponses à ces questions du cœur, mais la question elle-même est une sorte de baume : « Que dire d’un sentiment de nostalgie qui s’infiltre parfois jusqu’à mes os ?
Nous suivons Dixon obsédé par les vidéos YouTube sur les personnes découvertes chez elles des décennies après leur mort, et réfléchit sur les réseaux sociaux pour détourner l’attention de la blessure de la solitude qui ne guérit pas. La farouche honnêteté de Dixon nous invite dans ces endroits sombres avec elle, à nous demander : de quelle manière remplissons-nous nos propres vies de distractions au lieu de chercher durement une image de nous-mêmes ?
Ni une excuse ni une mise en accusation de la culture numérique, ces mémoires exposent le propre défilement affamé de Dixon sans tenter de résoudre notre dilemme social. Elle distingue sans détour son identité réelle – une femme noire d’âge moyen, célibataire et prospère – de son avatar en ligne : « Je sais de quoi est construite la bulle ; à quel point il est brillant à la lumière ; et comme c’est ennuyeux de l’intérieur. Je vis à l’intérieur. Je l’ai créé.
Refusant de se livrer aux clichés du développement personnel, « The Loneliness Files » est une exploration essentielle de l’isolement inhérent à notre ère d’hyperconnexion virtuelle. Il se demande également comment nous pouvons retrouver notre chemin les uns vers les autres.
Écrit sous la forme d’une série de lettres – adressées au jeune moi de l’auteur, à sa sœur, à sa mère, à son ex-femme et à sa petite amie actuelle, à l’ancien dieu Cybèle et à d’autres – McKenzie Wark retrace la construction de son identité en tant que femme transgenre. Dans des aperçus à la fois époustouflants sur le plan émotionnel et intellectuel, elle se souvient de son passage à l’âge adulte à Newcastle, en Australie, dans les années 1960 et 1970 ; sa carrière de poète ; son mariage et son chagrin ; la parentalité; ses différents amants et sa transition, dans la cinquantaine.
Ces lettres intimes révèlent le processus de déconstruction puis de reconstruction de son individu. «Depuis ma transition, j’ai récupéré une partie de votre électricité», écrit-elle à un jeune McKenzie. «J’essaie de panser mes blessures.» À sa petite amie, Jenny, elle dit : « Dysphorie spatiale : j’ai l’impression que mon corps ne va pas bien, mais peut-être que mon corps va bien et que le monde se trompe à ce sujet. »
Elle commémore sa mère, Joyce, à travers des mots : « Quand j’écris, je t’écris toujours. … À cette absence que tu as laissée en moi. Lorsqu’elle entame sa transition et passe aux hormones, tous les souvenirs du cancer de Joyce lui reviennent. « Tu n’étais pas là pendant l’enfance où tout le monde pensait que j’étais un garçon », écrit-elle. « Et maintenant tu n’es pas là pour l’enfance que je n’ai pas eue, en tant que fille. »
La première opération chirurgicale d’affirmation de genre de Wark la rapproche de ce qu’elle ressent depuis longtemps sous les ornements charnus d’un corps masculin. « Jenny, c’est du travail de ne pas se sentir jalouse », écrit-elle. « J’ai réussi ce qui est en partie une approximation du corps d’une femme cis, mais je ne veux pas être une imitation. … Ma façon de vivre avec la différence est d’être dans cette chair comme sa propre œuvre d’art.
« Qu’est-ce que je faisais en faisant les cent pas à minuit dans cette ville étrangère ? » demande Xiaolu Guo dans ses nouveaux mémoires féroces, une série de courtes entrées semblables à un journal intime qui nous plongent profondément dans l’intérieur de la romancière primée. Dans le chapitre intitulé « La mue » (qu’elle définit comme « le moment où un animal perd sa vieille peau ou ses plumes pour grandir »), elle a laissé derrière elle sa fille et le père de sa fille en Angleterre pour enseigner à l’Université Columbia à New York. « Peut-être que je recherchais des aventures et des rencontres et, finalement, une sorte de liberté que je n’avais jamais eue en Chine ou en Grande-Bretagne. Mais quelle était cette liberté ? Illusion, illusion ou possibilité non réalisée ?
Née à Pékin, Guo a émigré en Angleterre (« ma maison construite ») à 29 ans, et elle a écrit de manière prolifique en chinois et en anglais. Tout au long du livre, des réflexions intimes (sur sa brève liaison avec un linguiste par exemple) s’ouvrent sur un jardin intellectuel voluptueux, ses références allant de Simone de Beauvoir à Nietzsche en passant par Virginia Woolf.
Ces idées de grande envergure partagent un fil conducteur commun : la lutte privée, contre la « domesticité à laquelle j’essaie d’échapper » alors même qu’elle aspire à son enfant, contre l’assujettissement de son identité individuelle au rôle de mère. Le caractère chinois pour « femme » ou « nu » ressemble à « une personne à genoux », écrit-elle. Elle voit la vie de la femme artiste comme un paradoxe entre inspiration et structure.
Avec les mots comme graines, le jardin des mémoires de Guo est aussi sauvage que cultivé. Les mots, écrit-elle, « sont mon existence même physique. Ils sont le lexique de mes réalités. Et pourtant, même si elle recherche un nouveau lexique, une nouvelle réalité, elle sait que les racines de la langue et de la culture sont inéluctables.