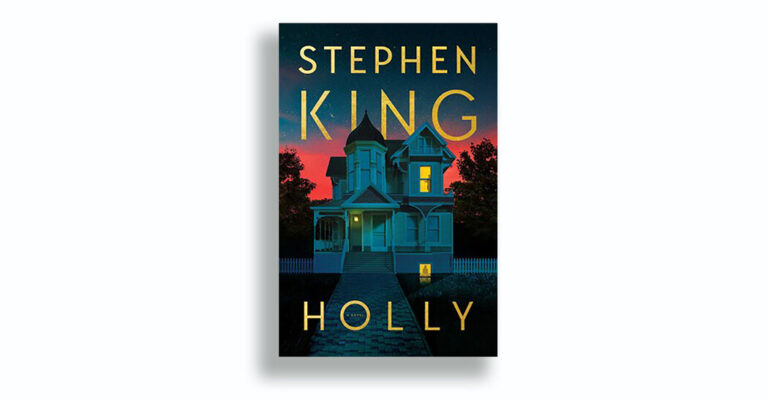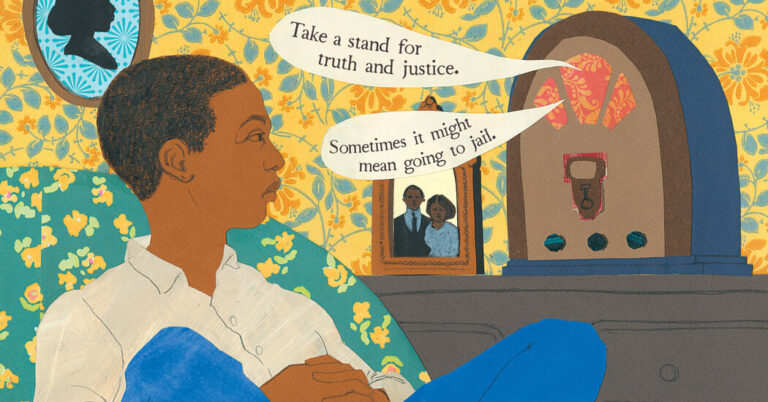Les champions de la décroissance veulent réduire l’économie pour sauver le monde.
Une marée montante et un gâteau plus gros : la croissance économique a longtemps été considérée comme une aubaine tellement évidente qu'elle est naturellement recherchée par les gouvernements du monde entier. Mais en 2016, lorsqu'un professeur londonien a averti un auditoire à Newcastle que le Brexit entraînerait une chute brutale du produit intérieur brut britannique, cette mesure bien connue de l'activité économique, le chahut d'une femme l'a surpris. « C'est votre foutu PIB », a-t-elle crié, « pas le nôtre ! »
Cette éruption s’est appuyée sur un soupçon étayé par la réalité : les gains en matière de croissance économique ont trop souvent soutenu la fortune des plus riches au lieu de soulever tous les bateaux. La prospérité, même dans les pays les plus prospères, n'a pas été partagée. Mais toute l’attention portée aux inégalités n’est qu’une fissure dans l’édifice de l’orthodoxie économique. Aujourd’hui, une proposition beaucoup plus radicale a émergé, qui se profile comme une boule de démolition : la croissance économique est-elle réellement souhaitable ?
Il y a moins de vingt ans, un économiste comme Herman Daly, qui plaidait en faveur d’une « économie stable », était si aberrant que son collègue économiste Benjamin Friedman pouvait déclarer que « pratiquement personne ne s’oppose à la croissance économique en soi ». Pourtant, aujourd’hui, on assiste à l’émergence d’un mouvement de « post-croissance » et de « décroissance » qui fait exactement cela – dans les journaux, sur les podcasts, lors de conférences. Considérez quelques-uns des livres publiés au cours des dernières années : « Post-Growth: Life After Capitalism » de Tim Jackson, « Post-Growth Living » de Kate Soper, « In Defense of Degrowth » de Giorgos Kallis, « Exploring Degrowth » de Vincent Liegey et Anitra Nelson. », « Moins, c'est plus : comment la décroissance va sauver le monde » de Jason Hickel. La prolifération du terme est un indicateur aussi efficace qu’un autre : la littérature sur la décroissance se multiplie.
En 1972, le théoricien français André Gorz a inventé le mot décroissance se demander si « l’absence de croissance – ou même la décroissance » de la production matérielle était nécessaire à « l’équilibre de la Terre », même si cela allait à l’encontre de « la survie du système capitaliste ». Gorz écrivait l’année même où était publié « Les limites de la croissance », un rapport rédigé par un groupe de scientifiques avertissant que les augmentations de population et d’activité économique finiraient par dépasser la capacité de charge de la planète. « Les limites de la croissance » a d’abord suscité du scepticisme, voire du ridicule. Les critiques ont souligné le bilan indéniablement impressionnant de l’humanité en matière d’innovation technologique. Comme l’a dit un économiste représentatif : « Nos prévisions reposent fermement sur une étude de la manière dont ces problèmes ont été surmontés dans le passé. »
Ainsi, la décroissance est restée en marge pendant des décennies, jusqu’à ce qu’une prise de conscience croissante du réchauffement climatique s’infiltre dans les débats publics au début des années 2000. La prise de conscience que nous n’avions pas innové pour sortir de notre situation écologique, ainsi que les inégalités mises à nu par la crise financière de 2008, ont alimenté une méfiance plus répandue à l’égard de la sagesse capitaliste conventionnelle. Peut-être qu’une croissance économique incessante était plus un poison qu’une panacée.
Une idéologie de « croissance »
Ce doute a pris des formes variées, depuis l’agnosticisme prudent jusqu’aux discours catégoriques, la décroissance occupant l’extrémité la plus extrême du spectre. Pour les partisans de la décroissance, il s’agit d’un principe fondamental selon lequel, dans les pays à revenu élevé, l’expansion constante exigée par le capitalisme n’est pas nécessaire pour améliorer la vie des gens ; au contraire, les inégalités et les ravages environnementaux qui en ont résulté les ont souvent mis à mal.
Prenez Hickel, un anthropologue qui enseigne à Londres et à Barcelone et qui est l'un des représentants les plus fougueux du mouvement. Comme d’autres critiques contemporains de la croissance effrénée, il met l’accent sur la crise climatique. Son livre commence par des scènes de dévastation écologique : vers de terre mourants, baisse des rendements agricoles, effondrement des stocks de poissons. Il souligne le lien entre la croissance du PIB et la consommation d’énergie, identifiant une idéologie de « croissance » qu’il assimile à « une sorte de folie ». Il dit qu'il ne promeut pas une réduction délibérée du PIB. Mais si le PIB stagne ou diminue parce que nous économisons l'énergie au lieu de la consommer, qu'il en soit ainsi.
Dans ce qui pourrait être un énoncé de mission pour le mouvement, Hickel écrit : « La décroissance consiste à réduire le débit de matières et d’énergie de l’économie pour la ramener à l’équilibre avec le monde vivant, tout en distribuant les revenus et les ressources plus équitablement, en libérant les gens des contraintes inutiles. travailler et investir dans les biens publics dont les gens ont besoin pour prospérer.
Ce programme équivaut à une refonte du système capitaliste, et non à un simple bricolage réformiste en marge. Ses partisans ne placent pas non plus beaucoup d’espoir dans les solutions technologiques. « La « croissance verte » n'est pas une chose », affirme Hickel, citant les recherches qu'il a menées avec Kallis. « Cela n'a aucun support empirique. »
Bien entendu, une déclaration aussi radicale est loin d’être incontestée. Des économistes comme Paul Krugman et des data scientists comme Hannah Ritchie soutiennent que les progrès technologiques signifient que la prospérité économique ne doit pas nécessairement conduire à une dégradation écologique. Mais malgré tous les débats sur la tarification du carbone, les parties par million et les degrés de réchauffement, l’argument distinctif avancé par Hickel et d’autres partisans de la décroissance est en fin de compte un argument moral : « Nous avons cédé notre capacité politique au calcul paresseux de la croissance. »
En d’autres termes, nous avons pillé la planète au lieu de trouver des moyens plus égalitaires de vivre les uns avec les autres. Le problème du croissancenisme est que pendant des décennies, il nous a détourné de la difficile politique de redistribution », écrit Hickel. Au début, cela ressemblait à l’opposé d’un problème. La capacité apparemment magique de la croissance à nous permettre d’éviter les conflits moraux les plus épineux était, pour des générations de politiciens, ce qui la louait précisément.
Pourtant, ce modèle d’évitement a aggravé non seulement nos problèmes écologiques mais aussi moraux. Un consensus illusoire maintenu par la croissance économique s’est dissous. Comme le note l’économiste Daniel Susskind dans son nouveau livre « Growth : A History and a Reckoning », de grandes questions qui avaient été reléguées aux marges – celles sur les notions conflictuelles de liberté, d’égalité et de justice – sont revenues avec force. Pourtant, il y voit une cause d’ambivalence et non de désespoir. Après tout, la croissance a également émancipé une grande partie du monde d’une « lutte impitoyable pour la subsistance », souligne Susskind. « La croissance a une promesse irrésistible et un prix inacceptable ; c'est miraculeux et dévastateur ; nous avons besoin de beaucoup plus et beaucoup moins.
S’il dénonce l’optimisme joyeux de l’establishment économique, Susskind se montre également très critique à l’égard des décroisseurs, trop dédaigneux à l’égard du capitalisme à son goût. Il recommande « d’adopter une mentalité de décroissance faible » – une mentalité qui tient «moins respect de la croissance » tout en préservant une « adhésion sérieuse aux mérites de la croissance ». Seule une « position plus équilibrée », dit-il, permettrait de « reconnaître la réalité d’un compromis difficile entre croissance et climat ».
Abondance sans croissance ?
Pourtant, pour les ardents partisans de la décroissance, c’est la timidité d’une « position plus équilibrée » qui a permis en premier lieu à la croissance capitaliste de fouler le sol de la planète. C'est le message résolu promulgué par Kohei Saito, un philosophe marxiste japonais de 37 ans qui s'est imposé comme le visage public du mouvement. « Toute tentative de mêler décroissance et capitalisme est vouée à l’échec », proclame-t-il dans « Slow Down : The Degrowth Manifesto ». Le capitalisme ne tend pas seulement vers la croissance, dit-il, mais il l'exige. « Exiger la cessation de toutes ces choses – exiger la décélération – revient en fait à exiger la fin du capitalisme. »
Cette idée peut paraître extrême, mais elle a trouvé un public considérable : « Slow Down », sorti aux États-Unis en janvier, s'est vendu à un demi-million d'exemplaires depuis sa première publication au Japon en 2020. Dans ce document, Saito cite la militante suédoise Greta Thunberg, qui a dénoncé une génération plus âgée qui ne s'intéresse qu'aux solutions qui permettent de continuer comme avant. Saito lui-même est né en 1987 et suggère que, parce qu'il n'a pas vécu la guerre froide, il a pu étudier le marxisme sans imposer « par réflexe » la réalité de l'Union soviétique au travail de Marx. En exigeant « la fin du capitalisme », Saito ne fait que commencer ; ce qu’il appelle n’est pas seulement la décroissance, mais un « communisme de décroissance ».
Attention, Saito maintient que le communisme qu'il propose n'est pas l'étatisme hiérarchique, coercitif et antidémocratique de l'Union soviétique, mais quelque chose qui ressemble beaucoup plus au communautarisme, avec un accent sur des mesures plus locales comme l'entraide, l'aide citoyenne. assemblées et « construction de communautés en face-à-face ». Cette redéfinition, dit-il, n'est pas une répudiation de Marx – qui a souligné la nécessité d'une croissance économique dirigée par l'État dans « Le Manifeste du Parti communiste » – mais est basée sur « les notes de recherche que Marx a conservées à la fin de sa vie », comme il l'a dit. sont devenus de plus en plus disposés à prendre en compte les dangers de la dégradation de l’environnement.
Il s’agit certainement d’une stratégie rhétorique inhabituelle : insister pour réutiliser Marx et ressusciter un terme chargé (et sans doute inexact) comme « communisme » en essayant de purger (ou d’ignorer) son bagage historique. Mais le livre de Saito est écrit en grande partie pour une génération qui a été aux prises avec les conséquences écologiques de la croissance économique et qui a donc peu de raisons de respecter les goûts et les aversions de ses aînés. Il se moque à plusieurs reprises du moindre soupçon de modération avec un ton dédaigneux : « cela ne revient à rien de plus » ; ses provocations sans compromis font sans aucun doute partie de l'attrait.
Mais finalement, Saito admet qu’il y a « une part de vérité » dans l’argument selon lequel le capitalisme produit de la richesse matérielle, et c’est pourquoi il défend le communisme de décroissance uniquement pour les pays riches, pas pour les pays pauvres. « Les habitants du Nord jouissent d’un style de vie riche, rendu possible par les sacrifices de ceux du Sud », écrit-il. La décroissance mettrait fin à cette injustice et offrirait une forme de « réparations » : réduire les ressources et l’énergie utilisées par le Nord permettrait au Sud de poursuivre sa propre croissance économique.
N'appelez pas cela un sacrifice de notre part. Même Saito est obligé de lutter contre notre attirance obstinée pour la générosité, s'éloignant du vocabulaire austère de la décroissance en recourant au langage de la plénitude. Comme Hickel, il promet un nouveau type d’« abondance radicale », dans lequel un véritable engagement envers les « biens communs » nous permettra de savourer la « richesse publique » au lieu de courir après sans fin ce dont nous n’avons pas besoin.
« Une pauvreté d'imagination »
Étant donné à quel point le mouvement de décroissance désavoue la coercition, comment cette transformation globale est-elle censée se produire ? « Les graines du communisme de décroissance germent partout dans le monde », écrit Saito, en soulignant les expériences de gouvernance locale dans des villes comme Barcelone, qui s'est engagée à devenir neutre en carbone d'ici 2050, et les coopératives agricoles en Afrique du Sud.
Même les sceptiques de la décroissance trouveront peut-être que les exemples d'organisation populaire donnés par Saito semblent agréablement démocratiques et improvisés. Mais la perspective d’une apocalypse mondiale que les partisans de la décroissance ne cessent de souligner a également pour effet pervers de donner l’impression que les mesures locales sont nettement inadéquates. Pourtant, Saito affirme que de telles expériences offrent quelque chose de crucial : une idée élargie de ce qui est possible. Les critiques de la décroissance, écrit-il, souffrent « d’une pauvreté d’imagination qui accepte simplement le statu quo comme immuable ».
Il se trouve que Susskind dit exactement la même chose, mais à l’inverse : ce sont les partisans de la décroissance qui souffrent d’un « manque d’imagination ». Les accusations en miroir sont frappantes. Ce n’est peut-être pas tant une question de manque d’imagination que de savoir où cette imagination est dirigée. Les techno-optimistes placent leur confiance dans l’innovation ; les décroisseurs placent les leurs dans les mouvements sociaux. Les deux camps prétendent être les véritables réalistes. Chacun insiste sur le fait que nous n’avons tout simplement pas assez de temps pour faire ce que l’autre veut.
L’intransigeance de ces conflits à somme nulle rappelle pourquoi les fantasmes gagnant-gagnant sont si attrayants en premier lieu. Quelles que soient les profondes différences entre les partisans de la décroissance et leurs détracteurs, l’ampleur de la crise climatique suggère un point de convergence : nous avons besoin de toute l’aide imaginative que nous pouvons obtenir.