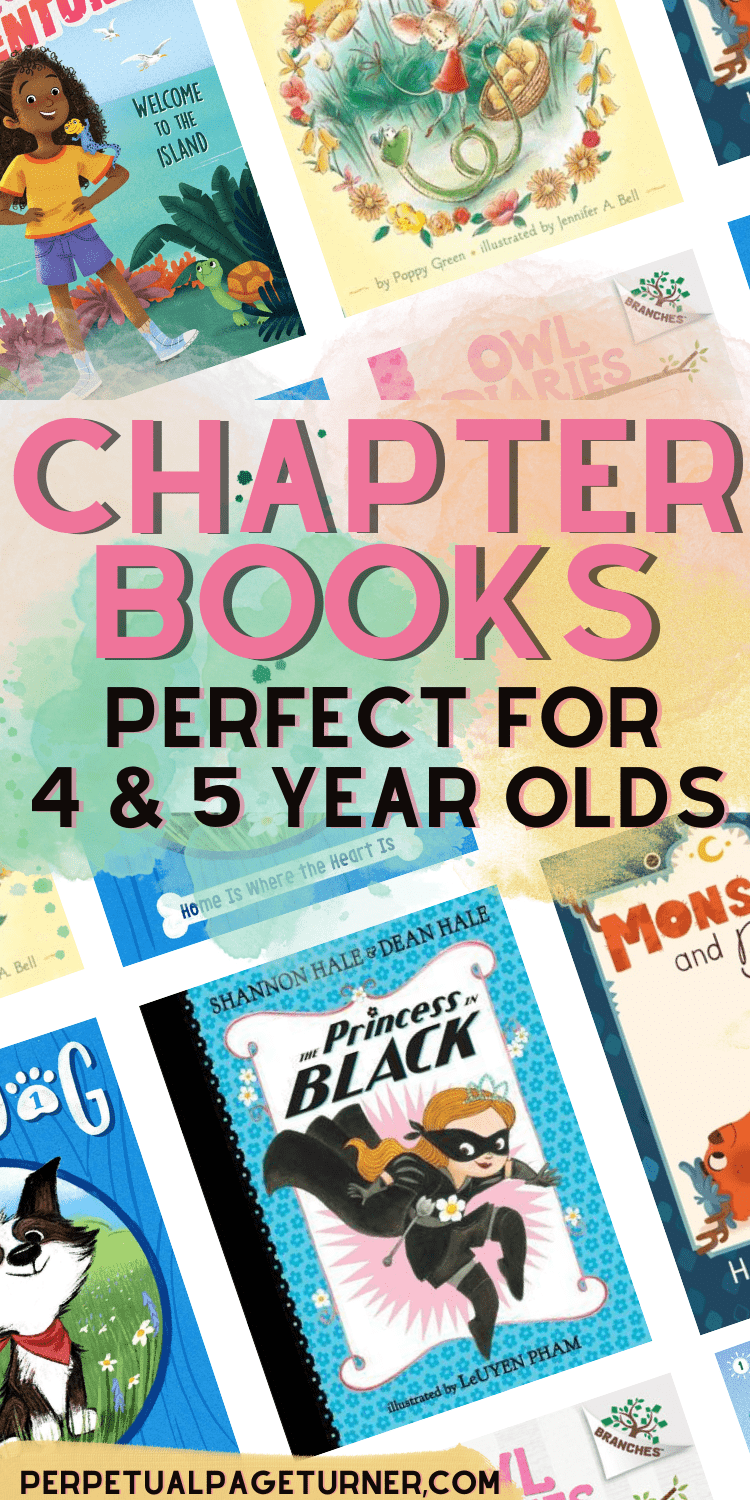Critiques de livres : « Le paradoxe de la liberté », de David Kinley ; « L'Amérique dernière », de Jacob Heilbrunn ; «Notre foi ancienne», par Allen Guelzo
Au début de la pandémie de Covid-19, au milieu des encouragements à rester à la maison, le tweet d'un candidat au conseil scolaire de Las Vegas est devenu viral : « Je viens d'aller dans un Red Robin bondé. » Sa raison ? « Parce que c’est l’Amérique. Et je ferai ce que je veux.
Pas si vite, dit David Kinley dans une méditation approfondie sur les complexités de la négociation de nos désirs avec ceux des autres. Kinley, professeur de droit des droits de l'homme, s'oppose à la « myopie farfelue » des gens qui croient que la liberté signifie une licence sans entrave. pour « faire ce que je veux ». De telles affirmations, écrit-il, « sont non seulement vouées à l’échec dans n’importe quel contexte sociétal, mais elles dénaturent également gravement ce qu’est la liberté ».
La liberté, selon Kinley, est intrinsèquement limitée. Il détaille les contraintes qui pèsent sur nos libertés dans huit domaines principaux de la vie : la santé, le bonheur, la richesse, le travail, la sécurité, la voix, l'amour et la mort. Parmi des observations plus banales – devoir travailler restreint nos libertés – Kinley aborde des problèmes plus intéressants, comme le droit au suicide. « Sommes-nous réellement libres de provoquer notre propre disparition », demande-t-il, et les droits des autres – en particulier des membres de la famille qui pourraient être psychologiquement affectés – sont-ils violés par le choix d'une personne de mourir ? Il s’agit d’un « calcul presque impossible », admet Kinley, mais il suggère également que s’intéresser aux mathématiques morales est bon pour toutes les personnes impliquées.
Et, raisonne-t-il, il est également bon pour nous que la liberté s’accompagne de responsabilités. Cela se voit, car les gens qui obtiennent toujours ce qu’ils veulent sont souvent malheureux. Prenez les despotes, par exemple. L'empereur romain Caligula était « malade, fou, perpétuellement craintif » ; Mao « souffrait d’insomnie et d’une libido théâtralement erratique » ; et Kim Jong-un, toujours souriant, « cache une obscurité sous son image publique ensoleillée et chorégraphiée ». D’un autre côté, explique Kinley, avoir un compromis entre vos impulsions et les exigences de la civilisation est plus susceptible de produire une société plus fonctionnelle avec plus de bonheur en général. « Nous nous en sortons d’autant mieux que la liberté est plus large et plus équitablement répandue », écrit-il. La difficulté, bien entendu, est de trouver comment le diffuser.
Dans (Liveright, 249 pp., 28,99 $), Jacob Heilbrunn aborde la liberté sous un angle différent, en commençant par les tyrans et en avançant à partir de là.
Heilbrunn, un journaliste chevronné qui couvre la politique de droite, a observé une tendance au cours de la dernière décennie : d'éminents conservateurs américains sont devenus plus éloquents dans leur admiration pour les despotes étrangers, des éloges de Donald Trump à l'égard de Vladimir Poutine aux applaudissements de Tucker Carlson pour l'autocrate hongrois. Viktor Orban, dont le gouvernement, a dit un jour Carlson, a « beaucoup de leçons pour nous tous ».
À ceux d’entre nous qui se demandent : comment en sommes-nous arrivés là ? Heilbrunn répond : Nous avons toujours été « ici ». « America Last » dresse une liste alarmante de personnages dont l’enchantement pour les dictateurs étrangers au fil des décennies a exercé une réelle influence sur la vie intellectuelle américaine.
Prenez par exemple la militante Elizabeth Dilling, que le Daily Beast a surnommée « le Steve Bannon des années 1930 ». Elle pensait que les réfugiés juifs aux États-Unis étaient venus en Amérique pour déclencher un coup d’État marxiste. En 1938, elle projeta de la propagande fasciste mettant en vedette Hitler et Mussolini devant des milliers de personnes à l'Hôtel Commodore de New York.
Dans les années 1960, L. Brent Bozell Jr., rédacteur de discours pour Joseph McCarthy et Barry Goldwater, « a méprisé l’idée selon laquelle la liberté était une aspiration louable » et est monté sur scène au Madison Square Garden pour pousser le gouvernement américain à établir un Théocratie chrétienne. En 1970, il a dirigé un groupe de 200 manifestants anti-avortement lors d'une violente attaque contre une clinique à Washington, DC, et a attaqué un policier qui tentait de l'arrêter avec une croix en bois de cinq pieds.
« America Last » est un catalogue impressionnant et engageant de la fascination de longue date de la droite pour l'autocratie, mais les lecteurs devront chercher ailleurs une analyse approfondie du plus grand casse-tête que cette histoire suggère : quelle est la meilleure façon de préserver la liberté ? et le gouvernement qui le protège de ceux qui sont attirés par le contraire ?
Dans l'historien AllenC. Guelzo se tourne vers le XIXe siècle pour identifier les défis du maintien d'une société libre. Il soutient de manière convaincante qu’Abraham Lincoln, qui s’est battu pour défendre la république américaine contre les forces autocratiques du Sud tout en restreignant les libertés civiles dans le Nord, peut nous aider à trouver un équilibre.
Lincoln a rarement fait des mentions explicites de la démocratie et n'a défini le mot qu'une seule fois, dans une courte note qu'il a notée sur un morceau de papier non signé. « De même que je ne serais pas un esclave, je ne serais pas un maître », écrit-il. « Cela exprime mon idée de la démocratie. »
C'était la théorie. La pratique, après qu’il soit devenu président et que les sudistes se soient rebellés, n’était pas aussi simple. En 1861, écrit Guelzo, lorsque des émeutiers de Baltimore tentèrent d'empêcher les miliciens de l'Union de se rendre à Washington, Lincoln autorisa « ses généraux à arrêter et à emprisonner les saboteurs présumés sans procès ni inculpation ». Il a également purgé les bureaux du gouvernement des employés qui refusaient de prêter serment de loyauté, et son secrétaire à la guerre, Edwin M. Stanton, a intimidé la presse et espionné les communications télégraphiques civiles.
Alors que les critiques accusaient Lincoln de diriger une dictature anticonstitutionnelle, il se demandait si les républiques libres avaient une « faiblesse fatale » : « Un gouvernement doit-il, par nécessité, être trop fort pour les libertés de son propre peuple, ou trop faible pour maintenir sa propre existence ? » Lincoln a opté pour la force du gouvernement, mais il savait que les motivations et les finalités étaient importantes. Il a mis en garde ses généraux contre la vengeance (« le sang ne peut pas restaurer le sang ») et a insisté sur le fait que « dès que les armées rebelles déposeraient les armes », ils devraient immédiatement « se voir garantir tous leurs droits en tant que citoyens d’un pays commun ».
Guelzo souligne les similitudes « étranges » entre l'époque de Lincoln et la nôtre. Il a gouverné dans un environnement hyper-polarisé et a été accusé de subversion de la liberté par des insurgés tapageurs. « Notre foi ancienne » révèle la fragilité de la démocratie dans de tels moments. Mais sa précarité peut aussi être une force, une source de flexibilité. La démocratie est un « gouvernement pour l’humanité, pas pour les anges », conclut Guelzo. L’astuce consiste à ne pas laisser les gens s’emparer de la démocratie, et donc de la liberté.